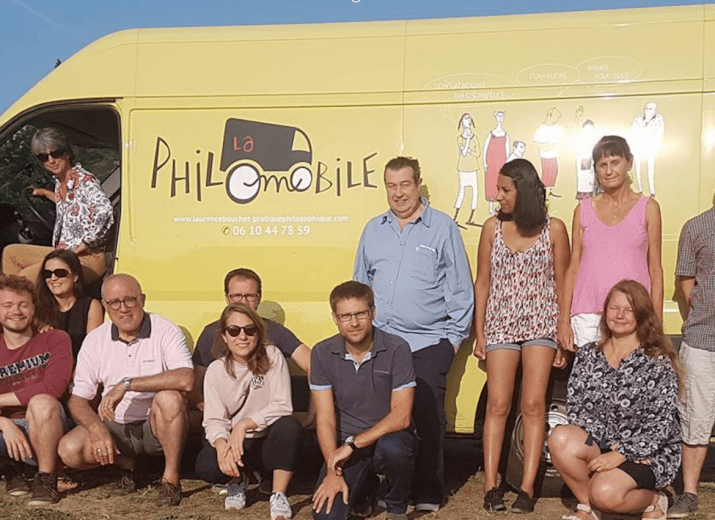Comment pratiquer la philosophie auprès d’enfants et d’adolescents vulnérables ? Qu’est-ce que cette pratique peut apporter à un tel public ? Qu’est-ce que cela implique comme posture de la part des intervenants qui les accompagnent ?
Agathe Delanoë est doctorante en sciences de l’éducation à l’Université de Nantes et chargée de projets pédagogiques à l’association ADOSEN, où elle effectue sa thèse en CIFRE. Ses recherches portent sur la construction de l’identité dans la pratique du dialogue philosophique à l’adolescence. Dans le cadre de ses activités de recherche, elle anime tous les lundi un atelier de philosophie dans un l’hôpital de jour à Paris avec des adolescents et des jeunes adultes en voie de reconstruction. Elle a découvert la philosophie pour enfants au Québec pendant ses études à l’Université Laval, où elle a débuté sa pratique et travaillé comme auxiliaire d’enseignement en philosophie pour enfants.
Ada est professeure de lettres modernes dans un lycée en banlieue parisienne. Elle intervient par ailleurs en foyer éducatif en Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) en région parisienne pour animer des ateliers de philosophie avec des enfants et des adolescents. Elle partage cette expérience en interrogeant la relation philosophie-enfant-éducateur dans le cadre de TD pour étudiants en devenir éducateurs à l’Institut régional du travail social (IRTS) Montrouge et Neuilly-sur-Marne.
En 2021, Agathe intègre le comité d’organisation des Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP) pour relancer le « Chantier PhiloSoin », qui interroge les liens entre philosophie et soin en explorant les pratiques philosophiques auprès de publics vulnérables ou en contexte soignant. Il vise à éclairer les conditions, les effets et la visée des pratiques philosophiques associées à une démarche de soin. Lors de la session 2021 qui se tenait à l’Université de Liège, Agathe et Ada ont à tour de rôle présenté leur pratique.
Agathe me reçoit dans son appartement à Paris pour réaliser une interview croisée. Nous dialoguons de manière spontanée, sans préparation et sans questions, dans l’idée de partager l’extrait d’un échange libre entre collègues. Ayant à peine franchi le pas de la porte je lui fais le récit d’un événement récent et nous nous dirigeons naturellement vers le salon, elle sur le canapé, moi sur le fauteuil en face. J’enclenche alors l’enregistreur avant d’oublier de le faire tout en poursuivant notre discussion.
La philosophie pour enfants dans le secteur médical et en travail social
Ada Loiret : Comme point de départ on pourrait se demander quel est l’intérêt de faire de la philosophie dans ces champs où a priori elle n’a pas sa place – en tous cas ce n’est pas évident – en dehors de l’école et de l’Université. Et donc, on pourrait se demander comment penser cette intersection entre philosophie et soin, philosophie et travail social. Certes, la philosophie donne des outils et des moyens pour penser par soi-même et devenir autonome. Il y a quelque chose de libérateur dans l’acquisition d’une nouvelle capacité à questionner. Partant de ce constat, j’ai le sentiment qu’en travail social on peut en venir à nourrir l’espoir que cela aide à résoudre des problèmes au foyer et chez les jeunes.
Agathe Delanoë : C’est vrai que parfois, l’institution fait appel à la philosophie pour enfants pour résoudre des problèmes. Je pense qu’il y a comme tu le dis le fait d’apprendre à questionner, et le fait que ce serait un produit miracle capable d’apaiser les conflits, les colères (à l’école, ça peut être le climat scolaire). Peut-être qu’il y a aussi quelque chose qui émerge, un mouvement qui voit la philosophie comme quelque chose qui pourrait soigner. Je n’ai jamais ressenti cette conception dont tu parles, d’une philosophie comme panacée, en hôpital de jour. Dans ce que j’ai vu, l’équipe soignante trouvait ça intéressant mais je n’ai pas l’impression qu’on attendait de moi que je puisse résoudre des conflits.
AL : Je trouve que là où il y a une ambiguïté. À la fois on attend et on va parfois me formuler explicitement cette attente, qui est que ça puisse résoudre ou aider à résoudre des problèmes, le plus souvent liés à la gestion et la maîtrise de la prise de parole en public, tout en ayant parfaitement conscience que ce n’est pas aussi immédiat qu’on le voudrait, que ça prend du temps, et que ce n’est pas parce qu’on a un dialogue à propos de la violence, par exemple, qu’immédiatement après les adolescents vont trouver des clés ou une réponse pour trouver une solution miracle. Je crois que les travailleurs sociaux sont parfois pris dans cette ambiguïté où ils reconnaissent que le travail de la pensée est long, tout en espérant que cela ait des effets concrets et notables qu’on puisse vraiment remarquer dans des attitudes et des paroles. Je reprends les propos d’un ami, qui explique parfaitement le fait que si la philosophie peut être utile, elle ne peut en revanche pas s’inscrire dans une perspective utilitaire ni thérapeutique, et qu’il y a par ailleurs des bienfaits à ce qui est non « utilitaire ».
AD : Je comprends le besoin, quand on a en charge des jeunes en difficulté, d’avoir quelque chose de palpable. On attend des résultats. Mais c’est le processus du dialogue philosophique lui-même qui est intrinsèquement éthique. Ce processus qu’on engage leur permet de discuter de choses qui viennent rejoindre leur expérience, de construire leur pensée, de faire l’expérience de la puissance de leur pensée et de leur capacité à impacter l’autre par leur parole. Ce sont des éléments qui sont en eux-mêmes bénéfiques. Donc la dimension philosophique est importante, mais aussi le dispositif lui-même, qui est relationnel et social. Peut-être que c’est dans cet aspect relationnel et social qu’on trouverait plus d’éléments objectivables. Rien que le corps par exemple, la manière dont on se tient pendant l’atelier, est-ce que ce jeune va se redresser, est-ce qu’il va arrêter de griffonner sur sa feuille, regarder l’autre avec attention ? Mais je pense que c’est l’ensemble du dispositif qui concrètement fait du bien. Oui, parfois c’est intéressant de parler frontalement d’un sujet, mais souvent, comme tu l’as dit en arrivant, c’est au détour d’une discussion sur le bonheur qu’on va réfléchir à la discussion ou la dispute qu’on a eu la veille.
Soigner sans participer au processus global du soin
AL : Je serais curieuse que tu me parles un peu plus de ton expérience. Tu disais que tu ne ressentais pas forcément qu’on attendait de toi que l’atelier de philosophie soigne. Pourtant, tu interviens dans un contexte médical. Donc qu’est-ce qu’on attend de toi, ou plutôt qu’est-ce qu’on attend de l’atelier de philosophie ?
AD : L’hôpital avait besoin de trouver une activité qui serait un peu comme une transition. Parce que les jeunes sont dans le service la journée mais à l’extérieur le soir et le weekend. Pour l’équipe soignante, c’était donc une manière de faire une transition entre l’extérieur et le retour à l’hôpital le lundi matin. C’est une « médiation culturelle ». Pour l’équipe, je ne fais pas partie du soin. Ça veut dire que je ne suis pas, par exemple, partie prenante d’une décision médicale. Ma neutralité du point de vue du soin est importante pour eux. C’est un peu particulier car d’un côté il y a une participation au processus global du soin – en tant que médiation, ça fait partie du soin – mais en tant qu’animatrice extérieure, je ne suis pas soignante. L’effet « médiation thérapeutique », c’est le groupe qui le fait, et j’accompagne le groupe sans être pour autant dans un rapport individuel avec eux.
AL : Tu travailles avec le même groupe depuis plusieurs mois. Comment les jeunes ont-il réagi à ta venue et comment se sont-il comporté au début ?
AD : Les jeunes arrivent après une période de crise. Ils viennent dans le service pour se stabiliser, se reconstruire et organiser un projet de vie pour la suite. L’atelier a été reçu assez favorablement. J’ai aussi été dans un rapport de transparence : je leur ai expliqué que je faisais une thèse, que l’atelier en faisait partie et que ce serait vraiment intéressant pour moi de pouvoir en parler avec eux. Ils ont trouvé ça très chouette de participer à une recherche. L’équipe m’a aussi signifié que pour les jeunes c’était valorisant qu’une personne vienne toutes les semaines. J’entends souvent quand j’arrive cette phrase des soignants « Agathe est arrivée ! ». Symboliquement il y a quelqu’un qui vient pour eux.
Des êtres humains capables de penser
AL : Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, que tu étais une personne extérieure qui venait les voir et que ça pouvait leur faire du bien. Ça a vraiment fait échos à ce que j’ai pu vivre au tout début dans un foyer où j’interviens encore aujourd’hui, depuis plus d’un an. Je suis d’abord allée rencontrer les jeunes avant d’animer le premier atelier. Ils m’ont demandé pourquoi je m’intéressais à eux et si j’allais juger leur personnalité. J’étais la première personne extérieure qui leur proposait une activité au sein de leur établissement. J’avais l’impression qu’ils présupposaient qu’ils étaient différents d’autres jeunes parce qu’ils sont marginaux et que, parce qu’ils sont marginaux, ils ne seraient pas capables. De fait, certains ont développé des troubles en raison de traumatismes. Il y a parfois une difficulté à discerner les choses et à dépasser une contradiction. Ces difficultés sont réelles, pour autant je ne crois pas qu’ils ne soient pas capables de penser. Je supposais qu’ils pouvaient produire des raisonnements logiques et intéressants. Pour eux cela ne semblait pourtant pas évident. Et j’entends la même phrase quand j’arrive « Y a Ada ! ». J’imagine que ça doit les valoriser et participer à leur épanouissement.
AD : Ce que tu dis me ramène à une discussion qu’on a déjà eue autour de l’idée d’une réhabilitation. Ces jeunes sont marginalisés et ont parfois été déscolarisés. Ils ont souvent une estime d’eux-mêmes chaotique, surtout du point de vue de la pensée. Donc quelqu’un qui vient pour intervenir à l’endroit même où ils sont ébranlés, ça peut aider une reconstruction. Pour les jeunes de mon groupe cela peut être difficile d’échanger avec d’autres jeunes à l’extérieur. Cette activité leur permet aussi d’avoir des choses à dire, à raconter, en dehors du contexte de soin.
AL : Les jeunes avec lesquels je travaille en foyer semblent faire une distinction entre ce qu’ils sont en tant qu’adolescents vulnérables d’un côté, et leurs potentiels et capacités de l’autre. Je le remarque car on ne parle pas de leur histoire et je ne connais pas leurs problématiques, sauf exceptions. Quand je viens, c’est comme s’il ne fallait pas que je leur pose la question de « comment ça va ? », à savoir, comment ça se passe au foyer, au quotidien, car ce serait les ramener et les réduire à leurs problématiques. Je sens ce refus. Donc on enchaîne directement sur la discussion philo !
AD : Tu mets le doigt sur quelque chose d’essentiel et je suis complètement d’accord avec ton analyse. C’est la même chose pour moi. Ma neutralité et mon externalité, c’est aussi ça. J’ai eu accès à quelques informations a posteriori dont j’avais besoin pour ma thèse. Mais la raison de ma présence est que ce sont des êtres humains capables de penser et l’atelier leur donne la possibilité de penser ensemble.
L’importance d’avoir une éthique professionnelle dans la relation aux participants
AL : J’ai l’impression qu’on est à l’extérieur aussi des mécanismes de transfert et de contre-transfert[1] entre le jeune et l’éducateur ou le soignant. On vient pour le temps de l’atelier, on reste un peu avant ou après pour discuter, mais on ne construit pas de relation. Et c’est peut-être justement ce qui nous permet de poursuivre dans le temps les ateliers avec un groupe.
AD : Je ne sais pas, ce qui est sûr c’est qu’on n’a pas du tout la même place vis-à-vis des jeunes que les personnes directement impliquées dans le soin. Dans le cadre de mon DU en clinique de l’adolescent, j’ai dû me poser la question d’un possible transfert des jeunes sur moi et moi d’un contre-transfert dans ma pratique. Je ne suis pas psychologue, mais j’ai l’impression qu’en prenant les lunettes du psychologue ou du psychanalyste, on pourrait voir énormément de choses. D’ailleurs, une infirmière avec qui je fais souvent le retour sur l’atelier a une lecture très psychanalytique de l’atelier, quand moi j’ai une grille de lecture philosophique. Il est arrivé que je trouve la discussion difficile pour les jeunes et que je ne sois pas contente philosophiquement parlant, mais que cette infirmière ait une interprétation de l’atelier complètement différente, de l’ordre du travail psychologique effectué par les jeunes, car elle avait accès à leur histoire et leurs enjeux personnels. Je pense qu’il se passe quand même quelque chose entre nous et les jeunes, mais qu’on ne perçoit pas forcément tout.
AL : C’est hyper intéressant. Il y a deux savoirs, le savoir de l’intervenant en philosophie et le savoir du psychologue ou psychanalyste. Et en même temps l’animateur a aussi une manière de réagir aux interventions, réactions, émotions des jeunes. On ne peut pas ignorer la subjectivité de l’animateur et donc oui il doit y avoir des choses qui se jouent. Je me rappelle d’une jeune qui était extrêmement impliquée et investie dans l’atelier, et même attachée à prendre ma défense devant les autres si elle estimait que l’attitude d’un autre jeune vis-à-vis de moi n’était pas correcte. Il y a pleins de comportements chez elle où comme tu dis parfois il y a quelque chose qui se joue et je ne sais pas de quoi il s’agit vraiment, d’où l’importance et l’intérêt je trouve d’agir d’après une éthique professionnelle, et de trouver une juste distance avec les jeunes. Comment faire dans ce type de situation ? Quelle distance garder, établir ?
AD : Oui, c’est une question éthique que tout animateur devrait se poser. Dans mon cas, le fait d’avoir les soignants présents à l’atelier (et disponibles pour discuter) m’aide à objectiver les choses. Il faut faire attention aussi à ce que nous voulons offrir aux jeunes – à nos attentes. Je pense que là-dessus il faut rester modeste, s’en tenir à l’atelier de philosophie. Mais même si on vient une heure par semaine, on développe une relation sur le long terme.
AL : C’est vrai que, de la même manière que je ne connais pas la vie des jeunes, ils ne connaissent pas ma vie. A aucun moment je ne parle de moi, ni de ce que je fais. Mais, parfois ils me posent des questions sur mon métier, pourquoi je ne suis pas éducatrice, pourquoi je n’ai pas la télé chez moi, ce que je fais en vacances, et je sens que parfois ça peut développer quelque chose qui est extrêmement favorable à l’atelier. Oui, il faut se demander ce qu’on peut vouloir et ce qu’on doit faire en atelier avec les jeunes, et je trouve que parfois ces petits écarts sont nécessaires et sont bien. Une jeune m’a demandé un jour quel était le moteur de mon existence. C’était une vraie question, pas seulement par curiosité car elle semblait attendre quelque chose qui puisse la guider dans sa propre existence. Donc je suis montrée sincère car j’en avais envie, mais avec une réserve et un détachement. Répondre mais sans entrer dans la confidence ni l’intimité : je me suis contentée de répondre que c’était l’amour, qui me guidait dans mes relations et mes agissements.
La philosophie, un savoir transversal ?
AL : Dans les programmes scolaires au lycée on distingue de grands domaines de la connaissance comme la science, l’histoire, la littérature, la philosophie. Il n’y a pas vraiment de transversalité de la philosophie. Elle est séparée des autres disciplines et elle arrive en fin de cycle, où on suppose les élèves désormais aptes à penser par eux-mêmes. Mais, si cette transversalité n’est pas institutionnalisée ni inscrite au programme comme tel, certains enseignants donnent une dimension réflexive à leur cours et soulèvent des enjeux.
AD : Qu’est-ce qu’on appelle philosophie ? Je ne sais pas si la philosophie de l’enseignement en terminale et la pratique du dialogue philosophique désignent une même chose. Mais dans les deux cas, il me semble qu’on se situe dans une approche générique et réflexive. Je n’ai pas l’impression d’arriver en atelier avec une posture d’enseignante, ni de détenir une autorité au regard d’une connaissance à transmettre. Lipman et Sharp[2] ont justement voulu rompre avec cette posture traditionnelle et cette rupture amène un rapport différent au savoir. On va chercher à construire la connaissance en partant de l’expérience des jeunes et en présentant les choses de manière problématique pour alimenter le goût du mystère.
« Ce qui fait du bien c’est de se détacher de soi »
AD : Cette manière de faire de la philosophie a du sens pour moi en général, pas seulement avec les enfants. Il me semble que c’est aussi une manière de vivre. Le dispositif de la communauté de recherche, pour moi c’est ça la philosophie. La discussion doit donner du sens à nos vies et se rattacher à notre expérience du monde. C’est pour cela qu’on part de l’intérêt des jeunes, pour qu’ils relient la discussion philosophique à leur expérience. On va développer des habilités de pensées et des dispositions pour les accompagner dans la construction de leur savoir.
AL : La philosophie permet de soulever des problèmes avec un détachement vis-à-vis de l’objet questionné. On peut soulever de grandes questions éthiques et existentielles sans s’investir ou s’engager totalement corps et âme, sans parler de soi, et pour autant on s’approprie les questions.
AD : Oui, dans la discussion philosophique il y a quelque chose de générique, de conceptuel, mais qui prend toujours sens dans un contexte particulier. On forme un concept nourri de toutes les singularités. Il me semble que l’une des conditions pour engager une personne dans le dialogue est qu’elle soit mise en mouvement. Si c’est quelque chose qui met en mouvement, c’est parce qu’on y trouve du sens, et si on y trouve du sens, c’est peut-être parce qu’on le rattache à notre expérience.
AL : Quand tu lis des analyses qui entrecroisent différents savoirs comme la sociologie, la philo, l’histoire par exemple, tu comprends que ton expérience n’est pas isolée et qu’il y a comme quelque chose de l’ordre d’une vérité générale là-dedans. La philo va t’aider à comprendre ce qu’il y a de commun dans ton expérience.
AD : Il me semble que ce serait le fait de donner du sens en se rattachant à quelque chose de sinon universel, en tous cas de générique. S’inscrire comme sujet universel au-delà du sujet singulier et historique. Et on revient à la question de départ à propos du soin. Finalement, peut-être que ce qui fait du bien c’est de se détacher de soi.
Une interview réalisée par Ada Loiret Toutes ses publications
[1] En psychanalyse, le transfert est une projection affective et émotionnelle de l’analysé sur le thérapeute. Il s’agit, pour le patient, de déplacer un élément de son histoire ou de son existence sur la personne du thérapeute. En réponse à cela vient ensuite le contre-transfert qui désigne la réaction que le thérapeute peut avoir vis-à-vis de son patient. Ce sont des éléments centraux de la cure psychanalytique
[2] Matthew Lipman et Ann Margaret Sharp ont contribué à fonder la Philosophie pour Enfants.