Tout le monde trouve la vulnérabilité formidable. Les philosophes en font l’éloge. Ce serait la qualité du XXIe siècle. Dans le monde professionnel, on dirait même : une soft skill. « Oui, j’ai le droit d’être vulnérable » : c’est ce que nous voudrions revendiquer. Nous savons bien pourtant que cela n’est pas si simple.
Est-ce parce que nous vivons dans un monde trop dur, qui en réalité ne ferait pas de place à la vulnérabilité ? Est-ce parce que, comme le montre l’anthropologue du handicap Charles Gardou (dans La société inclusive, parlons-en ! Toulouse, Erès, 2012), il est mal vu d’être fragile ?
Nous serions alors dans une civilisation schizophrène, ambivalente, brandissant d’un côté la vulnérabilité en étendard, incitant tout un chacun à un faire état… et dans un mouvement contraire, on nous en ferait interdiction : « osez être vulnérable. Mais n’osez pas l’être ! »
On peut penser que c’est dans la nature des choses qu’une civilisation repose sur des grandes polarités. Des choses valorisées d’un côté, et dévalorisées de l’autre. On peut penser, aussi, qu’il est normal qu’une société produise de l’hypocrisie. Comme chez Molière, nos nouveaux Tartuffes diraient : « Cachez cette vulnérabilité que je ne saurais voir » …
Mais il faudrait se garder de glisser dans une facilité de penser – facilité qui consisterait à estimer que notre société est, en fait, intolérante à la faiblesse. Et donc à la vulnérabilité, quoiqu’on en dise et quels que soient nos aimables slogans.
Ce n’est peut-être pas de la faiblesse que notre société a peur, mais de la force. Pas de la force physique, non : mais de ce que les anciens appelaient la « force d’âme ».
La « force d’âme », une vertu oubliée
Les grecs, nos ancêtres (qui, en philosophie, le sont davantage que les gaulois) l’appelaient andreia. De anêr, homme. On trouve pareillement en latin virtus ; de vir, homme.
Gardons-nous d’interprétations et de jugements hâtifs : pas de masculinisme ici, ni de virilisme ! Ce n’est pas parce que la force ne serait que masculine, que le mot est indexé sur le masculin ; mais parce qu’il fut un temps où le masculin était culturellement dénoté, caractérisé par la force d’âme. Notons d’ailleurs que le mot grec comme le mot latin, est féminin.
Personne ne parle plus de vertu aujourd’hui, sauf quelques philosophes, et non des moindres (Fiat, É., « Dignité et vulnérabilité », in L’éthique de la dépendance face au corps vulnérable, Toulouse, Érès, 2019, p. 21-54.). Personne ne parle plus d’âme, sauf les religieux. Nous ne comprenons plus ces termes. Or nous avons sûrement besoin, plus que jamais, de les comprendre à nouveau, de les ressaisir.
Avant d’aller plus loin, apercevons que nous vivons la caducité de deux projets : caducité du projet chrétien occidental et du projet moderne de société.
Deux projets qui ne font plus sens
Le projet chrétien occidental fait de la blessure une condition de salut, de rédemption, de la souffrance un moyen d’humilier l’orgueil et d’être plus proche du divin. C’est ainsi que Charles Péguy écrit en 1914 dans sa « Note conjointe sur Descartes » :
« Les « honnêtes gens » (…) ne sont pas blessés (…) Parce qu’ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables.
Parce qu’ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu’ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout.
La charité même de Dieu ne panse point celui qui n’a pas de plaies.»
Le projet moderne de société a remplacé en le sécularisant le « projet » chrétien, et l’Etat social, qui promet à chacun le droit d’être « pris en charge » (puisque tel est le mot consacré, aujourd’hui remplacé par « accueil » et « accompagnement »), en est par essence le couronnement. On sait comment les établissements hospitaliers et médico-sociaux, publics et associatifs, ont pris le relais des congrégations, des hôtels-Dieu, etc.
Or ces deux projets avaient vocation à donner un sens à la vie, à la mort, à la souffrance. Mais leur « storytelling » ne fonctionne plus. Ils nous déçoivent. Et du coup, nous n’en finissons plus de déplorer, de nous agacer.
Nous disons, d’un côté : les gens aujourd’hui n’ont plus le sens de l’effort… La moindre difficulté est vécue comme une insupportable violence. Et nous disons, de l’autre : l’Etat se désengage… les mécanismes de solidarité publique et collective sont en panne.
La fin du grand récit chrétien occidental laisse place au nihilisme, à l’absurde : la vie n’a pas de sens. Et du coup, la vulnérabilité non plus.
La fin du grand récit de l’Etat social laisse place à l’individualisme, au chacun pour soi. Il est de bon ton de s’émouvoir du transhumanisme, mais nous vivons déjà à l’heure de l’homme « augmenté » : chacun est sommé de compiler des compétences, de veiller à l’actualisation de ses skills. En somme, de s’augmenter pour durer.
Pour autant, est-ce le fin mot de l’histoire ? Rien n’est moins sûr ! Car, qu’il faille choisir entre la souffrance ou l’absurde ; ou qu’il faille choisir entre l’entrepreneuriat de soi-même et la dépendance à une solidarité défaillante : voilà ce qui ne fait plus sens aujourd’hui.
Renouer avec l’éthique des anciens
Nous vivons peut-être le moment propice à une forme de reprise, de ressaisissement, d’une partie de notre héritage, de nos traditions de penser la vie.
Je n’ai pas envie d’être une souffrance sur pattes pour exister. Je n’ai pas envie d’être une collection atomisée de compétences. J’ai envie d’être une personne comme le montre Scheler dans Six essais de philosophie et de religion.
Une personne, c’est ce qui rayonne de moi et qui n’est pas résumable à mes « capacités » ou « capabilités », pas plus que mes incapacités ou « incapabilités ».
C’est cela en quoi je m’enracine, et qui n’est pas résumable à une fiche signalétique ou d’identité (confessionnelle, linguistique etc.).
C’est ce que je peux donner, et ce qui m’a été donné. Autrement dit, ce qui fait que je suis vivant. Cette vie qui me donne la force de traverser des épreuves, des blessures, des souffrances. Et de porter mes vulnérabilités.
À ce propos, le philosophe Bertrand Vergely a cette intuition très juste dans La Souffrance : recherche du sens perdu : ce n’est pas la souffrance qui donne un sens à la vie, mais la vie qui donne un sens à tout… y compris à la souffrance.
Parler de force d’âme, c’est tout simplement refaire lien avec la pensée des grecs. En effet, l’éthique, pour les grecs, ce n’est pas faire descendre de hautes valeurs sur terre, comme on essaierait de faire descendre des ballons d’hélium : « tolérance », « bienveillance », « dignité », « respect », etc.
C’est avoir la force de se regarder soi-même. D’engager le dialogue de l’âme avec elle-même. D’œuvrer à son ethos, son comportement ; d’être à soi-même son éducateur, au sens où Pierre Hadot, un formidable passeur de sagesse antique, envisageait dans son ouvrage éponyme La philosophie comme éducation des adultes.
Ce n’est pas me conformer à une règle morale, que celle-ci provienne de Dieu (tu ne feras point…) ou d’une morale transcendante à laquelle je me soumets (comme chez Emmanuel Kant dans Fondements de la métaphysique des mœurs).
Mais c’est au contraire la vertu, la « force d’âme » : la faculté de cultiver un certain rapport avec soi-même. Qui s’énonce sous la forme d’un paradoxe : plus j’ose me regarder, et me montrer, par où je crains de paraître faible, plus… je suis fort.
Être vulnérable, c’est aussi pouvoir blesser l’autre
Oser dire : j’ai peur. Je suis triste. Je ne sais pas. Je suis blessé. Dire ce dont je crains que cela puisse atteindre l’autre : ma peur va lui faire peur ; ma tristesse va l’attrister ; mon ignorance va le laisser ignorant ; ma blessure, le blesser.
L’étymologie de vulnerabilis, c’est, on le sait, ce qui peut être blessé, mais aussi, on le sait moins, ce qui peut blesser.
Cette atteinte si redoutée, c’est elle qui alors, à son tour, revient et m’atteint, me blesse une seconde fois, m’effraie une seconde fois, m’attriste une seconde fois.
C’est pour cela que c’est dur ! Qu’il y a de la résistance (Widerstreben) et du refoulement (verdrängen), comme diraient les psychanalystes – des termes que l’on trouve chez Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et représentation, qui met au centre de son éthique la plus haute compassion, Mitleid, parfois traduite par « pitié ». Et pourquoi pas, si elle n’est pas lointaine condescendance, mais une forme de complicité de celui qui se reconnaît dans les mêmes plis ?
Je résiste, je refoule ce qui me gêne, m’effraie, m’encombre chez moi – et me ferait me sentir pour l’autre un encombrement. Tout, plutôt que paraître en ma frémissante, ma pâle (ou ma rougissante, c’est selon), ma sensible vérité !
On le sait bien, pourtant, que la vraie faiblesse, c’est vouloir paraître fort. Ne donner aucune prise. Péché d’orgueil, dirait le chrétien ? Vouloir-vivre médiocre du faible, dirait Nietzsche dans La Généalogie de la morale ? En tout cas, tragique erreur : je crois sauver ma force, quand je m’épuise à me dissimuler, à me « contrefaire ».
Arrêtons-nous sur ce mot : pendant longtemps, on disait d’une personne présentant des malformations physiques handicapantes qu’il était « contrefait ». Ici, c’est moi-même qui me handicape, me charge, m’alourdit, me bride, en recouvrant de voiles épais, en enfouissant ces parties les plus sensibles de mon être.
J’aurais trop honte d’être pour autrui objet de compassion, de pitié. Et je lui dénie l’usage de cette faculté. Oui, je crains d’encombrer, disais-je. D’agresser l’autre, même, avec ma vulnérabilité.
Accueillir la vulnérabilité de l’autre
Que le sagace lecteur de La Pause Philo me permette, ici, un aparté. Bruce Wayne est homme d’affaires le jour et Batman la nuit. Comme lui, je suis la nuit philosophe, et le jour, directeur et manager.
Or manager est un de ces métiers bizarres – comme avocat, médecin, psy, etc. où l’on reçoit l’expression des tourments humains. Découragement, pleurs, colère, bref : humeurs diverses ; parfois même, folie. C’est dans l’humaine nature que l’homme vienne déposer chez son « N+1 » son petit paquet.
Il serait faux de dire que tout ce que l’on dépose chez moi, sur mon bureau pour ainsi dire, me laisse indifférent. En dépit de l’image que l’on aime à se faire (et que certains aiment à se donner) du dirigeant insensible et sans affect, je peux dire au contraire que je suis affecté, touché, blessé à l’occasion.
Je suis donc bien vulnérable, moi aussi : mais là n’est pas la question. Ce que cela met en lumière, c’est combien il me faut de force d’âme pour accueillir la vulnérabilité de l’autre. Dirai-je, pour autant, que c’est ma propre vulnérabilité qui permet l’expression de la vulnérabilité de l’autre ?
Ce qui me permet de faire place à la vulnérabilité d’autrui, n’est-ce pas, plutôt, l’espace que je lui fais ? En ce sens, Derrida dans son Adieu à Emmanuel Levinas a raison de dire que c’est le recueillement qui permet l’accueil, et vice versa, c’est parce que je suis capable d’accueillir que je peux aussi me recueillir en moi-même. L’un ne va pas sans l’autre.
La vulnérabilité : la force de croître ?
C’est alors et en ce sens que je m’augmente. Non pas, comme dans le projet transhumaniste, pour me préserver, pour durer plus longtemps, pour me conserver identique à moi-même. Non. Mais au sens où je m’autorise (auctor : augmenter), je m’élargis, je fais de la place, je m’agrandis. Je m’autorise à croître.
C’est pour cela que les injonctions à accueillir la vulnérabilité de l’autre et à lui faire droit, toutes bien intentionnées qu’elles soient, ne sont pas opérantes. Elles restent lettre morte ou, pire, servent hypocritement de paravent.
Ce qu’il nous incombe de ressaisir, c’est un horizon de la vie morale – oui, n’ayons pas peur des mots ! – à l’intérieur duquel la force d’âme a toute sa place, car c’est elle qui peut donner sens à la vulnérabilité, qui est notre humaine condition.





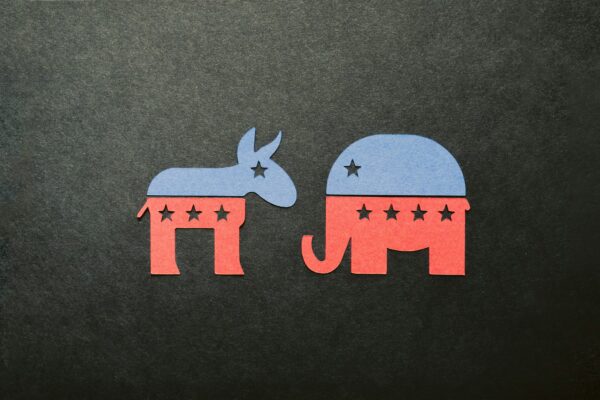
Un commentaire pour “Penser la vulnérabilité : les leçons de la force d’âme”