La philosophie de terrain ne cesse de créer des méthodes appropriées à son travail. Elle emprunte notamment à la méthodologie des entretiens développée en sciences sociales, tout en leur conférant une visée compréhensive et située, afin de saisir comment les personnes concernées développent des concepts moraux et des savoirs sur et dans leur contexte de vie.
En tant que philosophes de terrain, nous choisissons de mener des entretiens précisément parce que nous voulons apprendre des points de vue subjectifs de nos enquêtés. Ce sont des questions sans mauvaise réponse, leur richesse résidant dans la description que la personne peut faire d’elle-même ou de son expérience. Pourtant, quand je propose des entretiens, c’est souvent avec incrédulité et humilité que l’on me répond. “Je ne suis pas spécialiste” ou “Vous devriez peut-être interroger quelqu’un qui s’y connaît” ponctuent les discussions. Ce sont pourtant bien ces visions intimes ou brutes que je cherche à atteindre.
Les exemples sont tirés de mon expérience de terrain pour ma thèse de philosophie. J’interroge les malades chroniques, qui restent longtemps à l’hôpital et/ou le fréquentent régulièrement, sur leur rapport à l’architecture des lieux de soin, ce qu’ils y apprécient, ce qu’on pourrait améliorer.
Pourquoi toujours se disqualifier ?
Au-delà de la pudeur à devoir parler de soi sous le feu du projecteur du chercheur, les interrogés sont sincères quand ils s’excusent de ne pas savoir. Comment naît donc cette habitude qui nous fait croire que nous savons peu ?
Un premier élément de réponse serait qu’enquêtés et enquêteurs n’associent pas les mêmes significations aux mots. Prenons l’exemple, traité par la chercheuse Marion Segaud, de sondages sur la perception de l’architecture par le grand public (Segaud, 200). A la question “Vous intéressez-vous beaucoup, assez, assez peu ou pas du tout aux questions concernant l’architecture et l’aménagement des villes ?” seule une personne sur deux répond positivement. A la requête “Pouvez-vous me citer trois noms d’architectes célèbres, contemporains ou non ?”, seuls 40% des interrogés peuvent en donner au moins un (Sondage Ipsos, 1987). Et si on demande d’associer le nom d’un architecte à un grand monument, moins de 20% y parviennent (Sondage Ipsos, 2002). Et les analyses de conclure à “une cruelle ignorance”. Nous sommes pourtant nombreux à réfléchir à notre habitat, à le choisir avec soin et à aimer le mettre à notre goût. Mais nous sommes surtout nombreux à associer plus spontanément le terme “architecture” à l’histoire de l’art, aux grands monuments et au patrimoine, plutôt qu’aux espaces dans lesquels nous vivons et que nous percevons au quotidien. Demander à citer un architecte célèbre, ou auteur de grand monument, c’est convoquer un registre élitiste, académique, auquel nous ne nous sentons pas forcément appartenir. De là notre réticence à nous dire amateurs ou connaisseurs d’architecture.
Ce biais conduirait-il à ce qu’on croit tous ne pas être sachants, ni même concernés, par les thèmes qui pourtant nous traversent ? Sans doute, et cela vaut pour bien d’autres sujets. On ne pourrait évaluer le degré de politisation des Français.e.s en leur demandant de relier des noms de ministres à des lois ou des dates. On en conclurait rapidement que nous ne le sommes pas trop, politisés. Pourtant, nous vivons dans des communautés politiques, nous sommes tous concernés par des décisions politiques et nous serions tous à même de décrire l’effet qu’elles nous font ressentir, si on nous en donnait les moyens.
Réfléchissons aux moments dont nous disposons pour exprimer librement notre expérience et livrer nos interprétations. Sont-ils nombreux ? Et sont-ils satisfaisants ? Prenons l’exemple d’une consultation médicale. Comment ne pas citer les études qui avancent que les patients, lors de leur rendez-vous, se font couper la parole au bout d’une dizaine de secondes en moyenne par leur médecin, tandis que seul un tiers aurait l’occasion et le temps de décrire ses symptômes (Journal of General Internal Medicine, 2018). Pourtant, tout un pan de la théorie médicale repose sur l’idée que le malade est bien le premier dépositaire des savoirs sur les états de son corps et sur les retentissements de ces états dans sa vie. « J’étais bien le porteur de la vérité de mon corps » écrit Barrier dans La blessure et la force (2010).
Quels sont donc ces savoirs ?
Nous sommes porteurs de vérité, dépositaires des savoirs sur ce qui nous arrive et ce dans quoi nous vivons. Ces savoirs sont d’abord des lectures clairvoyantes, des points de vue internes, des analyses fines de nos vécus. De l’intérieur, nous identifions les nœuds et les trajectoires qui mènent à la cristallisation d’une situation. Sans forcément les nommer, nous savons y naviguer, éviter les obstacles ou démêler des tensions. Ces savoirs sont d’abord des savoir-lire, des savoir-juger.
Ils sont aussi des savoirs expérientiels, des savoirs d’usage, des habitudes adoptées et des attitudes développées en regard de nos situations pour y vivre mieux et selon nos valeurs. Nous développons des stratégies, des habiletés, des aptitudes individuelles pour nous orienter et poursuivre nos buts. Nous savons comment mobiliser les ressources à notre disposition et les articuler avec nos aspirations pour s’engager dans l’action. Nous créons alors, avec une grande force d’inventivité, de nouveaux styles de vie, de nouvelles manières d’être ou de faire les choses, plus ajustées, mieux adaptées.
Je pense à cette patiente qui m’a montré comment elle se maquillait depuis sa drastique baisse de motricité. Pose de crème et de mascara n’ont pas été remis en question, mais d’autres manières d’ouvrir les flacons et de s’appliquer les produits ont été inventées, à force de tests et de corrections. Je pense aussi à cette personne capable de citer tous les endroits, dans son quartier, où elle savait pouvoir se reposer en sécurité. Églises, bancs publics, magasins accessibles et accueillants, étaient mémorisés et patiemment cartographiés pour lui permettre des sorties sereines dans sa ville.
Tous sont des savoirs élaborés dans le réel et qui ne sont que rarement atteints, connus, ou documentés. Ils permettent pourtant de mieux vivre dans des situations complexes, de composer avec des cadres incertains et de transformer des réalités insatisfaisantes. Ils sont aussi la preuve que bon nombre de situations qui nous effraient par manque de connaissance (comme la baisse de motricité ou la fatigue chronique, dans nos exemples) sont viables si on se donne la peine d’apprendre à naviguer. Ce sont d’autres allures de vie (Canguilhem, 1965), réalisées à partir d’autres sensibilités, reposant sur d’autres facultés que les nôtres.
L’effort de la philosophie : poser les bonnes questions
Lors de l’entretien, pour toucher ces savoirs, nous allouons du temps et construisons un cadre accueillant les paroles. Mais toujours, il m’arrive de me heurter à des haussements d’épaules et des sourires gênés de personnes qui pensent n’avoir rien à me dire. Le philosophe de terrain cherche alors longtemps, souvent, comment questionner pour que ces savoirs se donnent à voir.
Mes questions pourraient faire bondir un sociologue ou un anthropologue cherchant à décrire des pratiques, des trajectoires de vies et des dynamiques sociales. Dans l’entretien en philosophie, je pars du principe que les personnes sont concernées, c’est précisément pour ça que je les ai approchées. J’amène certes la personne à décrire son histoire, mais aussi à s’engager dans une réflexivité, l’entraînant dans la prise de conscience des savoirs qu’elle développe pour vivre bien. En un sens, je m’autorise à produire des effets, car j’amène mon enquêté à poser un autre regard sur lui-même. Mais cette prise de recul sur ses propres habitudes de vie n’est pas aisée, c’est un chemin qui demande d’être soutenu par les bonnes interrogations.
Poser les bonnes questions, avec les bonnes formulations, ne peut se faire qu’après un premier travail vis-à-vis des personnes visées. On ne s’adresse pas à tout le monde de la même manière. Certains seront choqués, d’autres effrayés par le simple fait d’être interrogés. La visibilité de leur vécu, l’habitude qu’ils ont à aborder le sujet ou à parler d’eux, les hiérarchies dans lesquelles ils sont pris, leur situation sur l’échiquier de la légitimité sont autant de paramètres qui influent sur leur disposition à répondre. La préparation de l’entretien est une démarche qui demande bien des corrections. Il nous faut comprendre les leviers qui appellent l’expérience et permettent à l’interrogé de l’exprimer avec confiance. Au philosophe de se renseigner et de bien s’entourer. Les bons interlocuteurs pourront affiner nos questions balbutiantes, par leur expérience du terrain, leur connaissance du groupe visé, ou leur degré d’engagement sur le sujet traité.
Il nous faut déplier et multiplier nos demandes, faire appel aux expériences quotidiennes, à la description de l’ordinaire, demander des exemples, et souvent, encourager, témoigner à la personne l’importance et le respect que l’on accorde à son vécu. C’est par ce travail patient et minutieux que nous pouvons l’amener à prendre conscience de la manière dont elle articule sa situation, ses ressources et ses priorités dans un style de vie qui lui appartient et qu’elle a créé.
N’oublions pas non plus de présenter à la personne l’objet de notre étude et l’intérêt de son entretien. Les interrogés seront d’autant plus à même de nous répondre qu’ils voient ce qu’ils sont en train de nous apporter. Ils ne peuvent être confiants dans la pertinence de leur récit que s’ils identifient sa part contributive à notre recherche. J’ai déjà demandé “Si vous étiez architecte, qu’est-ce que vous feriez”, cherchant à recueillir les impressions des personnes sur un bâtiment. Évidemment, beaucoup m’ont répondu ne pas être architecte, donc ne pas savoir. En changeant ma question pour “Pour aider un architecte, que lui diriez-vous en tant qu’usager ?” j’ai pointé du doigt l’importance de leur point de vue, entraînant beaucoup plus d’enthousiasme dans la réponse, et d’engagement dans la suite de l’entretien. Au philosophe de terrain, finalement, de prouver à l’enquêté sa qualité.
Pendant l’entretien se dévoile alors, délicatement, lentement, l’étendue des savoirs développés par la personne au fil de son expérience et de son histoire. Il n’est pas rare qu’elle dessine elle-même et pour la première fois la généalogie de ses savoirs et la créativité dont elle a fait preuve pour les construire.
Savoir les savoirs : une nécessité politique
Rappelons-le, ce que cherche le philosophe de terrain, c’est bien à comprendre les expériences subjectives, les lectures singulières, les constructions personnelles face au réel. Au-delà des vérités générales et des discours d’experts, nous recueillons les énoncés, bruts, parfois décousus, souvent sporadiques, quand les langues se délient. A partir de ces aperçus qui se dessinent, de ces instantanés plus ou moins organisés, le philosophe de terrain peut déplier les rationalités élaborées et les méthodes mobilisées. En-deçà de l’innovation ou des grandes découvertes, le philosophe documente ces facultés subtiles, faiblement visibles. Ces savoirs alternatifs sont immenses et pluriels. Au philosophe d’en montrer la portée.
Le caractère expérientiel de ces savoirs ne les rend pas moins communicables, réplicables ou généralisables. Des personnes ayant déjà vécu des situations similaires pourront transmettre leurs savoirs à ceux qui en manifestent le besoin. Citons la pair-aidance en médecine, l’entraide entre patients qui vivent où ont vécu des situations similaires, qui repose justement sur la capacité d’un savoir singulier à inspirer et à accompagner.
Le travail du philosophe consiste ensuite à rapporter l’expérience au champ scientifique ou à nouer la théorie autour du monde empirique, de sorte à prendre en charge ou à soulager les contraintes et les difficultés vécues dans le réel. Les situations conceptualisées par la philosophie deviennent audibles et peuvent orienter un changement dans les pratiques et politiques. Dans ma recherche, avant d’élaborer les caractéristiques d’un bon espace de soin, j’écoute et j’apprends par exemple les singulières interactions des personnes avec leur environnement, en fonction de leur corps et de leur expérience.
Je découvre à quel point un fauteuil doit pouvoir bouger au sein même d’une chambre, lorsqu’un patient partiellement paralysé me décrit à quel endroit de sa chambre et à quel moment de la journée il demande à être assis, afin de pouvoir contempler les effets de lumière les plus à son goût, donnés par les rayons du soleil ou la couleur des sirènes des ambulances à travers sa fenêtre. Je prends la mesure de l’inaccessibilité réelle des choses alors que des patients me décrivent les gestes complexes qu’ils doivent mettre en place pour saisir leurs affaires quand la perfusion les empêche de lever ou de tendre les bras.
Ces savoirs donnent de l’épaisseur à nos connaissances sur l’accessibilité ou l’architecture. Ils ont la consistance de la vie réelle qui résiste aux théories générales, ils composent avec son caractère changeant et vacillant. Capables de rebondir et de se renouveler dans un monde hétérogène, les savoirs pourraient métamorphoser bon nombre de nos habitudes bancales si on s’en inspirait. Ressources intarissables au pas de côté du philosophe, il serait également bon pour nos solutions et nos décisions politiques de s’en laisser instruire.


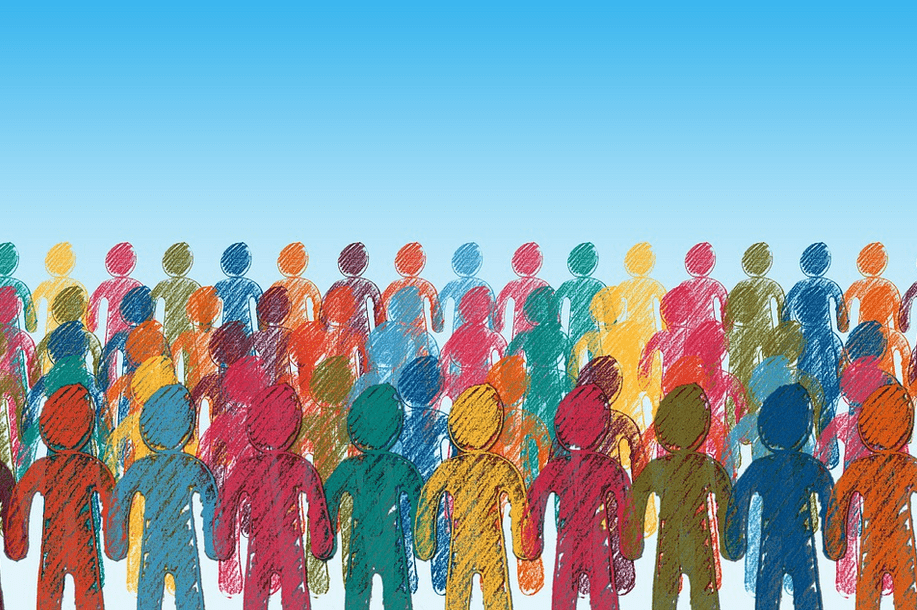



Un commentaire pour “Savoir les savoirs – L’entretien en philosophie de terrain”