“La philosophie a commis, sinon un péché originel,
du moins une faute grave, et cela dès le commencement :
elle a placé les idées trop haut.”
Alexandre Lacroix, Pour que la philosophie descende du ciel
Nous avons rencontré Alexandre Lacroix, fondateur et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, à l’occasion de la sortie de son dernier livre Pour que la philosophie descende du ciel. Il a rassemblé dans cet ouvrage dix années d’écrits pour Philosophie Magazine où, partant chaque fois d’une expérience personnelle ou d’une œuvre de fiction, il montre que la philosophie naît avant tout d’un rapport concret au monde. Cette rencontre fut pour nous l’occasion de l’interroger sur sa lutte constante et affirmée contre l’image élitiste et “divine” de la philosophie, afin de la rendre accessible au commun des mortels.
Pourquoi la philosophie a longtemps été un intervalle entre le monde réel et le monde idéel, mettant en scène une lutte, une guerre entre les deux mondes ?
Alexandre Lacroix : J’aurais tendance à penser qu’il faut ici adresser une double critique, à la fois à l’idéalisme, qui projette les idées dans le ciel, et au réalisme.
Commençons par l’idéalisme. Dans La République, Platon propose un schéma inaugural, progressif du cheminement de la philosophie, à travers l’allégorie de la caverne : nous autres, humains, serions condamnés à séjourner dans une caverne où nous ne verrions que des ombres, jamais les choses elles-mêmes. Autrement dit, le réel que nous percevons et le sens commun seraient trompeurs, il ne faudrait pas y adhérer. L’enjeu de la philosophie serait donc, selon Platon, de se libérer des chaînes qui nous retiennent dans la caverne, d’en sortir et de s’habituer à la lumière du soleil. Une fois dehors, nous pourrions voir les choses telles qu’elles sont vraiment.

Dans cette allégorie, le soleil représente les Idées transcendantes, celles du Vrai, du Beau et du Bien, qui d’ailleurs fusionnent pour Platon. Selon ce schéma inaugural, tant que nous ne faisons pas l’effort de philosopher, nous restons enfermés ou englués à un stade inférieur : nous sommes en contact avec le réel grossier, en proie à des sensations et des désirs partiaux, ne contenant pas de vérité en eux-mêmes et dont il faudrait s’éloigner par la raison dialectique.
Mais l’idéalisme va plus loin encore, au point d’être franchement délirant : pour Platon, les Idées ont des attributs que l’on réserve habituellement au divin. Elles sont éternelles, immuables, uniques ; il n’y a qu’une seule idée du Bien, une seule idée du Vrai. Platon laisse entendre dans la République que les Idées seraient l’ouvrage d’un démiurge, d’un Dieu donc, tandis que dans d’autres dialogues il les présente comme incréées. Quoi qu’il en soi, cette métaphysique met le philosophe en position d’autorité, en contact avec des Idées divines que le commun des mortels ne discerne pas.
Évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette description platonicienne. Il est dangereux de diviniser les Idées. Je pense donc qu’on peut proposer une remise à plat, consistant à ne pas prendre les Idées pour autre chose que ce qu’elles sont : ce sont des produits courants de notre activité psychique et ce sont bien des créations humaines. Elles ne prennent sens qu’au regard des expériences humaines, elles ne nous surplombent pas. Si je veux savoir ce qu’est l’amour, je peux ouvrir des traités pour en obtenir la définition, mais il vaut peut-être mieux que je commence par me demander quand j’ai l’impression d’avoir ressenti quelque chose qui ressemblait à de l’amour. De même pour la politique, nous venons de vivre Nuit debout, une élection présidentielle… Ce sont des événements et des expériences partagées qui permettent de donner un contenu à l’idée de politique, qui sans cela reste très flottante. Autrement dit, les idées philosophiques – l’amour, la politique, etc. – sont des mots que nous employons pour désigner des catégories d’expériences et pour les penser.
Maintenant, pourquoi le réalisme n’est-il pas beaucoup plus convaincant que l’idéalisme ? Parce que le concept de « réalité » est beaucoup trop large. C’est un fourre-tout. Qu’est-ce qui appartient à la réalité ? Les plantes, les animaux, mais aussi le chiffre 2 ou le Petit chaperon rouge ? Les événements passés sont-ils réels ? On sent bien qu’on doit essayer de classifier les choses pour s’y repérer, qu’il convient de parler d’un « réel sensible », d’un « réel mathématique », d’un « réel fictionnel » ou encore d’un « réel passé »… En somme, le concept de réalité pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Je propose de ne faire confiance ni à l’idéalisme ni au réalisme, mais d’essayer de penser de préférence à hauteur d’humain, à partir d’expériences vécues.
Si la tradition socratique envisage que l’essentiel réside dans un monde impalpable et parfait, comment la philosophie peut-elle aider à vivre sans s’échapper de l’expérience ? Que nous apporterait la philosophie en plus de l’expérience de la vie ?
Nous avons un problème pour réfléchir. Nous n’en sommes pas capables. Il suffit de regarder le succès des cours de méditation : nos contemporains sont à la recherche d’une méthode pour réfléchir. On aimerait bien se poser dans un fauteuil et se demander ce qu’est le bien, le mal, l’amour, la politique, ou tout simplement entrer en contact avec l’essentiel, mais nos pensées vont spontanément divaguer… On se met à rêvasser au repas du soir, à une préoccupation professionnelle, à une relation amoureuse, et on n’atteint jamais l’objet auquel on voulait réfléchir. La philosophie est avant tout un support (avec la lecture des textes, mais aussi les conférences, les conversations…) qui permet d’activer en nous la pensée, quand tout concourt dans la vie sociale à nous en priver. Les supports philosophiques font converger notre attention sur des énoncés qui ravivent en nous la flamme de la pensée, et l’empêche de s’éteindre. C’est pourquoi la philosophie a un effet stimulant, comme le café. Elle réveille la pensée.
Ensuite, la philosophie peut apporter quelque chose que je comparerais à la lecture des romans : nous avons beaucoup de sentiments en nous à l’état gazeux, diffus. Tout à coup, en lisant un grand roman, les sentiments vont prendre un contour plus net, nous allons commencer à saisir leurs nuances. La philosophie fait la même chose pour les idées : nous en avons tous, mais nous avons du mal à les exposer, à les formuler. “Education”, “morale”, “art”, “souffrance”, “douleur”, “deuil”… Sur tous ces mots, tout le monde aurait des choses intéressantes à raconter. Le problème se pose lorsqu’il faut commencer à parler ! La philosophie aide à faire une mise au point, à poser des mots justes sur ces idées que nous avons en nous à l’état diffus.
Vous voyez, cette manière d’envisager la philosophie est assez vivante, mais elle a une contrepartie : elle implique qu’on renonce à la considérer comme une science, capable de fonder des vérités, mais aussi qu’on n’en fasse pas une thérapeutique, capable de procurer du bien-être. Ni science, ni médecine, la philosophie apporte plus modestement une stimulation et une clarification des idées que nous avons déjà en nous.
Il n’est pas question d’abandonner la lecture des philosophes mais de les considérer comme des “metteurs en mots”. Comment être un “metteur en mot” sans tomber dans l’écueil de cet exercice, qui consisterait à tomber dans le dogmatisme ou dans un clivage entre l’expérience et la philosophie ?
Je m’inscris dans une tradition sceptique qui vient de l’Antiquité, pour laquelle il n’y a pas de vérité ou d’idée ayant une valeur absolue. Le scepticisme fait tomber la dimension religieuse de la philosophie et sa prétention à avoir un contact avec le divin. En devenant sceptique, nous sommes amenés à envisager la philosophie comme un exercice descriptif. Si la philosophie ne peut pas atteindre des vérités, un philosophe ne peut rien accomplir de mieux qu’une description adéquate ; il s’agit même de ce que l’être humain peut réussir de mieux au moyen du langage. C’est une manière d’envisager à la fois la philosophie et la fonction du langage.
Mon goût pour la philosophie est venu de mon rapport à la littérature : j’ai écrit très tôt des histoires, des poèmes et j’ai publié un premier roman à 22 ans, c’est ma première vocation. Mais j’avais un problème avec la langue française, car elle a un caractère très abstrait, presque spontanément philosophique. Nous avons beaucoup de mots généraux à notre disposition et je sentais un vrai problème pour choisir : est-ce que je dois dire “âme”, “conscience”, “pensée” ? Est-ce que je dois employer le mot “vrai” ou “vérité” ? Ce n’est pas simple de cerner ces différences. J’avais le sentiment de vouloir jouer de la guitare avec deux cordes, il y avait un problème de précision. Qu’est-ce que ces mots véhiculent ? J’ai commencé à m’intéresser à la philosophie afin de préciser le vocabulaire de la langue française, de comprendre ce que chacun de ces mots abstraits véhiculait. Je suis parti d’une préoccupation littéraire, donc. Mais cela nous concerne tous. La maladresse dans le vocabulaire que nous utilisons a un retentissement dans notre communication avec les autres.
Ainsi, avec le scepticisme, la perte du rapport au transcendant est compensée par cet appétit sans cesse renouvelé de décrire avec des mots justes ce que l’on ressent, ce que l’on pense. Ce chemin de pensée issu de la tradition antique passe notamment par Montaigne, Nietzsche, et se poursuit jusqu’à nos jours, formant une voie alternative à la philosophie platonicienne. En un mot : j’aime une tradition philosophique qui tente, presque comme le fait le roman, de rendre compte de l’existence humaine.
Un des enjeux de Pour que la philosophie descende du ciel est de montrer comment partir de l’expérience pour philosopher. Est-ce que l’écriture de textes de philosophie pour tout un chacun pourrait être la possibilité de poursuivre un questionnement, une confrontation aux auteurs ?
Je ne pense pas que la philosophie soit l’apanage des seuls philosophes assermentés. Nous pouvons tous prendre plaisir à manier les idées, sans avoir besoin d’un CAPES ou d’un diplôme d’une institution quelconque. De même, l’écriture n’appartient pas uniquement aux écrivains. Il vaut mieux l’envisager comme un fait social total. Tout le monde écrit sans cesse : post Facebook, mails, SMS, journaux intimes, mais aussi des histoires, des nouvelles, des poèmes, des déclarations d’amour… L’écriture est une trace, liée à la capacité à sortir de soi, à mettre en mots des sentiments et des pensées puis à les transmettre. L’un des mérites des réseaux sociaux est d’avoir fait tomber complètement la frontière entre ceux qui publient et ceux qui ne publient pas.
Il y a peu de gens qui écrivent des traités de philosophie, mais l’écriture reste dans un incroyable mouvement collectif. Beaucoup d’œuvres considérées comme importantes n’ont pas été écrites au sein du milieu littéraire et n’étaient même pas destinées à la publication. On peut penser à la Lettre du voyant de Rimbaud, à Pessoa dont l’essentiel de l’œuvre a été retrouvé dans une malle, à la publication posthume de L’Ethique de Spinoza… On ne sait finalement jamais par quelle série de hasards un texte trouve une descendance ou devient un classique. L’écrivain professionnel est quelqu’un qui s’intéresse au maniement de l’art des mots et qui veut en devenir maître, mais cela n’implique pas que les autres ne savent pas manier les mots. Le philosophe professionnel, quant à lui, cherche une maîtrise accrue du maniement des idées ; ce n’est pas pour autant que les autres n’ont pas d’idées.
Ces convictions sommaires mais robustes se sont traduites par des actions personnelles. En 2006, j’ai lancé comme rédacteur en chef, avec quelques autres, Philosophie Magazine, afin d’avoir un nouveau support séculier, profane pour diffuser la philosophie. Un magazine est un objet très simple, consommable et jetable, mais nous essayons d’y faire de bons articles de philosophie. Je suis également co-fondateur d’une école d’écriture, Les Mots, qui vient d’ouvrir ses portes dans le cinquième arrondissement de Paris et qui compte 250 élèves. Comment faire pour que les gens progressent dans l’écriture ? Comment faire en sorte que la philosophie ou la littérature soient davantage présentes dans l’espace public, et soient transmises en-dehors du cadre académique ? Philosophie Magazine ou les Mots, ce sont des tentatives de réponse.
Il convient de se méfier de quiconque prétend au monopole des idées ou de la création. Dans ma pratique de l’écriture, il m’a fallu découvrir Kerouac pour que je comprenne qu’on peut écrire en premiers jets successifs, comme un jazzman. Pour les éditoriaux de Philosophie Magazine, qui font l’essentiel du livre Pour que la philosophie tombe du ciel, je cultive l’énergie du premier jet. Je n’ai jamais mis plus de quinze minutes à écrire un de ces textes, parce qu’il s’agit d’improvisations : j’essaye d’y mettre de l’énergie, de la spontanéité. Je ne suis pas sûr qu’il y ait des frontières si établies que cela entre les écritures savantes et les écritures spontanées.
En un mot : il n’y a pas autant de barrières qu’on l’imagine !

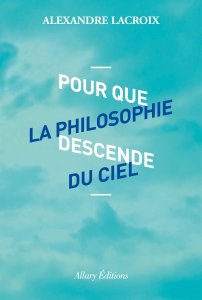




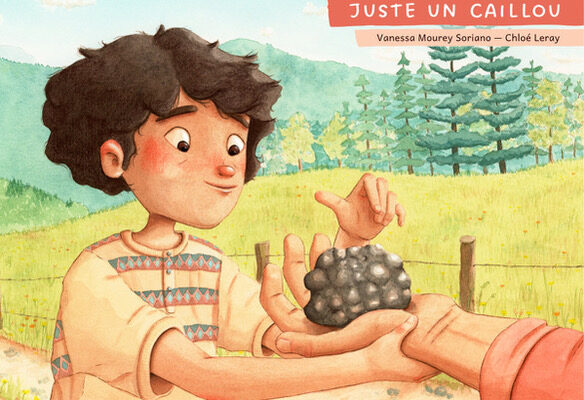
J’AI beaucoup apprécié Merci