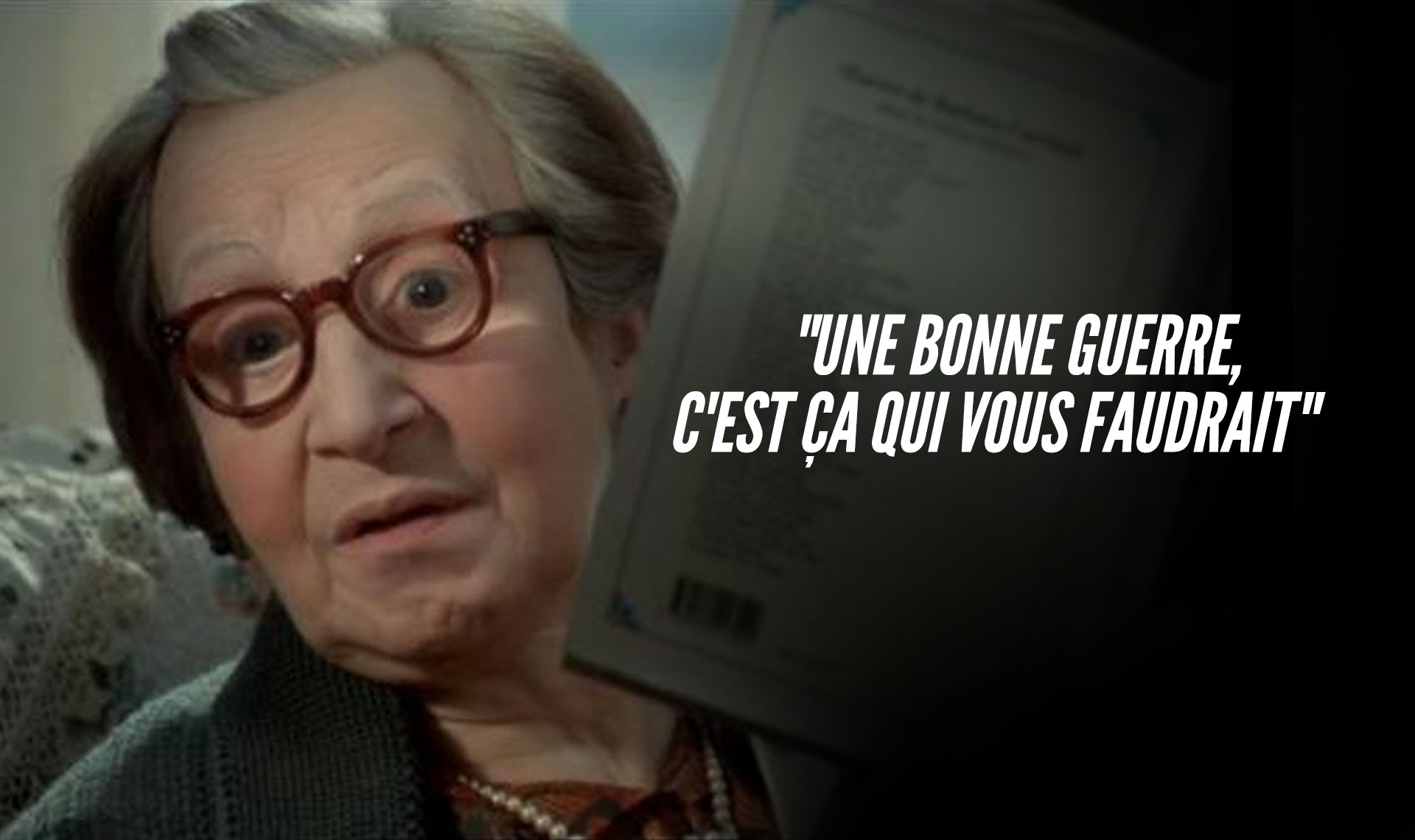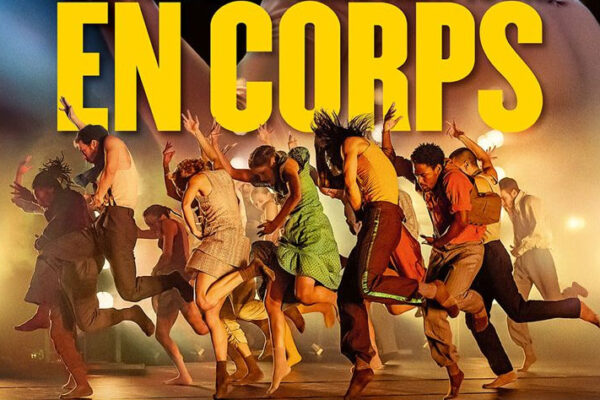La liberté d’expression doit-elle être réprimée pour préserver la sensibilité des individus ? La question est encore brûlante : au moment où j’écris ces lignes, le journal Le Monde s’est désolidarisé de son dessinateur Xavier Gorce suite à la publication d’une caricature qui a « choqué » les réseaux sociaux. C’est l’occasion, non pas de remettre en cause nos diverses sensibilités, mais plutôt de réfléchir aux effets de notre sensibilité sur la liberté de publier. Alors, demain, tous censurés ?
Qu’est-ce-que l’humour ?
L’humour peut se définir comme un trait d’esprit consistant à attirer l’attention sur un élément de la réalité. Une certaine distance est prise par l’humoriste qui extériorise un aspect plaisant ou déplaisant de son existence, mais aussi de celle des autres. Il se détache d’un morceau de lui-même, qui le touche et qu’il souhaite partager avec d’autres sur le ton de la plaisanterie. Il forme une blague, un récit humoristique chargé de raconter l’absurdité de la condition humaine.
Il y a en effet une profondeur dans cet acte de distanciation que Kierkegaard avait déjà remarquée. Selon lui, l’humoriste comprend la finitude de l’être humain et l’utilise pour la supporter. Il n’en dégage en revanche pas la signification et se contente d’exploiter son apport humoristique. Avoir le sens de l’humour ne serait donc pas avoir le sens de ce que dévoile son humour. Cela signifierait que l’humour saisit quelque chose qu’il ne parvient pas toujours à approfondir : l’humour nous permet d’émettre un trait d’esprit sur une situation tout en cachant quelque chose de cette situation. Un choix est effectué : nous choisissons de montrer un aspect qui va servir notre récit au détriment d’autres aspects. Lorsque je fais de l’autodérision, je choisis une partie de moi susceptible de faire rire les autres. Dit d’une autre manière, cet élément choisi pourrait ne pas être drôle. Pour jouer avec l’humour il faut donc une matière, c’est-à-dire un élément du réel, et une manière de mettre en forme cette matière.
Si le choix de la matière est subjectif, alors le public réceptif ne sera pas universel. Il faut pourtant prendre en compte l’autre pour espérer que notre humour fasse mouche. Bien que ce choix me concerne, il concerne aussi tous les autres, à savoir ceux auxquels l’humour s’adresse, ceux que je m’apprête à faire rire. Le subjectif cherche en lui-même l’universel : qu’est-ce-qui, en moi, est susceptible de faire rire l’autre ? En partant de ma propre expérience, j’essaie d’atteindre tous les autres pour dire quelque chose de collectif, quelque chose de l’humanité. Au même titre que l’artiste qui part de lui-même pour proposer un éclaircissement sur la condition de tous.
Mais est-ce que l’humour est universel ? Je ne crois pas, car l’humour ne dépasse pas les frontières du connu à moins que sa signification soit expliquée. L’humour semble en effet dépendre des cultures, des communautés. Desproges disait déjà qu’on pouvait rire de tout mais pas avec tout le monde. Car tout le monde ne se retrouve pas dans l’élément choisi. Si ma blague utilise le jargon médical, il n’est pas dit que les personnes qui ignorent ce jargon la comprennent. De même, si un étudiant en philosophie fait une blague sur la phénoménologie du verre d’eau à un serveur, il n’est pas dit que celui-ci la comprenne s’il n’est pas lui-même familier du vocabulaire sartrien. Il pourrait même percevoir cette blague comme une provocation. Aussi l’humour dépend surtout du milieu social. Mais faut-il pour autant en conclure que si l’humour a des limites, ces limites doivent le limiter ? Car finalement, rien n’empêche l’étudiant et le serveur de surmonter leurs différences et de discuter.
Avoir le sens de l’humour n’est pas donné dès la naissance : il semble plutôt s’agir d’une construction sociale. En nous confrontant à l’humour de l’autre, nous développons nous-aussi une forme d’humour. Nous apprenons à en saisir la force et nous utilisons notre propre expérience pour construire un récit humoristique. Aussi faire preuve d’humour et comprendre un trait d’esprit humoristique sont deux choses différentes : je peux être drôle et ne pas comprendre l’humour de l’autre. Cela signifie que l’humour est d’abord compris par ceux qui le pratiquent de la même manière. Lorsque plusieurs pratiques de l’humour se confrontent, un partage et une compréhension n’est pas toujours possible. Un premier réflexe serait de dire qu’il vaut mieux s’abstenir de faire de l’humour lorsque l’autre risque de ne pas saisir notre propos, d’en être choqué, et de se sentir vexé. Ce type de réaction a été très répandu après l’attentat de Charlie Hebdo de janvier 2015 : de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer « l’acharnement » du journal sur la religion musulmane, justifiant ainsi un lien de cause à effet entre l’expression d’un humour subjectif et une action terroriste. La question se pose donc de savoir si, par son caractère subjectif et/ou culturel, l’humour peut dépasser cette limite posée de fait par les différentes communautés et ainsi être un acteur de la liberté d’expression ?
La culture naturelle des communautés : une contradiction conceptuelle
Il s’agit là d’un problème crucial, car c’est l’essence même de la démocratie qui est interrogée. Si la démocratie vise le vivre-ensemble, doit-elle encourager chaque groupe ou communauté à vivre séparément des autres et de se conforter dans ses idées ou doit-elle au contraire leur permettre de dépasser les différences ? Car le terme de communauté, bien qu’au premier abord rassembleur, semble aussi créer une division. On tend à se constituer comme communauté par instinct de survie, pour se protéger contre ce qui nous est extérieur, contre un ennemi. Il ne s’agit donc pas d’un terme qui permet une ouverture sur le monde. C’est pourquoi il n’y a pas une seule communauté mais une pluralité ce qui signifie que les communautés se distinguent par les différences que chacune met en avant. La communauté rassemble des individus en raison de certaines qualités ou par certains goûts. Elle crée ainsi une sorte de bulle au sein de laquelle les individus se co-constituent pour le bien de la communauté. Cette bulle existe en opposition avec les autres communautés. Si je fais partie d’une communauté de technophiles, je ne fais pas partie de la communauté des technophobes. Je me constitue ainsi en n’étant pas technophobe. Je suis, par le fait de mon intégration dans la communauté, opposée à ce qui se trouve hors de la mienne.
Il y a alors un décalage entre chaque communauté. Aucune ne semble pouvoir se comprendre. Si chacune se replie sur elle-même par la simple adhésion, que dire de l’humour ? L’humour cherche à rassembler malgré les différences, et pourtant nous pouvons aujourd’hui observer que l’humour divise. Il se distingue en ce sens de la moquerie, qui crée volontairement un écart entre soi et l’autre. Si chacun se limite à ce qui lui est familier, alors aucune rencontre avec l’autre n’est possible, et chacun garde pour lui ce qu’il croit lui appartenir, à savoir sa « culture ». Sa culture, c’est-à-dire son « identité », son adhésion à certaines valeurs, sa personnalité, serait privée, protégée du reste du monde. Elle serait quelque chose qui nécessiterait une garde rapprochée, pour ne pas la dénaturer. Mais comment peut-on dénaturer quelque chose qui n’est pas naturel ?
En effet, la culture se définit traditionnellement comme ce qui permet à l’être humain de s’élever au-dessus de la nature, c’est-à-dire ce qui lui permet de s’élever au-dessus de sa condition initiale. Il s’agit d’une distinction conceptuelle qui nous permet de penser notre rapport au monde : l’objectif n’est pas d’objectiver la nature pour en faire un objet devant être transformé par la culture. Grâce à cette distinction, nous pouvons comprendre que la culture est ainsi synonyme d’ouverture au monde, dans la mesure où elle est ce par quoi tout être humain augmente ses connaissances et améliore ainsi ses facultés. La culture s’opposerait alors à la nature, et pourtant elle semble aujourd’hui être considérée comme un bien naturel possédé par un groupe d’individus, et ne pouvant de ce fait faire l’objet d’une connaissance par ceux qui se trouvent en dehors de ce groupe. La culture ne nous permet plus de nous ouvrir à l’altérité, elle nous enferme au contraire dans ce que nous connaissons déjà.
Si l’humour est culturel, alors l’humour est lui aussi réduit au connaissable, au rassurant. Ce qui signifie que je ne peux pas rire d’un groupe duquel je suis exclu, au risque de troubler la tranquillité de ce groupe et menacer l’intégrité de sa culture. Or si l’humour est culturel, cette hiérarchie serait aussi d’ordre culturel. Ce qui signifie que nous prendrions le risque d’instaurer une classification entre les différents types d’humour et de communautés. Si à chaque communauté correspond un certain humour, alors un humour particulier ne pourrait être utilisé par une autre communauté : un tel acte ne serait pas perçu comme un clin d’œil, mais comme un manque de respect, une violation de la propriété privée. Chaque type d’humour serait alors cloisonné, compartimenté par les limites particulières des communautés, et une échelle de valeur serait instituée pour permettre de savoir ce qu’il est possible de dire et ce qu’il est nécessaire de taire sous peine de sanctions. Quel genre de société est-ce là ? Est-ce une société respectueuse des différences ou bien une société méfiante de l’autre qui avance masquée au nom de la neutralité ?
Une forme de censure se développe alors, guidée par cette volonté de ne pas choquer. Mais que signifie choquer ? Pourquoi faudrait-il à tout prix préserver les individus des chocs, dans une société où pourtant la violence est disponible gratuitement en tout lieu et en tout temps ? Selon le dictionnaire, un choc est une « entrée en contact de deux corps qui se rencontrent violemment ». Le choc désigne aussi l’ébranlement qui résulte de ce contact violent. Il peut par exemple s’agir d’un choc thermique. Un choc est donc quelque chose qui laisse une trace. Lorsque nous parlons de choc culturel, nous désignons l’effet que produit sur un individu la découverte d’une culture qui lui était jusque-là étrangère. Ce choc est-il si violent qu’on veuille lui échapper ? On peut aussi vouloir créer un choc chez quelqu’un pour le réveiller, pour attirer son attention, pour le faire réfléchir. Un roman peut me choquer et me faire réfléchir ensuite : faut-il l’interdire parce qu’à un moment donné il a provoqué en moi un choc ?
Cela me fait penser à cet épisode de la série Black Mirror intitulé « Arkangel » (Saison 4, épisode 2) : l’histoire est celle d’une mère qui est prête à tout pour protéger sa fille en testant notamment une nouvelle technologie de traçage : un implant de surveillance de pointe doté d’un contrôle parental. Grâce à cette puce, si l’enfant ressent une peur, ou une émotion qui diffère de la normale, alors le contrôle parental va s’activer et flouter ce que l’enfant regarde. Dès lors, l’enfant ne va voir que des images floues : sa perception de la réalité va être bouleversée. Aussi, lorsque son grand-père fait un malaise, la petite fille ne peut pas l’aider : effrayée, le contrôle parental s’est activé et la scène a été bloquée. La mère a ici peur que sa fille se confronte à la réalité parfois brutale du monde et veut la préserver des chocs, pourtant essentiels à la construction de la psychologie. Si je ne suis pas un jour confrontée à des situations difficiles, comment puis-je apprendre à gérer mes émotions et à réagir en conséquence ?
Une démocratie à fleur de peau
Ce désir de protection est naturel : comment reprocher à la mère de vouloir préserver l’innocence de sa fille ? Mais à force de combattre les discours qui heurtent notre sensibilité, nous devenons à fleur de peau, c’est-à-dire que nous développons une sensibilité exacerbée. À fleur de peau signifie à la surface de la peau. Cette expression désigne la capacité qu’a un sujet de réagir à une sollicitation pourtant très faible. Nous avons d’ailleurs l’habitude de partager ce que nous ressentons, plutôt que de réfléchir à ce que nous ressentons. Nous partageons sur les réseaux sociaux cette sensibilité qui est la nôtre, avec notre communauté, dans un espace dans lequel nous nous sentons en sécurité. Les réseaux sociaux jouent même sur nos émotions : on like des posts, on réagit. Nous avons donc l’habitude de partager notre sensibilité, généralement avec des gens qui ont la même sensibilité que nous : d’où le terme de communauté, qui marque l’appartenance à un groupe selon nos affinités. La sensibilité nous lie ainsi à ceux qui nous ressemblent, et nous différencie de ceux avec lesquels nous n’avons rien en commun. La sensibilité est sur les réseaux un critère fondamental pour déterminer ce qu’est une communauté. C’est par la sensibilité que nous nous reconnaissons entre nous.
Ce critère de reconnaissance qu’est la sensibilité encourage le repli sur soi. Nous cherchons à préserver cette sensibilité, dans le plus de domaine possible. Aujourd’hui prolifèrent même ce qu’on appelle des « lecteurs en sensibilité ». Ce sont des individus qui sont consultés pour leur sensibilité. Lorsqu’un auteur écrit par exemple un roman sur les femmes, alors qu’il est un homme, son éditeur va consulter, s’il a peur de choquer, des lecteurs femmes, pour avoir leur avis concernant le contenu du texte. Ces personnes vont alors donner leur opinion, et dire si leur sensibilité a été choquée ou non. En fonction de leur diagnostic, certaines parties du texte seront éventuellement censurées. La peur de choquer peut alors l’emporter sur le désir d’exprimer notre sensibilité. Et à nouveau s’esquisse une hiérarchie qui concerne cette fois-ci la sensibilité. Mais au nom de quoi celle-ci aurait-elle moins de valeur que celle d’une autre ? Le rôle d’un auteur ou d’un artiste est-il de ne pas choquer, ou d’exprimer sa sensibilité, peu importe que celle-ci soit choquante ? Évidemment, l’objectif de l’éditeur est de vendre. Pour cela, il peut choisir de choquer pour faire le buzz, ou bien de consulter la sensibilité des personnes desquelles le texte s’inspire. Dans les deux cas, c’est la sensibilité du lecteur qui guide ce choix et pas forcément celle de l’auteur.
Une tension monte dans le débat public et certains arguments sont souvent convoqués pour empêcher la discussion. Ces arguments se basent justement sur les émotions ressenties : « je suis offensée par cette idée », « je suis choquée par ce dessin ». L’émotion semble être au fondement de notre jugement. On considère que le choc suffit à censurer l’autre, duquel on attend qu’il fasse preuve de neutralité. Mais qu’est-ce-qu’une telle neutralité peut bien signifier ? La neutralité désigne une forme d’objectivité : on attend un certain universalisme du discours humoristique, c’est-à-dire qu’il s’adresse à tous de la même manière, sans se concentrer sur les différences de chacun. J’exige que ce qui me heurte soit neutralisé. Mais un tel humour semble peu probable, car comme proposé plus haut, l’humour n’est pas universel, il a des frontières, notamment sociales.
Pourtant, on attend de l’autre qu’il taise son opinion si celle-ci est susceptible de choquer. Mais une opinion qui ne choque pas existe-t-elle vraiment ? La neutralité est-elle synonyme de tolérance ou d’indifférence au sort de l’autre ? Si la neutralité vise la neutralisation d’une idée incompatible avec ma sensibilité, alors elle n’encourage ni la tolérance ni le débat. Peut-être même qu’à force de protéger à l’extrême notre sensibilité, on finit par devenir intolérant à toute différence d’opinion. La censure de la sensibilité de l’autre ne résulte-t-elle pas d’une peur de la différence et d’une peur de notre différence ? En effet, si je n’arrive pas à accepter une opinion qui diffère a priori de la mienne, n’est-ce-pas parce que je crains que mes certitudes soient remises en question ?
C’est ce que constate Eric Weil dans La logique de la philosophie : selon lui, le débat est l’opposé de la violence, et le débat n’est possible que lorsque les individus acceptent le risque d’être « confondus », c’est-à-dire d’être contrariés. Aussi, en refusant le débat, ne sommes-nous pas en train de céder à cette violence qui nous effraie tant ? Le libre humour ne pourrait-il pas nous permettre de bâtir un pont pour accéder à l’autre mais aussi à nous-mêmes ? Car nous pourrions ainsi nous voir à travers les yeux de l’autre. L’humour pourrait en effet se révéler nécessaire à la cohésion sociale et constituerait une importante source démocratique. Car dans une société démocratique la libre expression nous permet de nous éveiller à l’inconnu. C’est cette prise de risque qui peut nous permettre d’être moins effrayé par l’autre et de nous concentrer sur la réalité collective. Le caractère commun de l’humour pourrait alors être dépassé pour dire quelque chose de l’humanité tout entière, et ainsi éviter de perdre notre diversité.