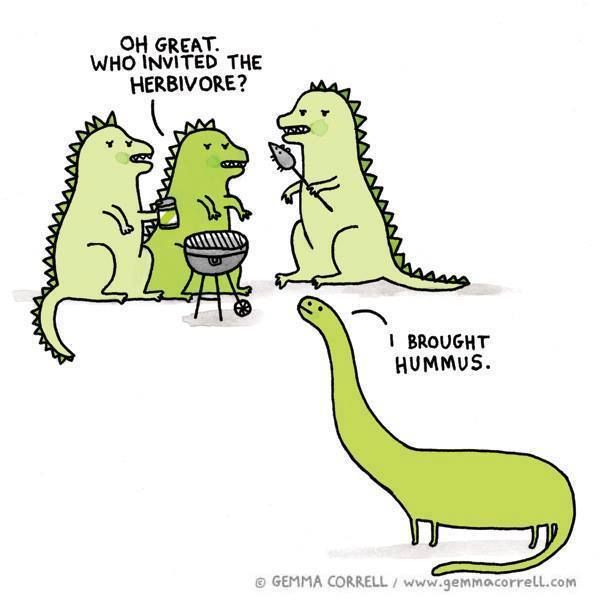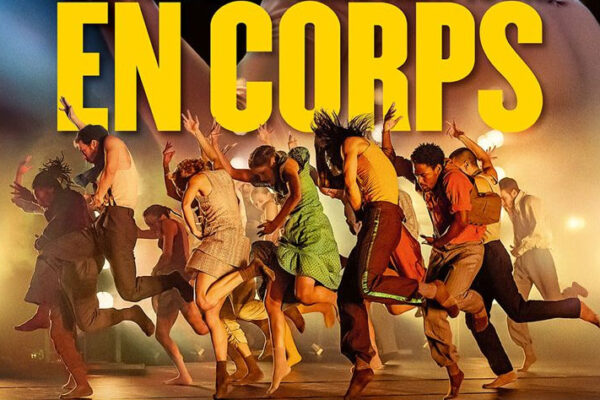Ça y est, la rentrée a déjà eu lieu depuis quelques semaines. Comme chaque année, après la parenthèse estivale et cette douce sensation d’un temps retrouvé, il a fallu se résoudre à reprendre le chemin du travail, souvent au pas de course. Voici revenue la folle cadence des rendez-vous qui s’enchaînent, des mails « urgents » auxquels il faut répondre sans tarder, des tâches que l’on s’efforce d’accomplir, l’une après l’autre, dans l’espoir de rayer enfin toute la to‑do list… laquelle semble mystérieusement s’allonger à mesure qu’on tente de la réduire.
Ce rythme peut être exaltant et galvanisant, un tourbillon vivifiant après un été qui en y repensant était finalement bien ennuyeux. Mais il peut aussi malheureusement devenir destructeur lorsqu’on ne fait que le subir et que nous sommes contraints à nous adapter sans cesse à un monde impermanent. Une course perpétuelle, épuisante, qui donne souvent l’étrange impression de stagner, et qui s’accompagne parfois d’un sentiment diffus de culpabilité : celui de ne jamais en faire « assez ».

Ce phénomène Lewis Carroll, romancier britannique du 19ème siècle l’avait déjà saisie. Dans De l’autre côté du miroir (1871), la Reine Rouge l’explique à Alice, tout essoufflée :
« Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu’on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça. »
C’est précisément cette logique de l’accélération permanente que le sociologue et philosophe Hartmut Rosa analyse dans ses travaux, notamment dans Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive (2010). Selon lui, l’une des grandes pathologies de nos sociétés contemporaines tient à cette accélération qui caractérise la modernité tardive. Une triple accélération : technique (les innovations), sociale (les normes et structures qui évoluent toujours plus vite) et du rythme de vie (le quotidien pressé).
Des causes multiples qui convergent vers l’accélération
Depuis le XVIIIᵉ siècle, la modernité repose sur l’idée de progrès constant : toujours plus d’innovation, de croissance, d’efficacité.
À cela s’ajoutent les nouvelles technologies comme les transports rapides, la communication instantanée et l’automatisation qui censées nous libérer du temps, créent sans cesse de nouvelles attentes et intensifient le rythme des échanges. Hartmut Rosa donne un exemple parlant : on a remplacé les lettres par les e-mails pour aller plus vite, mais le gain de temps s’est évaporé dans l’explosion du nombre de messages à traiter.
Enfin, le régime économique capitaliste accentue cette spirale en instaurant une compétition permanente : gagner du temps devient un enjeu économique. Résultat, pour rester « dans la course », il faut aller toujours plus vite.
Ainsi, l’angoisse du retard ou de l’obsolescence pousse individus, entreprises et institutions à s’adapter en permanence à des rythmes qu’ils ne maîtrisent plus. Tous ont l’impression d’évoluer sur une “pente glissante”, où s’arrêter reviendrait à reculer et ralentir serait prendre du retard, à l’image de ce cher Lapin Blanc, toujours pressé.
Plus nous voulons gagner du temps et plus nous en manquons
Dès lors, dans un monde obsédé par l’accélération et la performance, le temps devient un adversaire, et gagner du temps possède une valeur intrinsèque. On cherche à aller plus vite pour aller plus vite, sans même parfois même plus savoir pourquoi.
Mais alors paradoxalement, plus nous voulons gagner du temps, plus nous en manquons.
À la fois parce que cet engrenage nous plonge dans une dynamique où nous cherchons sans cesse à optimiser notre temps et faisons donc l’expérience de son manque, ce que nomme Hartmut Rosa la “famine temporelle”. Mais aussi parce que sous prétexte d’économiser du temps, nous avons perdu celui qui compte : celui qui donne du sens.
En effet, cette accélération transforme en profondeur notre rapport intime au temps. Lorsque chaque instant est mesuré, optimisé, saturé, il ne reste plus de place pour la maturation, l’imprévu, ou la créativité. Nous cessons d’habiter le temps, soit nous l’appréhendons comme une ressource, une matière première comme une autre qu’il s’agit d’optimiser, soit nous le subissons comme une force extérieure qui nous met au pas.
Hartmut Rosa parle alors d’aliénation temporelle : nous ne possédons plus notre temps, il nous échappe et nous ne pouvons plus nous reconnaître dans ce que nous faisons car nous obéissons simplement à cette injonction d’accélération. Cette aliénation n’épargne aucun secteur : cadres surmenés, travailleurs précaires, indépendants harcelés par leurs propres injonctions à la performance. Partout, l’illusion d’une productivité infinie épuise corps et esprits.
Prendre le temps de penser le temps
Le constat est clair, mais peut-on vraiment s’en extraire ? Peut-on quitter cette roue dans laquelle nous tournons frénétiquement comme des hamsters ? Rien n’est moins simple dans une société qui érige la vitesse en vertu cardinale. Pourtant, philosopher, c’est déjà ralentir. C’est se donner la permission d’interrompre le flot, de suspendre le mouvement, de questionner ce qui semble aller de soi. C’est commencer à retrouver la souveraineté de notre regard face à l’accélération généralisée.
Par ailleurs, peut-être que face à ce constat d’une accélération généralisée un premier pas pour se libérer de ce diktat de la vitesse consisterait à simplement accepter que nous ne serons jamais capables de « finir » la liste infinie des tâches, ni de vider une boîte mail qui se remplit à mesure qu’on la vide. Ce serait même sain car la vie déborde toujours nos tentatives de maîtrise.
Le stoïcisme peut ici offrir un éclairage salutaire. Il nous rappelle que nous n’avons pas à changer l’ordre du monde, qui ne dépend pas de nous, mais seulement nos représentations, qui, elles, sont en notre pouvoir. “Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu’ils portent sur ces choses”, selon Épictète. Plutôt que de nous épuiser à vouloir dompter le flot, où bien nous laisser submerger par les tasses de café, il s’agit d’apprendre à naviguer autrement. Comprendre que le temps ne nous appartient jamais totalement, mais que notre rapport au temps, lui, peut devenir un lieu de liberté intérieure.
Enfin, il serait aussi salutaire de distinguer et de discerner entre différentes modalités du temps.
Les philosophes grecs de l’antiquité et le Kaïros
Les Grecs distinguaient le kronos (le temps mesurable, des horloges, des deadlines) du kairos (le moment opportun).
Si, dans la mythologie grecque, le titan Kronos, averti qu’un de ses enfants viendrait à le détrôner, dévore ses enfants l’un après l’autre, le dieu Kairos, lui, est tout à fait différent. Ce petit dieu ailé est représenté sous les traits d’un assez étrange : il arbore une unique mèche de cheveux sur le front, le reste de son crâne étant rasé. Lorsqu’il passe près de nous, trois attitudes sont possibles : on ne le remarque pas ; on le remarque mais on n’agit pas ; ou bien, au moment précis où il passe, on tend la main, on saisit sa mèche et l’on attrape ainsi l’occasion au vol.
Cette image nous rappelle que saisir l’instant juste suppose d’être présent, disponible, attentif à ce qui advient. Or, comment percevoir ce moment si l’on vit sans cesse happé par l’urgence, obsédé par le gain de temps et prisonnier du rythme effréné de kronos ? Par ailleurs, saisir le moment juste demande parfois aussi de savoir attendre et oser ne pas précipiter nos gestes.
Bergson et le temps qualitatif de la durée
Enfin, Pour Henri Bergson, il convient de distinguer le temps quantitatif des physiciens, des horloges, fragmenté, mesuré et abstrait, du temps qualitatif et vécu qu’il nomme durée, un temps fluide, continu, intime, qui échappe à toute mesure.Ce temps intérieur façonne notre conscience, nos expériences, nos transformations. Dans le travail, cette durée est souvent sacrifiée au profit de l’urgence et de la performance. Pourtant, elle est indispensable pour créer, approfondir, écouter, laisser mûrir les projets et donner du sens à nos actions.
Bergson nous rappelle que le temps de la durée est incompressible : on ne peut pas précipiter la croissance d’une plante, ni forcer l’inspiration à surgir, ni contracter artificiellement le temps nécessaire à la compréhension ou à la décision. Ce temps fait partie de la nature même des choses, tout comme le tempo fait partie d’une mélodie : vous ne pouvez pas modifier le rythme ou écourter une mélodie sans en changer la nature.
Dans un monde à bout de souffle, où l’on nous presse d’aller toujours plus vite au risque de nous épuiser, il devient essentiel de repenser notre rapport au temps. Réapprendre à l’habiter dans toutes ses dimensions permet de recréer des espaces de présence, d’écoute et de maturation, des temps féconds qui nourrissent de meilleures décisions, une créativité libérée, et des relations plus solides. C’est ainsi que nous pouvons retrouver un avenir plus serein et désirable, où chaque instant se vit pleinement plutôt que d’être subi, et où l’art du contre-temps permet de retrouver un sens du swing précieux dans nos journées.