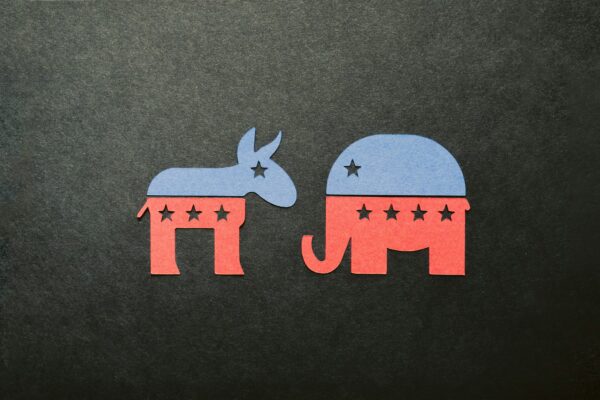Andreas Malm est maître de conférence en géographie en Suède le jour et militant écologiste la nuit. Après plusieurs ouvrages sur le lien entre le capital(isme) et les énergies fossiles et sur l’anthropocène, il s’interroge dans Comment saboter un pipeline (2020) sur sa pratique militante et, plus particulièrement, de mettre au travail la notion de violence à travers sa pratique. Quelles sont les (vraies) raisons de la non-violence militante contemporaine ? Quel type de violence serait plus acceptable qu’un autre, et à quelles conditions ? Rendre négative la violence contemporaine, est-ce négliger les héritages et les apprentissages des luttes passées – autrement dit, que diraient les militants d’autrefois en voyant nos manifestations ?
A travers une enquête ultra-documentée et écrite dans un langage on ne peut plus clair, Andreas Malm trace ici les contours d’une pratique, dont l’impact de dérangement pour les classes dominantes serait un poil plus important. Car, depuis les premiers temps écologistes – disons, les mouvements hippies des années 60 et l’émergence de la contre-culture aux Etats-Unis, le rapport Meadows (Un des premiers textes scientifique et économique, sorti au début des années 70, qui mettait en exergue les limites de la croissance), puis les différentes vagues du militantisme : il faut le dire, rien n’a bougé, ou (si) peu. “Il serait bien sûr complètement vain d’appeler [les classes dirigeantes de ce monde] à leur raison et leur sagesse (…) c’est le dévouement à l’accumulation infinie du capital qui l’emporte à chaque fois (…) c’est le business as usual” (p. 10-11). Alors, que faire ?
Annonce : loin de faire l’apologie de la violence, cet article a pour but de mener une réflexion sur celle-ci à travers le livre de Malm afin d’en comprendre philosophiquement les tenants et aboutissants. J’espère avoir rendu ce texte suffisamment agréable et accessible pour que vous considériez cette lecture comme digne d’intérêt et pour engager une réflexion vous même nuancée, contrairement à ce qu’on lit parfois ailleurs. Autrement, mes opinions n’engagent que moi ! Bonne lecture
Les points clefs « à retenir du livre » :
- La violence revêt de nombreuses formes qui ne sont pas égales en termes de souffrances (sabotage de yacht vs. agressions sur des personnes) et de conséquences.
- L’interdiction de la violence au sein des mouvements militants écologistes revient plus à une forme de puritanisme moral et de peur de la violence elle-même qu’au pragmatisme issu des apprentissages des luttes historiques.
- Il rappelle la dimension violente d’une part des catastrophes naturelles, qui sont indirectement ou directement liées aux crises écosystémiques actuelles, et d’autre part des inégalités, du niveau le plus local au niveau international.
Le livre en une question : Comment mettre en perspective le terme de violence pour considérer objectivement son impact sur le militantisme environnemental et social actuel ?
Un débat d’actualité chaude : notre contexte
Cette question est au coeur de notre actualité. Les récents événements portés par les Soulèvement de la Terre, notamment, ont fait grand bruit. Le gouvernement avait voulu dissoudre ce mouvement, puis le Conseil d’Etat l’en avait empêché (Le Conseil d’État suspend en référé la dissolution des Soulèvements de la Terre – Conseil d’État (conseil-etat.fr)). Sous-prétexte des violences commises par les militants, dixit l’Etat, le gouvernement évoquait la menace écoterroriste pour inquiéter la population, jouant sur un mécanisme de buzz tout en effrayant la population avec un terme pour le moins équivoque. A l’inverse, les chiffres de nombreux médias rapportaient que les terroristes, c’étaient plutôt les forces de l’ordre armées jusqu’aux dents sur place.
L’idée n’est évidemment pas ici de rejouer le procès ni l’historique des Soulèvements (cela a été fait ailleurs, voir l’article “Les Soulèvements de la Terre, le vent nouveau de la lutte écolo” sur le média reporterre.net) mais de mieux comprendre les enjeux de qualification autour de la violence militante. D’autres débats ont d’ailleurs lieu à l’heure actuelle au sujet d’autres cas : la construction de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, notamment. Malm fournit quelques clés de compréhension pour comprendre pourquoi il est devenu légitime, aux yeux de groupes militants, de saboter des pipelines… ou des bassines.
Une énigme…
Malm reprend un article publié dans la London Review of Books par le romancier et essayiste britannique John Lanchester. Lui se demande : “Comment se fait-il que les militants pour le climat n’aient pas (encore) commis d’actes terroristes ?” (John Lanchester, “Warmer Warmer”, London Review of books, 29, n°6, 2007, p. 3) L’essayiste met les pieds dans le plat : le terrorisme étant ce qui fait réagir le plus les gouvernements, jouant sur la peur des populations, appelant des réponses immédiates. Les militants seraient-ils trop gentils ? Trop éduqués, croyant aux vertus du dialogue ? Les militants eux-mêmes n’y croieraient-ils pas, à ce changement si désiré ? Les militants seraient-ils ancrés dans une forme de contestation politicienne, basée sur des discours et des actions symboliques ?
Des multiples raisons sont avancées pour ce déficit d’action dite violente. Car de multiples actions ont déjà eu lieu dans nos sociétés. Manifestations pacifiques – parfois pourtant lourdement réprimées -, placardage d’affiche, mouvements artistiques (clin d’oeil le bruit qui court) pro-écologie, fresque de sensibilisation… et en dehors du mouvement militant activiste : associations entrepreneuriales (Convention des Entreprises pour le Climat), labellisation d’entreprise (B Corp, Entreprise à mission), et d’autres. Pourtant, les COPS et les beaux discours s’enchaînent alors que de nouveaux projets de forages pétroliers émergent au même rythme que les super-yachts se construisent. Si de petites victoires ont été constatées dans ce mouvement, au global, les projets écocidaires de l’anthropocène semblent fleurir, les forces de l’ordre les protégeant. Et l’Agence internationale de l’énergie de noter “une divergence croissante entre les tendances actuelles et l’itinéraire à suivre pour atteindre les objectifs d’un réchauffement mondial de 1,5 ou 2°C maximum” (AIE, “Global Energy Investment stabilised above USD 1.8 Trillion in 2018, but Security and Sustainability Concerns are Growing”, iea.org, 14 mai 2019).
Le pacifisme comme stratégie théorique
Comment alors justifier de la non-violence des actions militantes ? Malm se pose la question en revoyant d’abord deux conceptions du pacifisme, puis l’héritage des luttes du passé. Tout d’abord, le pacifisme moral rend illégitime toute action violente – même la légitime défense. Ainsi, tout acte violent serait injuste, même s’il permettrait d’éviter bien plus de souffrance. Expérience de pensée : aurait-il fallu par la violence empêcher Hitler de commettre ses crimes ? Le pacifisme moral postule que non ; on voit bien que cette position est intenable éthiquement. Cela remet même en question notre conception de la justice qui est basée sur l’acceptation d’une forme de violence légitime de l’Etat pour garantir la possibilité d’une paix sociale. Le mouvement militant serait-il moins radical que l’Etat lui-même ? C’est fort probable…
Mais revenons à nos moutons en examinant le pacifisme stratégique. Revendiqué par nombreux mouvements, comme Extinction Rebellion notamment – un mouvement dont Malm reconnaît la puissance aujourd’hui en termes d’influence et de recrutement. Selon Roger Hallam, fondateur du mouvement XR : “la violence détruit la démocratie et détruit les rapports avec les adversaires qui sont vitaux pour trouver des issues pacifiques au conflit social” (Roger Hallam, “The civil resistance model*”,* in Clare Farell, Alison Green, Sam Knights and William Skeaping (ed.), This is not a drill: An Extinction Rebellion Handbook, Londres, Penguin, 2019). Il s’appuie sur des études en sciences sociales pour avancer son propos, formel. Toute violence serait antiprogressiste et irait à l’encontre des valeurs démocratiques et de progrès.
Apprendre des luttes passées
Ces études sont la cible de Malm, qui s’attèle alors à reprendre les histoires des luttes passées en multipliant ses sources : anti-escalavagisme puis mouvements civiques pour les droits des Noirs aux USA, les suffragettes, Gandhi en Inde, l’Apartheid en Afrique du Sud… Chacun de ces mouvements, présenté comme succès des approches non-violentes par tant de littérature, sont en réalité des mirages. Car la fin de l’esclavage a eu lieu après des révoltes violentes ; les suffragettes ont détruit des biens matériels pour leurs droits (en parallèle, bien sûr, des mouvements plus conventionnels comme les manifestations ou l’édition autonome de journaux) sans faire jamais aucune victime humaine ; Gandhi, pour gagner la confiance des anglais, leur livra des soldats pour les tranchées ; le mouvement des droits civiques aux USA menait, lui aussi, sit-ins, marches, boycott de bus… tout en se protégeant avec des armes des assauts des Klu Klux Klan.
Malm évoque alors le centre de sa réflexion : les mouvements cités n’ont pu aboutir dans le dialogue avec les institutions, les États, à un progrès social, que parce qu’un flan radical, violent par son sabotage, forçait la main de l’autre côté, instaurant une forme de pression nécessaire à l’aboutissement, créant une forme d’urgence à l’action de la part des gouvernants. L’action non-violente n’aboutit que parce qu’elle peut glisser facilement vers une situation intenable de violence ; la destruction des biens constituant dès lors une forme d’alarme pour les classes dirigeantes. Même Nelson Mandela, icône bien-aimée des idéologies non-violentes, confronté à l’inefficacité des actions non-violentes, avouait dans son autobiographie reconsidérer cette question.
Penser en stratège objectif
Pour Malm, le pacifisme stratégique doit donc rester une stratégie, et non un dogme : la désobéissance civile est une tactique qu’il faut savoir quitter si elle n’atteint pas ses objectifs. Y’a-t-il donc des raisons de croire que la lutte écologiste actuelle est si spécifique qu’elle doive reculer devant tout type de violence ? Car la situation actuelle semble être pire à bien des égards, la menace étant l’annihilation de la biodiversité et de la possibilité de vivre dignement pour toutes et tous, notamment ; elle reproduit par ailleurs des schémas d’inégalité massive (les plus riches étant au centre de la menace pour la majorité des autres).
Nuancer les positions sur la violence semble donc être le plus pertinent compte-tenu des luttes passées, de la créativité militante d’un côté, et de l’immobilisme de la situation de l’autre. Deux chercheurs historiens des transitions démocratiques posent que les transformations sociales sont le résultat, le plus souvent, d’actions de groupes ayant commencé par des actions non-violentes, qui, désemparés, finissent par organiser le sabotage, avec les moyens du bord : c’est la “violence collective non armée” : celle-ci déstabilise l’ordre civil et élève le coût du pouvoir pour le régime. (Mohammad Ali Kadivar & Neil Ketchley, “Sticks, Stones and Molotov Cocktails: Unarmed Collective Violence and Democratization”, Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 4, 2018, p. 1-16). Un exemple pour les militants actuels, qui font valoir un autre argument massif : la notion d’urgence.
Considérations sur les types de violence
Celle-ci est d’autant plus constatable au niveau des luttes locales – un exemple très parlant est celui de la ZAD de Notre Dame des Landes contre le projet de construction de l’aéroport. Mais cette urgence est évidemment palpable partout sur la planète où l’extractivisme ou la pollution ont des conséquences très directes sur les vivants. Alors les militants se dotent d’une argumentation pour faire valoir leurs positions : la véritable violence vient des infractions commises à l’encontre des vivants, animaux, végétaux, humains ; le sabotage, à l’inverse, ne vient que contrecarrer la possibilités d’émettre des Gaz à Effets de Serre. Ces actes sont évidemment violents, tout comme les actions de destructions de vitrines commises lors de manifestations. Cela n’est pourtant pas du terrorisme, si l’on s’accorde sur le sens de ce mot, mais s’apparente bien plus à du vandalisme.
Malm indique cependant, si l’on doit reconnaître cela, que cette violence est d’un autre type que celle qui frappe un humain ou un animal, pour la raison suivante qu’il est impossible de faire souffrir une vitrine ou un pipeline. Chez Martin Luther King : “Violentes, certaines [émeutes de 1967] l’ont certainement été. Mais la violence s’est infiniment plus déchaînée contre la propriété que contre les personnes. (…) pourquoi les émeutiers étaient aussi violents contre la propriété ? Parce que la propriété représentait la structure du pouvoir blanc qu’ils essayaient de détruire” (King Jr., A testament, 1968). Et il faudrait donc encore reconnaître que la violence qui empoisonne une nappe phréatique vitale pour des populations soit du même type moral que celle qui empêche le projet qui la détruira.
En conclusion…
Malm remet au travail, au niveau théorique et pratique, le concept de violence. Fort de son expérience militante personnelle et par son analyse de sources contradictoires et protéiformes – journalisme, sciences sociales, récit autobiographique, manifestes… – il se permet d’encourager des stratégies militantes mixtes, combinant des actions non-violentes comme les manifestations, marches, grèves ou les performances artistiques, tout en légitimant d’autres types d’actions où la violence s’oriente vers les biens matériels. Aujourd’hui, il emprunte au philosophe décolonial Frantz Fanon l’idée de violence qui désintoxique (Frantz Fanon, Les damnés de la Terre, Paris, La découverte, 1961
) pour rétablir l’idée que contre le désespoir actuel entraîné par la situation climatique planétaire, une violence légitime peut s’exercer contre les infrastructures qui capturent la valeur et empêchent la vie sur terre. Une violence sans souffrance des vivants, mais salvatrice.
Pour aller plus loin :
Comment saboter un pipeline ? aux éditions La Fabrique