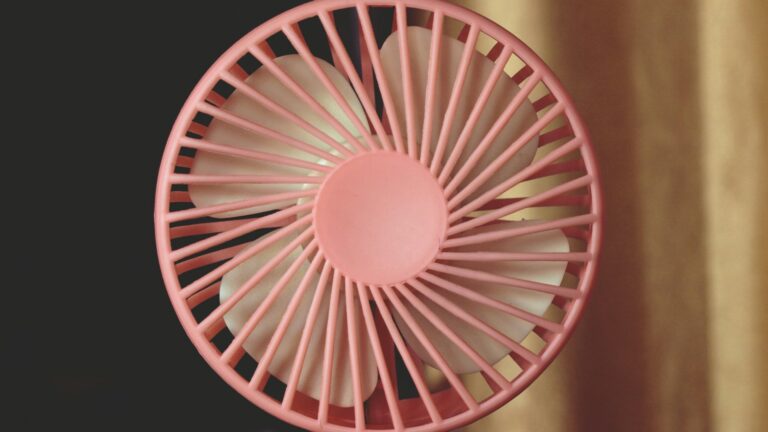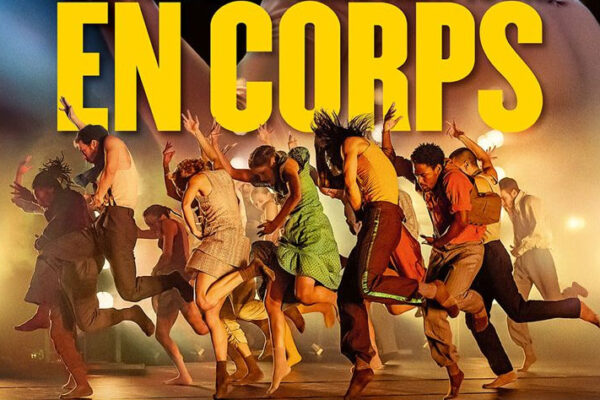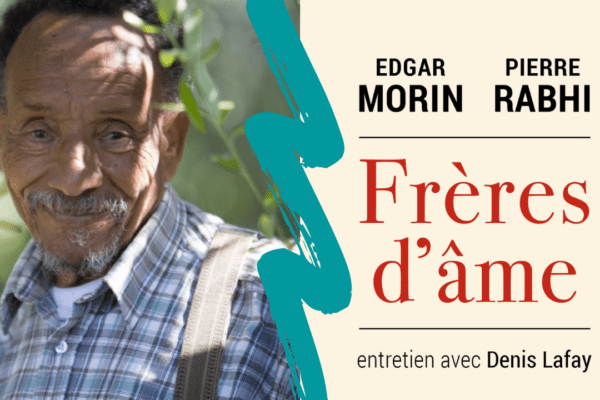Parmi les objets que nous avons acquis ces derniers mois, combien sont véritablement indispensables ? Combien d’entre eux ont réellement trouvé leur place dans notre quotidien ? La question de l’utilité est fondamentale dans notre rapport à la consommation, car, en règle générale, nous cédons à l’achat de produits dont l’utilité reste soit marginale, soit éphémère. Il devient alors légitime de se demander pourquoi nous achetons ces objets, souvent conscients de leur caractère limité, voire inutile. Leur prolifération soulève des interrogations sur l’impact de cette consommation sur nos relations humaines et sur notre rapport au monde. La société de consommation, loin de favoriser l’unité, met en compétition des individus qui, bien que tous en quête de possessions, sont de plus en plus isolés dans leur désir de satisfaire leurs envies. Le gadget, objet détaché de tout lien véritable avec l’autre, devient un symbole de cet individualisme croissant.
L’avènement du gadget : l’émergence d’un nouveau monde
D’après le Larousse, le mot provient de l’américain « gadget » qui signifie truc. Cette origine fait ressortir le flou du terme. En effet, quoi de plus vague et d’indéterminé qu’un « truc » ? D’emblée, on perçoit que le gadget est quelque chose qu’il est difficile de nommer, de classer, d’identifier. Il est porteur d’une dimension subjective susceptible de varier en fonction des époques et des individus. Qui peut décréter ce qui est utile et ce qui ne l’est pas ? Le gadget d’aujourd’hui sera-t-il l’objet indispensable de demain ? Comment la société façonne notre rapport à ce qui relève du nécessaire et ce qui appartient au registre du futile ?
La satisfaction des besoins primaires, illustrée par la pyramide de Maslow, a longtemps constitué le fondement de notre rapport à la consommation. Cependant, avec l’avènement du capitalisme, nous avons assisté à une déconstruction organisée des valeurs qui encadraient autrefois la production. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant lorsqu’il s’accompagne d’une forme de mépris du passé, où les fondations solides construites par nos ancêtres sont dévalorisées au profit de la quête incessante du neuf. À cela s’ajoute la révolution technologique, qui, bien qu’ayant permis de grands progrès, a aussi participé à l’édification de cette société du gadget. Le gadget technologique, qu’il s’agisse de nouveaux smartphones, objets connectés ou applications diverses, devient un moyen de combler un vide intérieur, un substitut à un projet collectif qui semble s’effacer peu à peu sous les coups de la consommation individuelle. C’est dans ce contexte de crise démocratique et de démostalgie que l’idée même de gadget prend tout son sens : un produit inutile, mais dont la possession symbolise un pouvoir et une appartenance à une société qui se détourne de toute finalité collective.
Les symptômes d’une société du vide
L’un des symptômes les plus évidents de cette société du gadget réside dans l’omniprésence des réseaux sociaux, véritables incubateurs de solitude et de misère du temps. Ces plateformes, loin d’être la cause de la souffrance ressentie, en sont plutôt le palliatif. Elles jouent un rôle de refuge, un médicament quotidien dans une société où les repères ont disparu. En voulant « nous connecter », nous nous isolons, pris dans une logique de compétition constante, où la valeur de l’être humain se mesure au nombre de followers ou à ses likes.
Par ailleurs, le gadget s’est imposé comme un substitut à la relation humaine authentique, la rencontre entre individus étant de plus en plus conditionnée par des plateformes où la relation devient contractuelle. Le monde des gadgets, par cette contractualisation des interactions humaines, marque la fin de toute légèreté dans nos rapports sociaux. Cette culture de l’avoir, soutenue par la mode et le mimétisme, valorise l’acte de possession au détriment de la relation authentique et du partage.
Pour un retour à l’essentiel
Une première forme de résistance consisterait à renouer avec une radicalité saine, en revenant à nos racines et à ce qui fait notre essence. Il s’agit d’opérer un retour à l’essentiel, en se libérant des fardeaux inutiles que la société de consommation impose. Cette approche rejoint une éthique de la frugalité, du besoin plutôt que du désir aveugle.
Une autre piste de résistance passe par l’éthique des plaisirs gratuits. Repenser le bonheur non pas comme un bien à acquérir, mais comme une expérience simple, gratuite, partagée. Cela implique également de revaloriser le temps. Enfin, l’amour, cette valeur fondamentale des sociétés humaines, doit primer sur l’amour du gadget. Le véritable lien social ne peut se bâtir que sur des relations humaines sincères, fondées sur la confiance, le respect et l’empathie.
La société du gadget, en nourrissant une consommation effrénée et un individualisme exacerbé, menace de détruire les bases mêmes de notre humanité. Pour nous en libérer, il est urgent de remettre en question nos priorités et de réinventer un mode de vie où l’essentiel l’emporte sur le futile, où l’être humain retrouve sa place au centre de la société, au-delà des objets qu’il consomme. Il ne s’agit pas de rejeter la technologie ou le progrès, mais de les remettre au service d’un projet collectif authentique, fondé sur des valeurs partagées et un respect mutuel.
L’être et pas l’avoir ?