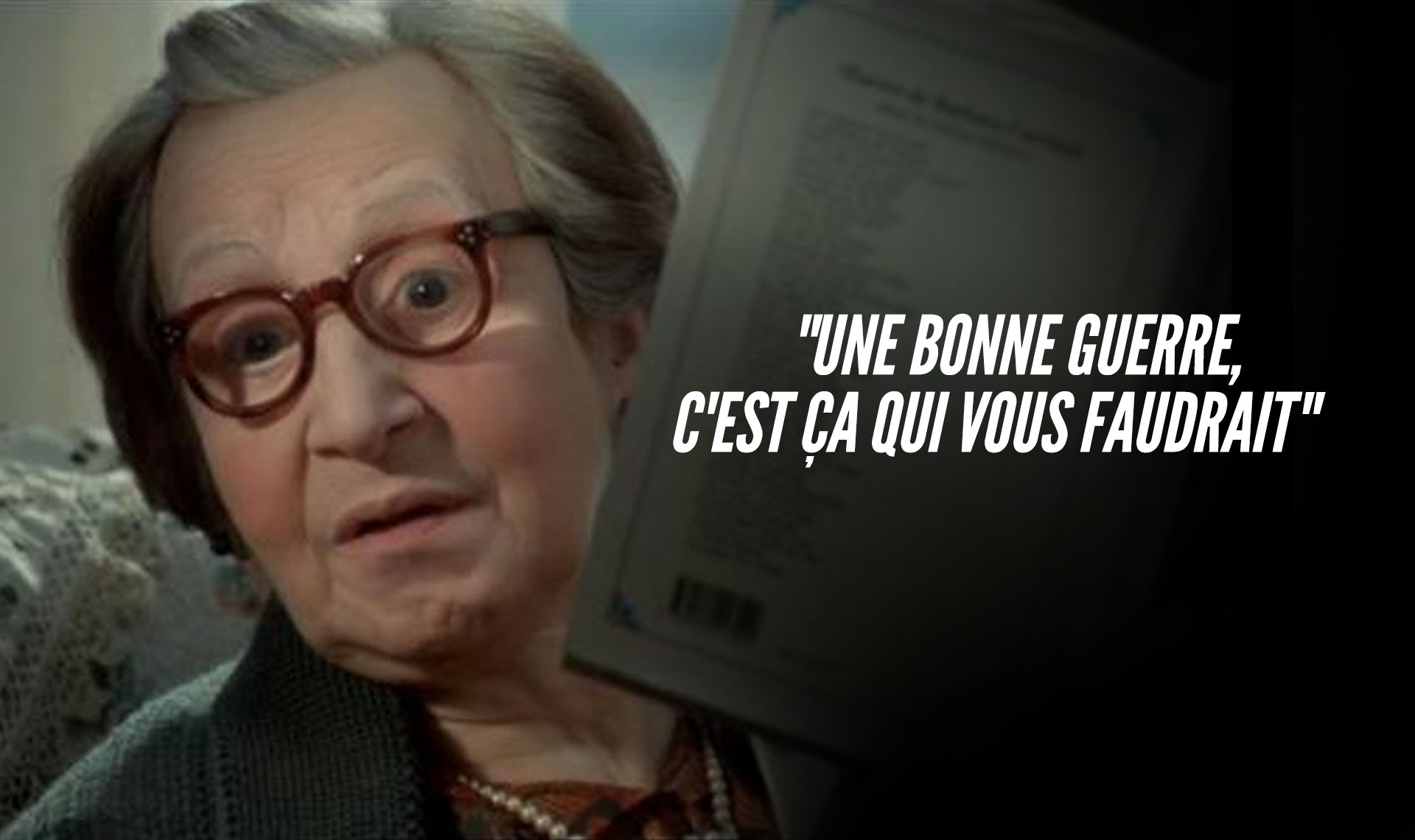Souvenez-vous… c’était l’été et les yeux du monde entier étaient tournés vers Paris, lorsque un certain chanteur s’est mis… à chanter (!), sur les Champs-Elysées…
« Est-ce qu’il y aurait des guerres si on était resté tout nu ? », telle est la question par laquelle Philippe Katerine débute son titre « Nu », devenu un des moments-phares de la soirée d’ouverture des Jeux Olympiques 2024, à Paris.
Tandis que les uns ont loué la performance, que d’autres ont crié au scandale, que d’autres encore en ont fait un dessert et que beaucoup, de part et d’autres, en somme, se sont écharpés à ce sujet, attirant l’attention de l’opinion publique sur le polémique, il semble être passé inaperçu que ce titre donnait prise à une réflexion au moins intellectuelle, et même philosophique… laquelle réflexion philosophique ne date d’ailleurs pas d’aujourd’hui, mais a été menée dès la modernité – XVIème siècle.
Quand Katerine parle de « rester tout nu » ou de « redevenir tout nu », il vise cet état d’existence que les philosophes appellent « l’état de nature », par différence d’avec « l’état civil (l’État) ». Alors que le second renvoie à l’existence telle que nous la connaissons, c’est-à-dire prise dans les mailles d’une culture particulière, l’état de nature désigne un mode d’existence conduit par le naturel, plutôt que le culturel, c’est-à-dire un état où les individus ne seraient soumis à aucune règle sociale et où seulement la “loi du plus fort” règnerait sur les pulsions et besoins des uns et des autres .
Or, affirmer qu’ « il n’y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu », c’est postuler que l’état de nature offrirait une existence pacifique – et, de fait, préférable, car meilleure ? – contrairement à l’état civil qui serait un état belliqueux.
Cela étant, quelle caractéristique de l’état de nature permettrait de le considérer comme garant d’un état pacifique ? C’est en tout cas sur cette caractéristique que s’appuierait la représentation d’une nature bonne et vertueuse, gage d’une vie meilleure et donc préférable à la vie civile – c’est ce que postule « Nu », d’après notre écoute des paroles. Pour autant, l’examen de cette représentation conduit à en souligner le caractère relatif et, même, à la reléguer au rang de mythe, pour affirmer que cela même sur quoi elle fonde la garantie de l’état pacifique serait plutôt vecteur des conflits propres à un état belliqueux.
« Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu » : la nudité, gage d’égalité
« Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu […] / Qu’on soit slim, qu’on soit gros, on est tout simplement tout nu […] ». La nudité effacerait non pas certes les différences – les multiples morphologies, par exemple – mais les distinctions sociales – comme les disparités économiques, par exemple, c’est-à-dire les inégalités.
S’il est des différences naturelles entre les uns et les autres – comme la taille, la corpulence, la couleur de cheveux, la carnation ou encore le sexe, il n’empêche que le cadre social instigue des différences supplémentaires : les distinctions, au premier rang desquelles se trouvent les distinctions socio-économiques.
Alors que les différences sont naturelles et n’instaurent pas d’inégalités entre les individus, les distinctions sont culturelles et ouvrent la voie à des inégalités entre les individus humains : les distinctions sont infondées en nature.
C’est là ce que souligne Montaigne, au chapitre 42 (« De l’inégalité qui est entre nous ») de ses Essais (1580) : « là où nous pensons avoir affaire à un paysan et un roi, à un noble et un roturier, à un magistrat et un homme ordinaire, à un riche et un pauvre, nous croyons être en face d’une extrême diversité, alors qu’ils ne sont différents, pourrait-on dire, que par leur costume ».
Quoique « ils ne [soient] différents […] que par leur costume », il n’empêche que nous prenons bien les distinctions pour critère de jugement, lorsqu’il s’agit d’estimer la valeur d’un individu. Ce constat conduit Montaigne à poursuivre en soulignant qu’il est alors bien étonnant de nous juger les uns les autres non d’après notre nature véritable, c’est-à-dire d’après ce que nous sommes indépendamment de l’influence de la vie en société, mais plutôt à partir de nos apparats sociaux, qui, in fine, sont superflus.
Tandis que pour marchander un cheval, « vous lui ôtez ses harnais, vous l’examinez nu et à découvert », il sera dit d’un homme qu’ « il mène grand train, a un beau château, tant de crédit et tant de rente » alors même que « tout cela lui est extérieur, et non en lui-même », c’est-à-dire constitue son existence sociale et non sa nature véritable.
Dès lors, « pourquoi, pour juger un homme, le jugez-vous tout enveloppé et comme empaqueté ? », questionne rhétoriquement Montaigne.
Par cette réflexion, Montaigne attire notre attention sur le caractère trompeur des apparats sociaux, qui nous leurrent sur la nature véritable : par la parure sociale dont il se vêt, l’individu « prend soin de ne nous montrer que les éléments qui ne sont pas les siens », c’est-à-dire de mettre en avant ses attributs acquis socialement et, donc, accidentellement, « et nous cache ceux par lesquels seulement on peut vraiment estimer la valeur », c’est-à-dire ses attributs essentiels, qui constituent sa nature réelle.
Ainsi la société pervertirait la nature humaine – peut-être au sens moral (comme le propose Rousseau, plus tard) mais d’abord au sens strict d’ébranler et renverser un ordre établi. En cela, Katerine, comme Montaigne, incite au dépouillement de caractéristiques superflues : les attributs sociaux.
Mais à quelle(s) fin(s) se dépouiller de cette couche superflue ? Dé-couvrir la nature humaine, oui, mais quelle est-elle ? L’homme est-il meilleur en nature qu’en société ?
« Vivons comme on est né / Nu, tout simplement tout nu » : le mythe du bon sauvage
Sous-jacente à l’idée que les caractéristiques sociales et sociétales sont superflues et pervertissent l’homme pour ce qu’elles travestissent sa nature réelle, il y a l’idée selon laquelle une existence à l’état de nature serait meilleure, au motif que la nature humaine s’épanouirait sans fard aucun.
Quand on cesse de se prendre au jeu, la mascarade sociale paraît alors ridicule : pourquoi accorder tant d’importance à cela-même qui est dérisoire et si peu fondé en nature ? Pris dans ce jeu, nous serions pareils « à des singes sous des manteaux / des pélicans avec des chapeaux », chante Katerine. Voilà qui serait « nul / tout simplement tout nul » : laquelle idée invite à penser que, en regard d’une existence civile, une existence naturelle serait si ce n’est meilleure, du moins préférable.
Il transparaît alors, en filigrane des paroles, ce que l’histoire de la philosophie désigne par « le mythe du bon sauvage ». L’idée est simple : la vie en symbiose avec la nature serait préférable, tant moralement qu’existentiellement, à la vie en société, car non-pervertie par des préoccupations inessentielles et, donc, plus pure ou authentique.
Montaigne est un de ceux qui ont cette vision de la vie en harmonie avec la nature, laquelle est transmise entre autres par les récits de voyages (comme celui de Jean de Léry : Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil). Ainsi, au chapitre 31 de ses Essais (« Des cannibales »), Montaigne montre que la barbarie n’est pas tant du côté de la vie naturelle alors qualifiée de « sauvage » que du côté de la vie civile ; en les termes de notre propos, cela revient à soutenir que la vie à l’état de nature est préférable, car meilleure (sous plusieurs aspects), à la vie à l’état civil.
Ah qu’elle serait agréable la vie si l’on était « nu, tout simplement tout nu », pareils aux hommes et femmes de l’âge d’or ; regardez donc les représentations de cet âge par Hésiode, en littérature, ou Cranach, en peinture, par exemple ! Toutefois, est-on bien sûr de cela-même ?
Il ne nous échappera pas que cette vision louangeuse de la vie « sauvage », en harmonie avec la nature, demeure dans l’histoire de la philosophie accolée au terme de « mythe ». Dès lors, cette vie à l’état de nature comme vie paradisiaque ne serait-elle pas une histoire qu’on se raconte ? une illusion dont on se berce ?
Quand bien même « on [serait] toutes sœurs et frères quand on est tout nu », serait-on pour autant assuré qu’ « il n’y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu », tel que le laisse penser les paroles et le ton de Katerine dans son titre ?
« Il n’y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu » : l’état de nature, un état sans conflits ?
Que l’état de nature assure une égalité par-delà les différences que les distinctions sociales n’assurent pas forcément est une chose ; mais que l’assurance de cette égalité garantisse l’absence de tout conflit, armé ou non, voilà qui doit être questionné plutôt qu’affirmé sans hésitation.
En effet, s’il n’y a plus de distinctions, nul n’est plus légitime qu’un autre à occuper telle ou telle fonction : le propriétaire n’est pas plus légitime d’avoir en sa possession son bien que le voleur. Or, de là découle un rapport belliqueux entre les individus : l’état de nature est alors un état de guerre de chacun contre chacun. C’est cette représentation de l’homme au naturel que rend l’illustration placée au frontispice du Léviathan (1651), de Hobbes : tandis que l’état civil est un état si ce n’est de paix du moins d’ordre, où la sécurité est assurée aux hommes-citoyens, l’état de nature est un état de désordre, où chacun représente une menace pour chacun.
Pourtant, l’état de nature n’est-il pas un état où tout un chacun est égal à chacun ? Si ; et, c’est précisément pour ce que chacun est égal à chacun que s’échafaude un état belliqueux, où chacun représente une menace pour chacun et où règne l’ordre du plus fort.
Pour ce que, en nature, les hommes sont égaux, naît entre eux de la défiance : ils prétendent avec la même ambition à la satisfaction de leurs besoins et désirs : « de cette égalité des aptitudes découle une égalité dans l’espoir d’atteindre nos fins », écrit Hobbes (Léviathan, I, 13).
Dès lors, si deux individus ont besoin ou désirent le même objet, l’un et l’autre aura, en nature, non seulement la même prétention mais encore la même légitimité à l’obtenir.
De là s’engage alors un rapport de force, qui devient une relation belliqueuse – « dans leur poursuite de cette fin […], chacun s’efforce de détruire ou de dominer l’autre », poursuit Hobbes.
En somme, s’il est bien vrai qu’il n’y a « plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu », croire que « [non], il n’y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu » s’avère être une chimère : c’est précisément pour ce qu’il n’y a « plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu » que s’instaure un état belliqueux, des suites de la défiance entre les individus qu’engendre une stricte égalité.
Quand bien même la nudité s’avère peu propice à porter un revolver, comme le rappelle Katerine sur un ton presque goguenard – « Où cacher un revolver quand on est tout nu ? / Où ? / Je sais où vous pensez / Mais… / C’est pas une bonne idée / Ouais » – il n’empêche que cette nature soi-disant gage d’une existence pacifique se révèle être une illusion, dont il semblerait qu’on se berce pourtant volontiers.
N’aurait-on alors qu’à se rhabiller, pour ainsi dire ? Faudrait-il arrêter de penser cette vie chimérique ? Rien n’est moins sûr si, à la manière dont Nietzsche l’évoque dans le Gai savoir, on songe qu’il est des illusions ou erreurs utiles.