» Il est vide le discours du philosophe qui ne soigne aucune affection humaine. De même qu’une médecine qui ne chasse pas les maladies du corps n’est d’aucune utilité, de même aussi, une philosophie, si elle ne chasse pas l’affection de l’âme «
Épicure, Fragment Usener 221 (témoignage de Porphyre), trad. A. J. Voelker, in La philosophie comme thérapie de l’âme. éd du Cerf , 1993, p. 36.
Vous avez dit… « thérapie » ?
Depuis maintenant quelques dizaines d’années, la philosophie est sortie des bancs scolaires et universitaires pour entrer dans l’espace publique. Cafés philo tout d’abord, puis consultations philosophiques, ateliers philo pour enfants, consulting aux entreprises, coaching philosophique, enfin « philothérapie ». Etrangement, la “philo pratique” a d’abord essuyé un certain nombre de critiques sur un prétendu “travestissement” lié à son nouvel intérêt actionnel et pragmatique. Il aurait fallu qu’elle en reste à une recherche purement désintéressée, vierge de tout intérêt pratique et de toute visée utilitaire. Aujourd’hui, il semble plus acceptable et légitime d’utiliser l’outil philosophique de manière pragmatique – non pas seulement comme une fin en soi, mais aussi comme un moyen, pour faire un pied de nez à Kant. Mais il semble beaucoup plus délicat d’accoler à la philosophie le vocable de la thérapie. Et ceci provoque un certain nombre de débats, à l’intérieur et à l’extérieur du « monde » de la philosophie. Dans cet article, je souhaite analyser ces débats, et donner mon avis très partial sur la question (me définissant moi-même comme “philothérapeute”).
Tout d’abord, comme toute « thérapie » dite « non-conventionnelle », la philothérapie est résolument dans le viseur de deux organismes gouvernementaux :
- la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (Miviludes),
- et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
J’ai été moi-même inspecté par la DGCCRF il y a deux ans (j’y reviendrai dans quelques lignes), et je dois dire que j’avais en tête l’audition de Christian Flèche, père du « décodage biologique » (une discipline qui tente, par le dialogue, de donner du sens aux maladies psycho et physiologiques), par une commission d’enquête menée par Jacques Mézard, rapporteur au Sénat. C’était en 2015 :
- « Pouvez-vous dire que ce que vous faites, le “décodage biologique”, est de la thérapie ? »
- « Heu, oui, en un sens oui. J’écoute les personnes qui viennent me voir, je prends soin d’elles, je cherche à comprendre avec elles le sens que … »
- « Non, M. Flèche, soyons clairs : thérapie veut dire « soigner », pas « écouter », et cela est réservé aux médecins, un point c’est tout. »
(Vidéo entière : Audition de Christian Flèche, formateur en décodage biologique – YouTube)
Le ton est péremptoire, l’écoute peu présente, du côté de la commission d’enquête. Il faut dire que depuis une dizaine d’années, sur la cinquantaine de disciplines « parallèles » ou « alternatives » (naturopathie, réflexologie, Reiki…) qui ont été contrôlées par la DGCCRF, que ce soit au niveau des séances proposées par les professionnels que de leurs formations, un taux « d’anomalie » de 66 % a été constaté. Anomalies par rapport à quoi ? Il s’agit en général de pratiques commerciales trompeuses, de promesses de résultats impossibles à garantir, ou de défauts d’information précontractuelle. Un taux relativement élevé, et qui porte la plupart du temps sur la campagne publicitaire que font les « thérapeutes » sur leur site. Guérison garantie, changements spectaculaires, meilleurs résultats que la médecine traditionnelle, etc. Quand l’inspectrice de la DGCCRF vient me voir en 2021, elle a déjà visité mon site et s’est renseignée sur mon activité. La plus grosse partie de son travail est déjà effectuée, mais elle tient quand même à savoir si mon discours est en cohérence avec mon site. Elle cherche notamment à savoir quel usage je fais du concept de “thérapeute”, puisque je l’utilise dans l’objet-même de mon entreprise et un peu partout dans ma communication. Je lui explique ce que j’ai écrit noir sur blanc sur mon site.
Selon moi, pour mieux comprendre l’enjeu que revêt l’appellation « thérapeute », il convient de revenir à la racine du concept de thérapie, dans la Grèce Antique. En grec ancien, la θεραπεία, therapeía (« cure ») est dérivée du verbe θεραπεύω, therapéuô (« servir, prendre soin de, soigner, traiter »), lui-même issu de θεράπων, therápôn (« serviteur »). Cela peut paraître un peu redondant, mais j’insiste sur le fait que la racine du concept de thérapie s’ancre dans le “service”, dans le “soin”, avant d’être nécessairement lié au fait de “soigner” ou de “traiter” une maladie. Le service ne concerne pas nécessairement une personne malade, puisqu’il prend chez les grecs deux directions – dont la seconde semble avoir été oubliée : le soin des humains (dans la cure), ET le soin des Dieux (dans le culte). Et paradoxalement, le soin des Dieux revient toujours dans les analyses étymologiques comme la première direction qu’emprunte la thérapie, du moins chez les grecs. Les religieuses appelées « thérapeutrices » prennent soin des statues des dieux, et elles se chargent de maintenir une bonne relation entre les hommes et les dieux. Elles ont décidé de se consacrer au service des Dieux, et ce n’est pas la maladie qui est l’objet de leurs soins attentifs : c’est de la bonne santé – d’une relation – qu’elles entendent prendre soin, jour après jour.
Prendre soin n’est pas forcément soigner
Il en va de même de la seconde direction de la thérapie, celle qui a trait à la médecine et non plus à la religion. Pour Hippocrate, le plus connu des médecins antiques, la bonne santé requiert un soin tout particulier et quotidien : celui de la préservation de l’équilibre des humeurs (c’est ainsi que sont nommés les quatre grands fluides corporels que sont pour le médecin grec le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire, correspondant respectivement aux quatre éléments que sont l’air, l’eau, le feu, et la terre).
Sans rentrer dans les détails physiologiques fort instructifs de cette conception homéostasique, il convient juste de remarquer ici que le soin n’a pas pour fonction première de réparer mais de préserver, de prévenir. La maladie est en effet une rupture d’équilibre du corps, liée à l’excès d’une des humeurs (occasionnant et/ou provenant du défaut d’une autre). Ce que la mal-a-die nous dit – pour jouer utilement sur les maux – c’est qu’un des besoins du corps n’a pas été bien compris, soit en le satisfaisant à l’excès, soit en oubliant de le satisfaire. Le soin, c’est donc l’attention que l’on porte au be-soin et à sa juste régulation. D’ailleurs, sur ce point encore l’étymologie est bluffante, puisque le terme « besoin » provient du francique « bisunnia » formé à partir du préfixe germain « bi- » signifiant « auprès » et du radical « sunnia » signifiant le soucis (le fait de se soucier) ou le … soin !
Le thérapeute serait donc celui qui prend soin de nos besoins et de leur équilibre, en veillant à la bonne régulation des fluides et des humeurs ? Comme le culte aux Dieux, la cure n’est pas forcément réparatrice : le jeûne ou la cure thermale en sont les preuves les plus flagrantes ; et c’est tout à fait dommageable que l’on attende souvent d’être malade pour y avoir recours. Une idée qu’exprime très bien Coline Serreau dans son film La Crise en 1992 :
Ce qu’il faut retenir de tout ceci – dis-je à mon inspectrice – c’est que dans les 2 cas (culte et cure), le dénominateur commun est le soin, le service. Le thérapeute prend soin de l’autre, qu’il soit humain, Dieu ou même animal ou végétal. Dans la racine-même du terme de soin, on retrouve le fait d’entretenir attentivement, avec prévenance et sollicitude, ce qui en a besoin : la vie. Pour cela, le thérapeute doit se mettre au service de l’autre, il prend soin de lui, quitte à vouer sa vie à cela dans le cas du sacerdoce des prêtres et prêtresses, ou simplement prêter serment, dans le cas des médecins grecs.
C’est aussi la vocation d’un Socrate que certain·es appellent “le premier philosophe”, et qui parcourt les rues d’Athènes pour prendre soin de la santé psychologique de ses compatriotes, à l’aide de l’outil maïeutique, ou l’art de faire accoucher les esprits. Socrate aime en effet clamer que sa mère était sage-femme et accouchait les corps (ce qui fait bien évidemment partie du service) ; lui-même ayant repris le flambeau thérapeutique à un autre niveau…
Si l’activité thérapeutique consiste principalement à prendre soin, avant de soigner, Il reste alors à déterminer – et ce n’est pas une mince affaire – ce que peut la philosophie, dans le soin apporté à la personne…
La pratique philosophique peut-elle être une « thérapie » ?
C’est sur ce point, précisément, que naissent les dissensions au sein-même de cette belle famille qu’est la pratique philosophique. Car, comme dans toute famille, on n’est pas toujours d’accord sur tout, et parfois même on n’est pas d’accord sur grand-chose. Pour prendre un exemple tout à fait au hasard, il existe un sujet flagrant de désaccord au sein des différentes associations de philosophie pratique, autour du concept de « thérapie ». Dans un post récent sur sa page FB, le groupe « Dialogues socratiques », mené par Oscar Brenifier et ses acolytes, publie un atelier dont l’enjeu proclamé est de se demander si « la pratique philosophique est une thérapie ».

Or à l’évidence, la question posée ici n’est pas vraiment de savoir si la philosophie est une thérapie, mais plutôt de tenter d’établir une « distinction fondamentale » entre thérapie et consultation philosophique. Et la philosophie, selon O. Brenifier, ne se range pas du côté de la thérapie mais de la consultation. La thérapie va de pair avec le processus “psychologique”, alors que la consultation est l’outil pratique du processus “philosophique”. Il est important de bien distinguer ces deux domaines, pour ne pas risquer des confusions impardonnables dans la pratique (vous pardonnerez mon ton un peu ironique). Enfin, ce qui permet cette distinction, c’est le concept de « diagnostic », qui semble lié au processus psychologique et thérapeutique, sans que cela soit clairement annoncé pour l’instant. Vous avez compris cela, vous aussi ?
Or, pour revenir une fois encore à la salutaire étymologie, le concept de diagnostic vient de l’alliance du préfixe « dia- » (qui correspond au préfixe latin « trans- » : à travers) et de la racine « gnoséo » qui signifie « connaître » en grec. Le diagnostic est une connaissance qui vient de la relation entre deux éléments d’un système, souvent la cause et la conséquence ou, en médecine hippocratique, le symptôme et sa cause physiologique. C’est pour cette raison qu’au sens strict, le diagnostic se définit comme le fait d’identifier une maladie grâce à ses symptômes, et qu’il semble réservé au domaine médical (pour ne pas dire “thérapeutique”). Et c’est seulement par extension que l’on parle aussi de diagnostic dans le jugement porté sur une situation, dans la conclusion synthétique d’une étude de cas, ou encore dans le processus utilisé pour déterminer la relation entre une situation problématique et sa cause ou son origine. Toutes ces occurrences du concept de diagnostic étant puisées dans divers dictionnaires étymologiques.
Si l’on s’en tient à cette analyse, on peut – sans trop se risquer – affirmer que le diagnostic n’est réservé au monde médical qu’en son sens strict, celui qui fait le lien entre un symptôme maladif et sa cause. En son sens large, la philosophie est tout à fait légitime dans son approche résolument diagnostique, lorsqu’elle entend problématiser une situation afin d’établir ou d’éclairer des liens de sens entre les différents facteurs entrant en jeu. On pourrait même dire, pour reprendre Aristote, que la philosophie est le domaine par excellence du diagnostic, puisqu’elle ne se contente pas de chercher la cause efficiente (celle qui explique comment une situation s’est produite, en termes de déroulement ou de fonctionnement), mais qu’elle s’intéresse beaucoup à la cause finale, le pourquoi de la chose, son sens ou encore sa raison d’être.
Chercher la raison d’être d’une situation aporétique dans la vie d’une personne, la raison d’être d’une relation associative qui devient conflictuelle, la raison d’être d’un travail d’équipe unilatéral ou encore la raison d’être d’un mal être existentiel, voilà autant de domaines dans lesquels la philosophie peut « fourrer son nez » et tenter, à l’aide de son approche analytique, de dresser comme une « cartographie » des différentes forces en jeu, des obstacles et des freins, des ressources et des aides intérieures ou extérieures au système.
Quel lien avec la thérapie, me direz-vous alors ?
On y arrive ! J’aime bien penser, comme Socrate, que la plupart (pour ne pas dire « toutes » de manière trop péremptoire) de nos maladies – individuelles ou relationnelles – tiennent leur origine d’un déséquilibre. Ce déséquilibre ne concerne pas forcément et pas seulement notre régime physique, notre alimentation, notre qualité de sommeil, etc. Il concerne en général la gestion de nos besoins essentiels, dont tous ne sont pas physiques, loin de là. Et aussi le bon équilibre de nos valeurs, de nos convictions, de nos croyances : bref tout un équilibre systémique qui touche notre sphère mentale et émotionnelle.
En grec, hybris signifie à la fois orgueil et démesure. Orgueil (le fait de ne pas connaître sa juste place dans le groupe humain) parce que démesure, déséquilibre, excès dans une direction, au détriment des autres. Or l’excès est souvent le fait d’une croyance in-questionnée, qui a ainsi pris trop de place dans l’économie psychique d’un individu ou d’un système. Pourquoi a-t-elle pris autant de place ? Il faudrait un article à part entière pour répondre à cette question ; je me contenterai ici de pointer une fois de plus vers le besoin. Une croyance répond toujours à un besoin, ceci est le postulat de ma posture philosophique pragmatique.
Si je suis ce postulat pragmatique, dans mon accompagnement philothérapeutique, j’aboutis à la logique suivante : pour chercher le moteur de la croyance, il faut en trouver le besoin originel. La croyance est la stratégie employée pour satisfaire le besoin (de reconnaissance, d’appartenance, etc.). Mais la stratégie n’est pas toujours raisonnable, et parfois même elle sort de toute mesure, un peu comme une addiction était sans doute à l’origine la simple recherche d’une stratégie de satisfaction d’un besoin qui puisse être comme « définitive », en tout cas la plus pérenne possible.
Cette croyance addictive devient alors dogmatique, au sens où un dogme est une « vérité » qu’on doit bien se garder de remettre en question. Pour soigner l’hybris, il peut être opportun de fragiliser la croyance, de proposer des alternatives, d’instiller le doute, douloureux comme tout remède certes, mais salutaire pour l’âme. Et pour prévenir cet excès dogmatique d’une croyance au détriment des autres, il convient peut-être d’entretenir le doute, de prendre de la distance vis-à-vis de ses croyances, et de toujours chercher à apprendre, à découvrir, à être étonné. C’est le premier rôle thérapeutique de la philosophie, selon moi : celui du soin apporté à un système, avant de devoir opérer un système qui se trouve déséquilibré par ses propres stratégies.
Conclusion de la première partie
Voilà pourquoi, selon moi, la grande sœur de la philosophie doit être la bienveillance envers tout système : bienveillance née de la conscience de sa propre vulnérabilité, de ses propres failles, de son propre équilibre instable. Avant d’être théorique et abstraite, enseignée par et pour une élite dans les grands lycées et académies grecques, la philosophie est une fille de la rue, marchant pieds nus et cherchant à questionner celleux qui voudront bien partager ce soin à deux raisons qu’est le dia-logue, pendant quelques minutes ou quelques heures. C’est en tout cas l’image que je me fais de Socrate. Les mains sales (pour plagier Sartre), dans la dure besogne du travail au corps des croyances les plus profondes ; et les pieds dans la boue, au contact de l’humus qui nous rappelle à notre humilité.
Car nous sommes tous pétris de croyances plus indémontrables les unes que les autres ; ceci car nous sommes tous des êtres de besoins, et que nous nous sommes débrouillés comme nous pouvions pour trouver des stratégies plus ou moins efficaces, plus ou moins nuisibles sur le long terme, afin de pallier à l’urgence.
La philothérapie, telle que je la conçois, ne s’adresse pas à un public spécialisé : elle s’adresse à tout humain, dans sa vulnérabilité et ses tentatives parfois désespérées de conserver un équilibre psychique précaire. Et je me sens en fraternité avec ce fragile humain, car je suis moi-même en débat avec mes daimons, pas toujours aussi sympathiques et heuristiques que celui de Socrate, d’ailleurs…

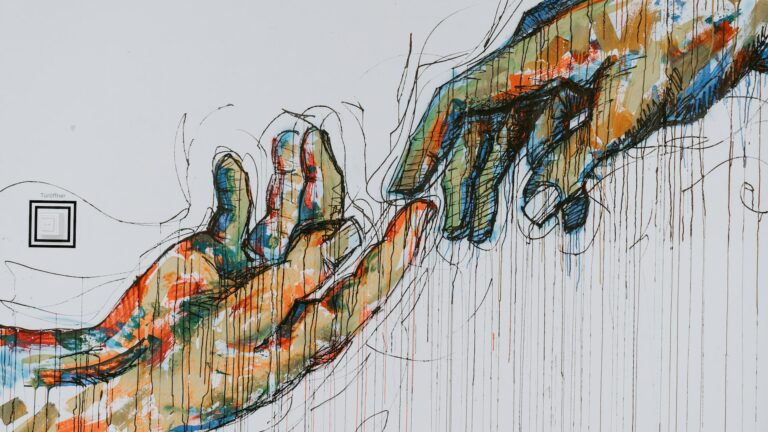




Cela me semble simple, puissant, indéniable. Merci pour la clarté de cette argumentation.