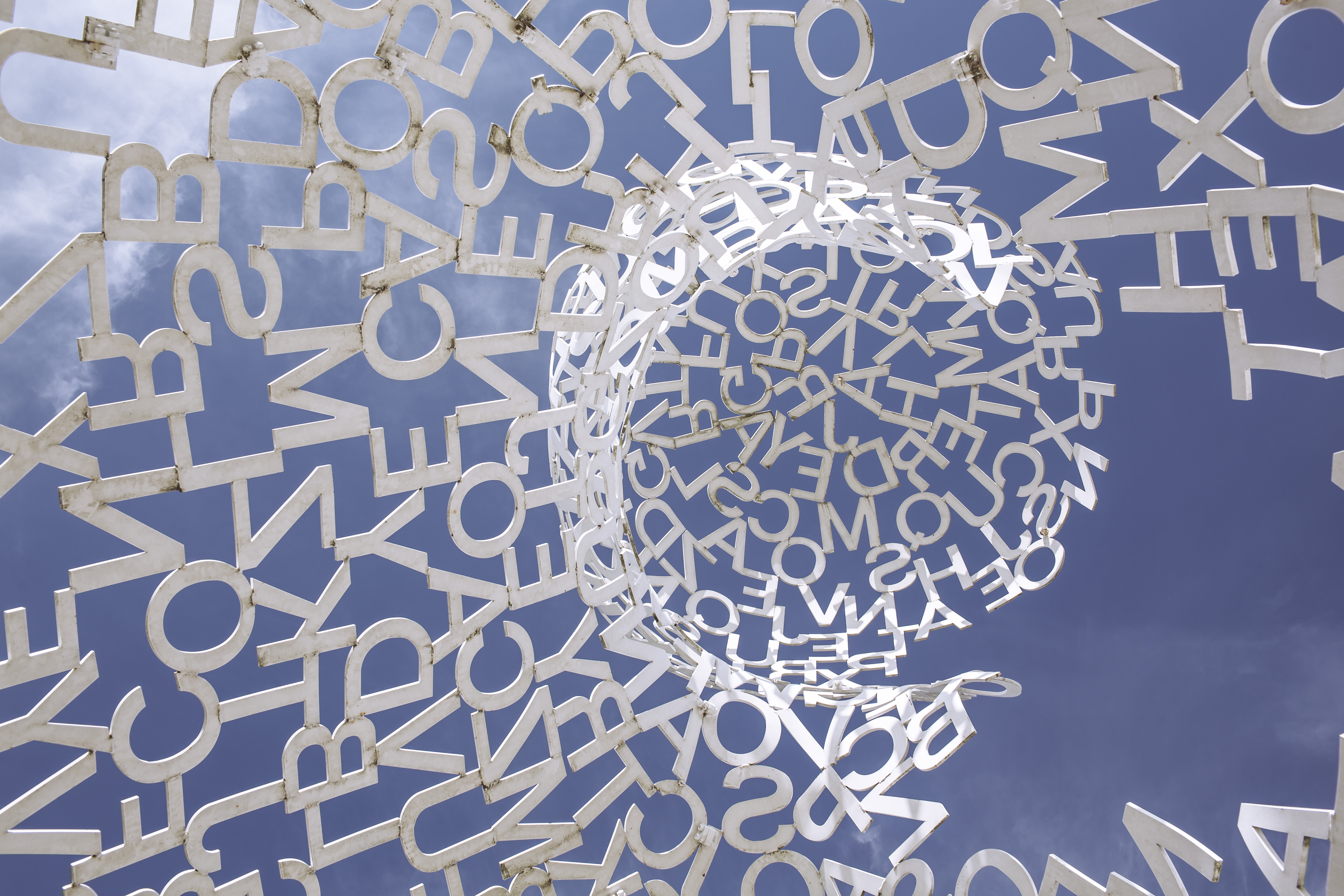La conception du management est souvent réduite à son seul niveau hiérarchique. Le manager incarne cette entité, voix de l’entreprise, bénéficiant d’une forme d’omnipotence due à son titre. Seulement, cette image apparaît comme sclérosée dans une ère où les entreprises évoluent constamment, à un rythme élevé.
Au cours de mes premières années de jeune active, j’ai pu observer et faire l’expérience de différentes approches managériales. De cette figure imposante et crainte, à celle franchement sympathique et inspirante tout en passant par cette personne silencieuse et recluse de qui son équipe entière se moquait. “Qui voulais-je être?”, m’étais-je interrogée au moment où je m’engageais dans un plan de développement, au sein de la compagnie que j’avais rejointe, pour devenir manager. La troisième option était évidemment, à exclure. Quant à la deuxième, je me demandais comment ne pas basculer du côté de la franche camaraderie. Enfin, la première me faisait craindre un acte de rébellion, ou un turn over accru d’une équipe qui, peut-être, aurait été trop opprimée et étouffée.
La méthode cartésienne au secours du manager
C’est en faisant face à ces interrogations, en assistant à plusieurs formations et en me confrontant la réalité que doucement je me suis rapprochée de la philosophie. L’appliquer à la vie de tous les jours, qui plus est à notre monde moderne en perpétuel changement, peut sembler inattendu. C’est pourtant dans ces essais aux ancrages très pratiques que se trouvent certaines des clefs de lecture de notre ère. Lorsque j’ai commencé à travailler, et laissé derrière moi des années d’études philosophiques et littéraires très théoriques, je pensais faire une croix sur cette voie qui me fascinait.
Ce fut, néanmoins, au cours d’un évènement en tant que manager que je fus frappée de l’utilité d’un pan philosophique considérable : l’approche cartésienne. Cette méthode structurée, et facilement transposable à d’autres contextes, m’a alors semblé évidente pour faciliter mon quotidien. Avant de m’avancer plus dans cette étude de terrain, il s’agirait de définir l’exercice du doute tel que Descartes l’entend. Le doute nous “délivre de toutes sortes de préjugés” et nous permet de jalonner le chemin vers la vérité. Ce n’est pas un doute hyperbolique dont il s’agit mais bien un doute méthodique, comme le montre la structure de la bonne conduite de sa raison lorsqu’en état de doute, dans le Discours de la Méthode :
“Le premier étant de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle : c’est-à-dire, d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui se présente si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute.
Le second, de diviser chacune des difficultés que j’examinerai en autant de parcelles qu’il se pourra et qu’il sera requis pour mieux les résoudre.
Le troisième, de conduire par ordre mes pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu comme par degrés jusqu’à la connaissance des plus composés. Et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns des autres.
Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre.”
La philosophie cartésienne se veut aller de l’avant, en analysant soigneusement toute chose reçue, pour se garder de comprendre comme une connaissance vraie, ce qui ne serait en fait qu’une opinion ; c’est-à-dire un point de vue subjectif qui n’est pas, obligatoirement, vrai.
Admettre ses doutes pour construire la confiance de son équipe
J’avais donc hérité de la conception du manager comme cette personne à la parole vraie. Le manager ne se trompait pas, ou, du moins, ne devait pas admettre s’être trompé en face de ceux qu’il gérait. Une telle erreur pouvait lui coûter le respect de son équipe et rendre cette dernière difficile à gérer. Cette opinion était pour moi indubitable, jusqu’à ce qu’un événement la bouleverse. Je venais de quitter Booking.com et avait rejoint une compagnie plus petite, à Amsterdam. Comme dans beaucoup d’entreprises, nous avions pour habitude d’organiser un point matinal – daily stand up – . Ce jour là, mon collègue, en charge du côté opérationnel, venait faire part de ses analyses concernant le taux très élevé de contacts manqués par le service client. A la vue des chiffres, la plupart des managers ont conclu que les agents du service client ne faisaient pas leur travail. Tous ceux qui dépassaient 20% de contacts manqués ont alors reçu des avertissements officiels. Était-ce vers quoi il fallait se tourner?
Descartes, pour étayer son argumentation que nos sens sont faillibles, s’appuie sur le rêve (Méditation 1ère). Lorsque nous dormons, nous rêvons de choses parfois si proches de notre réel qu’au réveil tout nous semble encore incertain : “étais-je en train de rêver ou avais-je vraiment dit ou fait ceci?”. Tous, nous avons fait l’expérience de tel doute, au réveil. Puisque nos sens sont capables de nous tromper, nous devons nous y fier qu’avec prudence. N’étions-nous donc pas dans un cas similaire ? Lire les résultats et tirer la conclusion que l’équipe cherchait à éviter le travail, n’était-ce pas une erreur ? Ne devions-nous pas, justement, prendre le temps d’analyser chaque opinion soulevée par cette situation et les analyser rationnellement ?
C’est ce que j’ai essayé d’appliquer sur mon équipe. Au cours d’entretien individuel, je les ai mis face à ces résultats en les engageant dans une interrogation méthodique : “Que s’est-il passé? Que pensez-vous de ces chiffres ? Que proposez-vous comme solution ?” Cette approche, fondée sur la philosophie de Descartes, fut moteur de la résolution du problème. Ces chiffres traduisaient, en fait, les dysfonctionnements d’un logiciel vieillissant mais aussi le manque d’attention que les tâches éparses créaient chez certains individus. J’ai donc pu aider mon équipe à redéfinir les attentes de l’entreprise envers elle tout en soulignant l’impact de leur travail sur l’ensemble de l’organisation. Enfin, admettre l’erreur d’analyse m’a permis de solidifier les liens avec mes employés et d’être comprise comme une personne ouverte à une amélioration continue chez chacun, à commencer par moi-même afin d’être en capacité de les guider dans leurs travaux.
Le doute cartésien au quotidien
Cet événement s’est inscrit comme le moteur qui a motivé ma poursuite de l’application du doute cartésien au sein de mon environnement de travail.
Je partis donc du postulat que toute situation que je rencontrais, ou qui m’était présentée, ne pouvait être dite “vraie” sans l’avoir auparavant soigneusement interrogée et analysée (Discours de la Méthode, Première partie, p.24). Prenons une autre opinion que je me faisais du manager et qui, encore aujourd’hui, est bien ancrée dans les moeurs. De par son rang hiérarchique, ses décisions ne devaient jamais être questionnées. Discuter le jugement du manager revenait à rompre le fondement de la structure hiérarchique.
Dans mon poste actuel, je gère une équipe d’environ dix ingénieurs. Récemment, trois personnes ont quitté l’équipe et nous peinons à trouver des remplaçants adéquats. Nous tournons donc à effectifs réduits mais nous nous devons de fournir la même qualité de travail. Une de ces personnes s’occupait en totalité du processus des téléphones – prévision, commandes, réception et préparation pour les utilisateurs -. Je souhaitais que l’équipe entière soit impliquée dans ce projet, de façon à pouvoir pallier, justement, aux divers départs et absences imprévues de chacun. J’ai donc établi une rotation bi-mensuelle : en parallèle des autres tâches, un ingénieur devait se charger chaque jour que ce projet continuait d’être alimenté. Seulement, avec l’ensemble des missions à accomplir, l’emploi du temps prévu a très vite montré ses limites : la flexibilité attendue de l’équipe étant un frein à cette organisation.
Dès la deuxième semaine, l’ingénieur en charge est venu me dire qu’il doutait de l’efficacité d’une telle distribution de la tâche. Selon lui, cela créait une instabilité et de la pression supplémentaire en raison de la charge de travail. Il proposait d’obtenir une journée complète pour ce processus, où aucune autre tâche ne lui était assignée. J’étais face à la possibilité de lui dire : “cette structure a été adoptée en raison de sa capacité à impliquer chaque membre de l’équipe tout en minimisant l’impact sur une seule et même personne sur le long terme. Elle restera telle qu’elle”. Seulement, pourquoi ma parole aurait été plus vraie que la sienne ? L’opinion que, parce que j’étais manager, ma décision ne pouvait être discutée m’est alors apparue très douteuse. J’ai, donc, décidé que comme rien n’avait pu prouver que ma décision était véritablement vraie, elle pouvait être remise en question. Je lui ai proposé de mettre en place la sienne, tout en conservant un système de rotation, en cas d’absence ou départs imprévus. Nous n’en sommes qu’au balbutiement de ce projet qui est appelé à, de toute façon, évoluer mais cet événement a renforcé les liens avec l’équipe qui me sent ouverte à recevoir leurs retours pour avancer, ensemble, de façon pérenne.
J’espère avoir pu étayer le criant besoin d’ajustement de la conception du manager qui, bien que figure hiérarchique de l’ordre, doit pouvoir remettre en question son approche. Je me garde bien de faire de cet essai un précepte de conduite de tout manager et je choisis de conclure en paraphrasant Descartes : “Ainsi mon dessein n’est pas d’enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte (je tâche) de conduire la mienne.” (Discours de la Méthode, Première partie, p.10). J’essaye, depuis bientôt deux ans, de mêler la philosophie à ma pratique professionnelle et trouve dans l’approche cartésienne un souffle très moderne : une méthode structurante mais très flexible, deux mots clefs du monde du travail actuel.