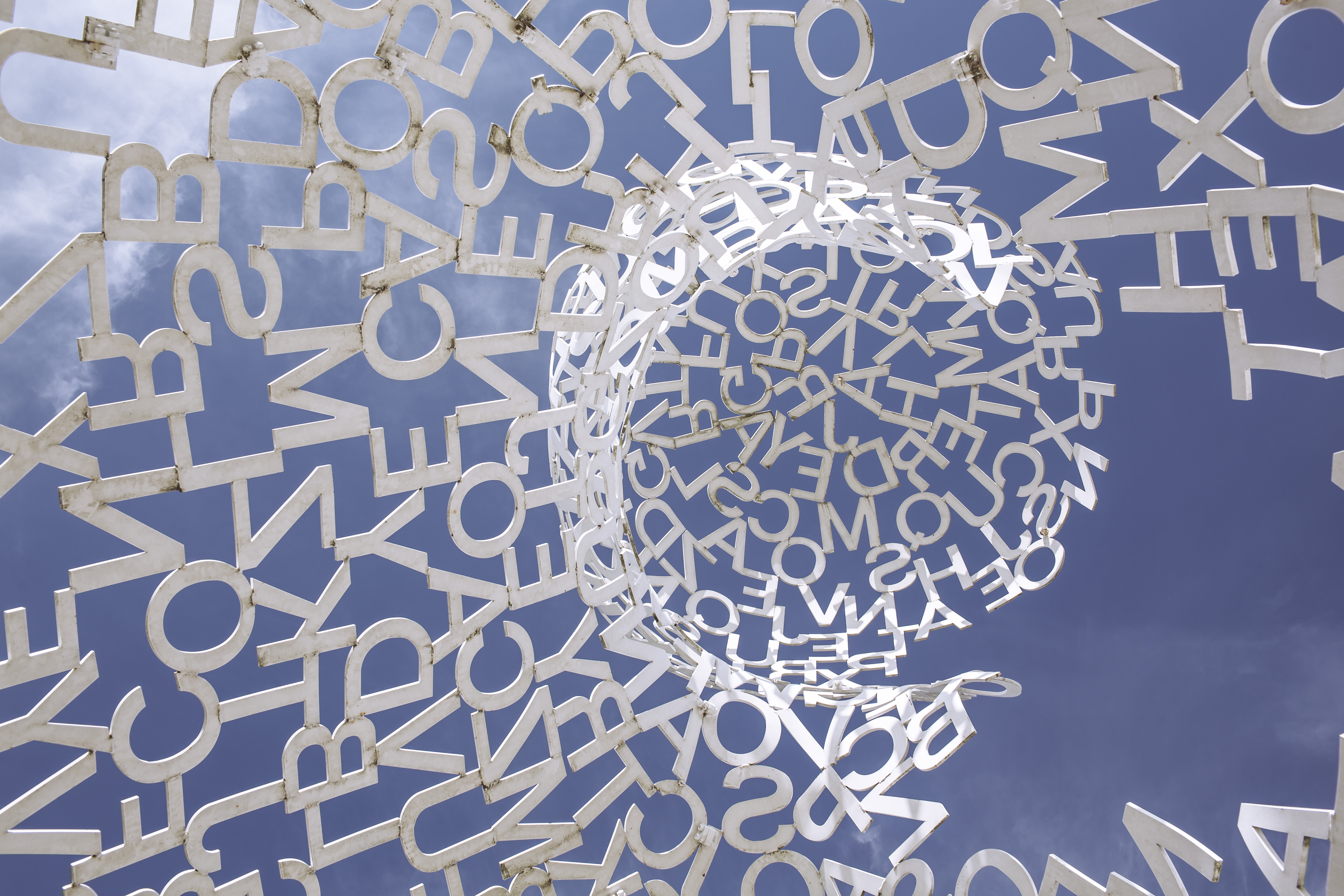Notre époque témoigne d’un mouvement inédit en matière de responsabilité sociétale, de « libération » des entreprises et de remise en cause des modes de fonctionnement traditionnels. Cette dynamique amène tout naturellement les philosophes à s’intéresser à ces organisations qui cherchent à développer des alternatives. En retour, certaines d’entre elles acceptent de laisser une place à un regard critique sur leurs actions. Mais, concrètement, qu’est-ce que cela implique pour un philosophe d’être embarqué en tant que salarié dans une organisation ? Quels sont les objectifs et missions poursuivies ? Et comment tenir une posture philosophique dès lors que l’organisation auprès de laquelle nous exerçons s’avère avoir des conduites fort peu éthiques, en décalage complet avec l’image qu’elle prétend avoir ?

Le livre de Thibaud Brière, Toxic Management (Robert Laffont, 2021), laisse entendre un équilibre difficile à tenir pour qui entend amener la pratique de la philosophie en organisation. Toxic Management dresse le portrait sans concessions de “Gadama” (entreprise réelle dont le nom a été modifié), une entreprise qui présente tous les traits de la libération et de l’innovation managériale. Derrière l’image irréprochable d’une entreprise supposée incarner de fortes valeurs et une conception du travail renouvelée, se cache une réalité bien loin de cette image séduisante. Que faire alors quand notre mission en tant que philosophe est précisément d’oser dire la vérité ?
Pour répondre à ces questionnements, nous avons rencontré Thibaud Brière.
L’entreprise, grande rivale des Etats et des Religions ?
La Pause Philo : La Loi PACTE de 2019 invite à aller un cran plus loin dans la prise en compte de la RSE en permettant d’ajouter dans les statuts juridiques d’une entreprise une « raison d’être » et une « mission », différant de ses objectifs lucratifs, au service d’objectifs sociétaux. De nouvelles responsabilités éthiques et morales reposent sur les décideurs. Que penser de ce phénomène ?
Thibaud Brière : Nous pouvons faire deux hypothèses pour interpréter cette tendance.
Une première raison se trouve du côté des employeurs : pour obtenir un plus grand engagement de leurs collaborateurs, ils éprouvent le besoin d’aller forer plus loin en eux que précédemment, d’aller chercher des leviers de motivation plus profonds. Ils se dotent d’un surcroît d’idéologie, ce qu’exprime la sophistication croissante des théories managériales, mieux conceptualisées et plus attrayantes. Dans Idéologie et capital, Thomas Piketty montre que ce mouvement de fond, inertiel, constitue une tendance lourde. Les directions recourent de manière croissante à des consultants, experts ès sophistications en tous genres, mais aussi à tous les spécialistes « du sens » disponibles : chercheurs, storytellers, psychologues, formateurs en développement personnel…
Le recours à des philosophes participe – malheureusement – de ce mouvement général de quête d’arguments et de systèmes intellectuels permettant d’emporter l’adhésion. Mais il peut aussi y avoir de bonnes raisons de faire appel à de lointains disciples de Socrate. La question de la « raison d’être » de l’organisation en est une, préoccupation métaphysique par excellence. Mais pourquoi surgit-elle maintenant ? Sans doute en raison de la conscience plus vive que le sol se dérobe, que les grandes et moyennes entreprises se transforment tant et si bien, sous l’effet de la financiarisation du capitalisme, qu’elles en perdent leur nature, leur fonction sociale originelle, tendant même parfois à se confondre avec des Etats ou des religions. Le fond métaphysique remonte à la surface. Nous pensions ces vieilles questions dépassées, mais elles se rappellent invariablement à nous : celle de la cause première et de la cause finale, du sens et de la légitimité. Qu’on les refoule ou non, les questions philosophiques ne cessent d’animer les communautés humaines et donc de se poser en entreprise.
Parmi les entreprises qui se résolvent à expliciter ce qu’elles appellent leur mission, il y a des PME, des E.T.I, des multinationales… Pour ma part, ce sont les grandes entreprises qui m’intéressent en premier lieu, en raison de leur incidences sociales et politiques particulièrement significatives. Comme le montre Alain Supiot, quand une société atteint une certaine taille, elle ne peut tenir sans une foi ni une loi. J’observe de fait un développement incontrôlé du fidéisme dans les grandes entreprises, de demandes d’adhésion irréfléchie à un corpus doctrinal de plus en plus ferme et détaillé, décliné en normes de « savoir-être » et en listes de to do / not to do. Il y a une tendance générale à la moralisation et à la stigmatisation non seulement des comportements peu professionnels mais aussi des croyances déviantes. Cette morale corporate qui ne dit pas son nom se fait tatillonne et rigide. Il est urgent de laisser les gens respirer, de les libérer de ces carcans intérieurs.
Derrière le paravent commode de la culture d’entreprise, se trouve dispensé de manière de plus en plus claire et intentionnelle une certaine conception de l’Homme et de la société : une « philosophie d’entreprise » entendue comme un système d’idées exprimant une vision du monde.
Sur un tel socle idéologique, les grandes entreprises se posent en rivales des États et des religions. L’anthropologue et sociologue Pierre Musso parle à bon droit d’une « religion industrielle ». L’entreprise vient combler un vide, donnant une sens à nos sociétés liquides, en manque de repères. En mobilisant les ressources du développement personnel, du coaching, de la psychologie et des sagesses orientales, les grandes entreprises se proposent désormais de répondre aussi aux besoins existentiels de leurs membres. C’est tout à fait nouveau. Chez Gadama, bien des gens qui ont été virés continuent de revendiquer faire corps avec leur ancienne société, de protester de leur fidélité sur le mode « Je suis des vôtres ». Ce phénomène d’emprise est de plus en plus documenté et analysé en sciences de gestion. Il faut d’ailleurs remarquer la parenté étymologique entre les deux termes : « entreprise » vient du vieux français « emprise », comme on l’entend encore en espagnol où entreprise se dit empresa, et en italien où cela se dit impresa.
Une deuxième raison susceptible d’expliquer l’actuelle extension du champ de responsabilité des dirigeants d’entreprise aux domaines sociaux, sociétaux et politiques, est à chercher du côté des individus. Comme je le disais, se trouvant en manque de repères, ils demandent que l’organisation dans laquelle ils passent près de 70 % de leur temps éveillé leur donne de plus en plus de sens. Un sens à leur vie. Des clés de compréhension du monde. Une vision des choses partagée, rassurante, les intégrant à une communauté. Comme le disait Jean-François Lyotard, nous avons, au siècle dernier, assisté à la fin des « grands récits » : la famille, la religion et la politique ne font plus sens, comme on dirait aujourd’hui. Nous n’y croyons plus. L’entreprise ne fait ainsi, dans une certaine mesure, que donner aux gens ce qu’ils réclament. Quand elle dispense des croyances, de l’idéologie, un cadre théorique et pratique encadrant les conduites individuelles, elle répond à un besoin, à une demande intérieure. Elle sert de religion de substitution, de politique de substitution, de morale new look… D’où une multiplication des dérives sectaires et le développement d’un fanatisme corporate, jusqu’à y sacrifier sa vie. L’entreprise se constitue alors en idole, au sens précis du terme : capable de vous satisfaire entièrement dans la mesure où vous acceptez de lui remettre l’entièreté de votre vie.
Des sophistes au service des entreprises ?
LPP : Qu’est-ce que cela veut dire concrètement quand on parle de “valeurs” en entreprise ? Est-ce seulement possible, d’amener les individus à incorporer des valeurs qui peuvent différer des leurs à l’origine ? Qu’est-ce que cela implique, en tant que philosophe, d’être chargé de travailler sur ces valeurs au sein de l’organisation ?
TB : La réponse se trouve dans la distinction entre le sophiste et le philosophe. L’entreprise fait une belle place aux sophistes : consultants, manageurs et dirigeants sont payés pour donner du sens, « créer la confiance », non pour dire la vérité. Ni même pour tendre vers elle. Quand les entreprises font appel à des philosophes, c’est donc, la plupart du temps, pour de mauvaises raisons : elles voient en lui un spécialiste du sens, un professionnel de l’argumentation, capable de démontrer une chose et son contraire, selon la volonté variable du commanditaire. C’est donc en réalité souvent un sophiste qu’elles cherchent. Mais le mot étant connoté négativement, on préférera parler de « philosophe », ce qui est trompeur. On attend de lui qu’il se montre efficace dans l’art de convaincre, de modeler croyances et comportements. De faire adhérer aux valeurs corporate, grâce à sa meilleure maîtrise du langage. Il se sert à cette fin de sa « domination symbolique ». S’il se montre habile, il saura faire librement adhérer les gens au sens désiré tout en faisant preuve d’ouverture aux critiques et en mettant en place un dispositif participatif. Parce qu’il préserve ainsi le sentiment de liberté individuelle, il est particulièrement utile aux organisations qui cherchent à se rendre plus socialement acceptables, à ne plus paraître gouverner par les contraintes et les sanctions.
La nouveauté, je le disais, c’est que les grandes entreprises cherchent à avoir des gens qui croient en elles et plus simplement qui agissent d’une manière professionnelle. Plus encore : de manière croissante, les employés y sont jugés sur ce qu’ils sont et non sur ce qu’ils font. En recourant de manière grossière à des typologies psychologiques, on dira : « untel est un renard », « tel autre est un vert », etc. Et on se séparera de ceux qui ne sont pas jugés, par ces psychologues amateurs, « alignés » avec l’identité profonde de l’organisation. Moyen facile, en réalité, de se débarrasser de tous les gêneurs ou personnels en surnombre, au motif qu’ils « manquent de savoir-être ».
Pour les identifier, j’ai observé chez Gadama Inc. l’usage très particulier qui est fait de la notion de transparence. On promeut ceux qui sont jugés les plus transparents à eux-mêmes et aux autres. C’est-à-dire en fait d’abord à leur direction, qui leur demande de se mettre à nu mensuellement – le dirigeant fondateur compare son entreprise à un « camp de nudistes » – en exprimant publiquement, en réunion, ce qu’ils ont fait de bien et de pas bien durant le mois écoulé. Le tout étant retranscrit dans des compte-rendus détaillés, où se trouvent par conséquent consignés par avance tous les éléments à charge constitutifs d’un « dossier RH » bien ficelé, à produire au moment opportun.
Surveillance généralisée, idéologie, emprise… J’ai jugé nécessaire d’alerter sur ces tendances managériales lourdes, raffinées, séduisantes que je voyais à l’œuvre. Ce sont des choses que j’ai observées sur une longue durée, sur lesquelles j’ai alerté en interne et que je me suis résigné à rendre publiques parce que rien ne changeait.
Mais avant d’en arriver à affirmer quelque chose, l’aspirant philosophe doit d’abord se montrer capable de se faire aussi sophiste que les sophistes pour mettre à jour les sophismes. Il n’y que de l’intérieur qu’il peut en faire éclater les contradictions. Ce qui suppose d’en épouser le mouvement, de tendre à comprendre telle ou telle « philosophie » d’entreprise mieux qu’elle ne se comprend elle-même. Un philosophe est théoriquement armé pour cela : tout au long de sa formation universitaire il lui est demandé de se lover dans la pensée de tel ou tel auteur, fidèlement, qu’il la partage ou non. « C’est la marque d’un esprit cultivé que d’être capable de nourrir une pensée sans la cautionner pour autant », écrit Aristote. On ne demande pas à un spécialiste de la pensée de Nietzsche d’être nietzschéen. Seulement de lui faire honneur en la défendant comme elle le mérite et comme l’aurait probablement fait son auteur s’il était encore parmi nous.
Quelle est l’utilité sociale du philosophe ?
LPP : Tout au long de votre livre, les tensions entre la posture philosophique et l’entreprise se font ressentir, en particulier dès lors que des différences entre le discours officiel et les pratiques au quotidien dans l’organisation du travail se manifestent. Est-ce que le philosophe salarié, rémunéré et dépendant de son employeur, peut disposer d’une libre indépendance de pensée ?
TB : Comme philosophe d’entreprise, j’étais effectivement, d’abord, au service de la philosophie d’entreprise officielle de mon employeur. Mon rôle était de la défendre, de la valoriser, de la crédibiliser.
Dans un premier temps, je l’ai mise en mots en un livre dont la fiabilité était attestée par la co-signature du dirigeant fondateur. De manière à ce que l’on ne puisse pas me dire « tu n’as pas bien compris ». Cette formalisation a pu se faire grâce à une quarantaine d’entretiens, d’une vingtaine de réunions observées et la consultation de documents officiels. Etape essentielle, car ce qui est dit rend possible d’être contredit. On dispose alors d’une base pour débattre, confronter le pour et le contre, juger de ce qui est fidèle ou infidèle à la théorie managériale énoncée. C’est précisément ce à quoi rechignent nombre d’hommes d’entreprise, qui préfèrent pouvoir perpétuellement dire « ah, mais je n’ai pas dit cela », « vous ne m’avez pas compris » ou encore « j’ai effectivement dit ça, mais je dis aussi le contraire ». Comme des anguilles – ou des sophistes –, ils n’aiment rien tant que filer entre les doigts, demeurer insaisissables, ne pas paraître avoir de colonne vertébrale afin de s’adapter à tout ce que l’esprit du temps ou leur interlocuteur du moment considèrera positif.
Dans un deuxième temps, m’appuyant sur ce corpus doctrinal un tant soit peu stabilisé, il m’était demandé d’évaluer tout ce qui, dans le fonctionnement quotidien de l’organisation, se trouvait en décalage, comme autant d’incohérences ou de « dysfonctionnements », comme disaient les dirigeants de Gadama Inc. Je devais également former l’ensemble des manageurs du groupe – membres du Comité de direction compris – à une juste compréhension de cette philosophie d’entreprise maison, charge à eux ensuite de la relayer à leurs subordonnés pour « donner du sens ». En outre, par le biais d’une participation à des colloques, table-rondes, séminaires ou petit-déjeuners professionnels, j’étais chargé d’enseigner cette philosophie non plus seulement à l’intérieur de l’entreprise mais à l’extérieur, en répondant aux objections qui pouvaient lui être faites –et j’étais le premier à lui en faire. Etant payé à défendre et promouvoir un point de vue, un système de pensée, en toute indifférence à sa vérité, mon travail ne se distinguait pas encore, ici, de celui d’un simple sophiste.
C’est pourquoi, non moins que de dispenser le sens officiel comme me le demandait la direction de l’entreprise, je m’efforçais, indissociablement, de former mes interlocuteurs à être capables de remettre en question LE sens corporate, LA philosophie d’entreprise érigée en doctrine managériale. Donc de penser par eux-mêmes, en stimulant leur esprit critique. Cela passait notamment par un mode d’animation fortement participatif des formations au management et au « savoir-être » que j’animais, en faisant systématiquement réfléchir les participants à la définition des termes de l’intitulé de formation, au sens de celle-ci, puis en leur faisant co-construire les savoirs utiles, aiguillonnés par mon questionnement. Alors et alors seulement le responsable de la philosophie d’entreprise que j’étais, pour une part assimilable à un sophiste, se faisait aussi philosophe en entreprise.
S’agissant maintenant de l’indépendance du philosophe salarié, tout dépend, selon moi, de la capacité d’indépendance d’esprit dudit philosophe. Autrement dit, le problème ne me paraît pas tant statutaire (salarié/travailleur indépendant) que… existentiel, intérieur à chacun. Un philosophe travailleur indépendant, consultant, pourra fort bien refuser de mordre la main qui le nourrit, alors qu’un philosophe salarié pourra très bien avoir reçu des garanties de son employeur d’une totale liberté de parole. C’est cette seconde voie qui a été la mienne, jusqu’à ce que je fasse l’expérience – en rien inéluctable – que mon employeur ne se faisait visiblement pas tout à fait la même idée que moi de cette liberté de parole. Officiellement, il était tout à fait ouvert aux critiques, mais dans les faits, je m’aperçus assez vite qu’il y avait critique et critique : d’un côté celles qui portaient sur ce que les dirigeants estimaient eux-mêmes critiquable et en quoi je leur rendais donc service, d’un autre côté celles qui n’avaient pas l’heur de leur plaire et qu’ils me demandèrent bien vite de réserver aux seuls réunions du Conseil d’administration. Mais même une telle restriction à ma liberté de parole (qui constituait une entorse non seulement à notre contrat moral initial mais aussi à leur propre philosophie d’entreprise), à laquelle je me tins scrupuleusement, ne suffit pas : progressivement, même les analyses que je leur présentais, écrites et orales, finirent par les insupporter. Il faut dire que l’entreprise dérivait lentement mais sûrement vers des manières de faire de plus en plus éloignées de la philosophie d’entreprise officielle qu’ils m’avaient initialement chargé de verbaliser puis d’enseigner, ce qui m’obligeait à le leur dire (ma mission consistant en effet à repérer les écarts entre la théorie managériale et la pratique opérationnelle, à les dire aux opérationnels, charge à ces derniers ensuite d’agir ou non en conséquence). Sans parrèsia, à quoi aurais-je servi ? Quand, au terme de cette dérive, apparu un classement des salariés en trois catégories animales, je leur fis part de mon franc désaccord. Le patron estima alors qu’il ne pouvait continuer à abriter un philosophe d’entreprise qui non seulement pointait depuis l’origine de désagréables contradictions internes, mais qui de surcroît se mettait à désapprouver des évolutions du système de management par lui voulues. Ne pouvant me faire taire et comme je refusais de démissionner, il me licencia pour insuffisance professionnelle. Je le pris comme un hommage, tant je considère logique – bien que non inéluctable – qu’un philosophe, s’il fait bien son travail, finisse par être mis à mort. Symboliquement, j’entends. Ses critiques le conduisent naturellement à l’exclusion, si du moins, comme c’est souvent le cas, l’organisation qui l’emploie supporte mal d’être remise en question. Il y a là un problème de cohérence et de calage initial : une entreprise fait appel à un philosophe qu’elle déclare officiellement libre de ses propos, mais elle attend en réalité de lui non pas qu’il cherche la vérité de manière indépendante mais qu’il fasse le sophiste en professant ce qui convient à l’intérêt des dirigeants du moment. Ma question est simple : si les propos du philosophe ne dérangent pas, quelle est son utilité sociale ?
Ma conviction est que toute organisation mature a besoin de critiques. Elle ne peut durer qu’à la condition de s’ouvrir à l’altérité, de se nourrir de contradictions qu’elle vit de surmonter. Aussi gagnerait-elle à institutionnaliser une fonction critique, car mieux vaut pour elle que tout ce qui se trouve de critiquable dans son fonctionnement soit d’abord formulé en interne, par un « ami critique » de confiance permettant d’agir, plutôt que par des commentateurs extérieurs pas forcément bienveillants. C’est ainsi par exemple que la loi P.A.C.T.E chercha à transposer en France les comités de critical friends institués dans de grandes entreprises anglo-saxonnes, mais elle le fit en encourageant la création de simples « Comité des parties prenantes » (comme il en est un chez Veolia), faisant ainsi soigneusement l’impasse sur la dimension critique.
Pour conclure, je dirais que même s’il se trouve salarié, un philosophe peut être tout à fait indépendant, pas moins par exemple que les auditeurs internes qui sont directement rattachés au Conseil de surveillance afin de n’être subordonnés à aucun chef d’aucune hiérarchie opérationnelle. Pour autant, bien qu’ils soient statutairement indépendants avec l’obligation de dénoncer les infractions constatées, il est des auditeurs internes qui préfèrent ne pas faire trop de vagues et fermer les yeux sur un certain nombre de réalités contrariantes pour la direction de leur entreprise. Mais c’est l’honneur de leur profession de comporter aussi des hommes doués d’une véritable indépendance d’esprit, à l’image de Nicolas Forissier, le lanceur d’alerte d’UBS qui fut lui aussi licencié pour avoir fait ce pour quoi il était payé. Quel que soit son statut dans une organisation, le philosophe n’est ni plus ni moins indépendant que peuvent l’être les auditeurs. Il est tenu de voir clair, de penser juste et de parler vrai, mais pour dix qui se présentent ainsi, combien osent l’être jusqu’au bout ?
Pour aller plus loin :
– Le site dédié à Toxic Management