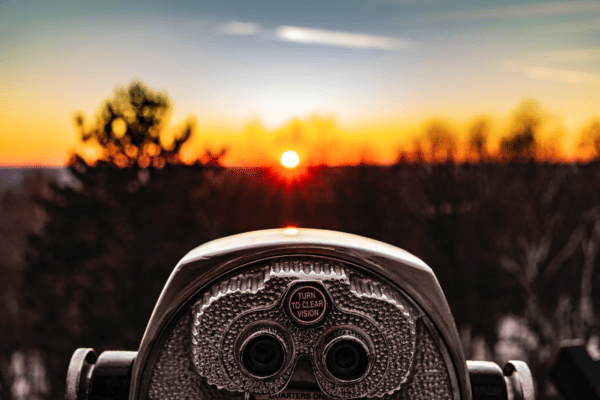Que faire face à la crise écologique ? Quand la jeunesse s’engage à l’échelle mondiale à l’encontre de l’inaction des gouvernements, se pose la question de notre marge d’action en tant que citoyens face à une menace qui paraît inévitable. La posture des scientifiques face à cette crise soulève également des interrogations autour des représentations que l’on peut avoir d’eux dans les médias et les imaginaires collectifs, puisqu’ils apparaissent à la fois comme des lanceurs d’alertes ignorés des politiques et industriels, mais aussi comme des figures d’une expertise désincarnée, dont la parole est remise en cause à l’heure des fake news et des théories complotistes.
Quelle pierre à l’édifice peuvent apporter les sciences sociales, et en particulier la philosophie, pour tenter d’éclairer cette crise aux enjeux complexes, car à la fois écologique, sociale et politique ? Ce questionnement a mené l’équipe de La Pause Philo à une excursion marseillaise, à l’occasion d’un festival de sciences humaines consacré à la crise écologique.
Du 25 au 29 septembre 2019, la ville de Marseille a en effet accueilli la première édition du Festival Allez Savoir, un événement consacré aux sciences sociales organisé par l’EHESS (Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales). « Briser les murs et les méconnaissances parfois arbitrairement élevés entre les publics et les outils de compréhension des grands défis de nos sociétés forgés par la recherche publique » : voici l’objectif de ce Festival d’après Christophe Prochasson, président de l’école.
Ancré dans la ville de Marseille, où l’EHESS est installée depuis plus de 40 ans, le Festival Allez-Savoir s’inscrit dans la lignée de ces initiatives qui permettent de remettre la philosophie et les sciences humaines au coeur de la cité. Ce type d’événement a un grand rôle à jouer, en permettant le dialogue entre chercheurs, acteurs de terrain et citoyens sur des sujets qui concernent les enjeux de nos sociétés, et en rendant la pensée accessible à tous.
Durant 5 jours, chercheurs, acteurs publics et associatifs, artistes, étudiants et citoyens se sont rassemblés pour discuter et échanger autour d’un des sujets majeurs auquel sont confrontées nos sociétés aujourd’hui. L’événement était nourri d’une approche interdisciplinaire et, tout particulièrement, d’un regard philosophique déconstruisant présupposés et idéologies. Éclairer et orienter l’action, créer un dialogue avec les problématiques contemporaines, voici de quoi retenir l’attention de La Pause Philo !
Avec un titre provocateur, “En finir avec la nature ?”, le festival a introduit le sujet qui allait inspirer une programmation variée, entre conférences, tables-rondes, projections-débats, expositions… Cette variété a permis de toucher un large public de non-scientifiques, et d’être accessible en particulier aux collégiens et lycéens, ce qui en contrepartie a parfois pu laisser sur leur faim les spectateurs (dont nous !) en attente de découvrir un peu plus en finesse les travaux des doctorants et chercheurs derrière cet événement. Malgré cette inégalité en matière de qualité de contenu, Catherine Larrère, Philippe Descola et Pierre Rosanvallon, parmi d’autres intervenants scientifiques, ont mené des débats éclairés sur des problématiques complexes, que nous avons pris plaisir à écouter.
Une nature insaisissable
En préambule, rappelons que la notion même de “nature” n’est pas évidente à définir. L’histoire de la pensée nous a mené à la dissocier de la “culture”, qui quant à elle appartiendrait à l’humanité. Un rapport ambivalent à la nature a marqué les représentations occidentales au fil des siècles, entre une wilderness qui nous échappe, celle des espaces sauvages qu’il convient de préserver de tout impact humain, et une nature comme une ressource que nous devons apprendre à maîtriser, exploiter, dominer. L’ensemble de ces conceptions a profondément marqué la notion de nature telle que nous l’entendons encore aujourd’hui. Pourtant, pour des penseurs comme Descola (voir son ouvrage Par-delà nature et culture, paru chez Gallimard en 2005), cette dissociation nature/culture n’a rien d’universel et ne se vérifie pas anthropologiquement à l’échelle du globe. Il convient de modifier nos représentations mentales autour de notre rapport à l’environnement, pour le penser en tant que continuité de notre humanité.
La crise écologique, un problème global ?
La crise écologique et la mise en danger de la nature sont-elles des objets et des problèmes globaux ? Face à une telle formulation, une réponse affirmative apparaît spontanément comme étant la seule possible, tant les débats au sujet du changement climatique se concentrent sur l’idée d’une crise à l’échelle planétaire. Pourtant, peut-on vraiment penser cette globalité sans nier la souveraineté des Etats sur leurs territoires respectifs, souveraineté qui est le principe de base sur lequel reposent nos démocraties ?
Le cas de la forêt amazonienne constitue un cas d’école pour illustrer ce questionnement : est-il légitime que les chefs d’Etat européens exigent une prise d’action de la part du Brésil vis-à-vis des incendies ? La réponse de Bolsonaro rappelant que l’Amazonie est aux brésiliens n’est-elle pas tout autant légitime ? L’Amazonie a été présentée comme étant le poumon de la planète : il nous apparaît tout à fait naturel de nous inquiéter et de plaider pour sa conservation. Notre planète est notre maison commune, et il est de notre responsabilité à tous et toutes d’exiger sa protection. Cela vaut aussi auprès d’autres pays dont les actions impacteraient négativement dans notre qualité de vie et celle des générations futures.
Mais derrière cette vision communément admise, ne serait-on pas en présence de l’imposition d’une pensée et d’un modus operandi unique, voir d’une néo-colonisation justifiée par la théorie de l’effondrement ? Que reste-t-il de la souveraineté des États vis-à-vis d’une telle pression ? N’est-il pas hypocrite de la part des pays occidentaux de parler d’écologie et de vouloir contraindre le développement d’autres États, alors qu’ils furent eux-mêmes les premiers pollueurs et continuent de l’être en large partie ? N’est-ce pas faire reposer tout le poids de la responsabilité de la crise écologique sur les épaules de ceux qui sont pourtant les premiers à la subir ?
Penser global, agir local ?
Pour la philosophe Catherine Larrère, cette fascination du “global” est aveuglante tout en étant mobilisatrice, puisque cette notion a largement contribué à donner une telle importance aux questions écologiques. Penser globalement implique de penser la catastrophe ; pourtant, localement beaucoup de choses se font, et un “écologisme des pauvres” existe. En tant que citoyen, l’échelle locale est celle où nous pouvons encore agir et reprendre notre destin en main, comme l’illustre sur le regain de la démocratie participative sur les territoires et du militantisme écologique.
La COP de Copenhague de 2009 sur les changements climatiques a posé le constat de la difficulté d’un approche globale, tant son bilan fut décevant et a marqué les esprits. Entre l’approche globale et l’approche locale, il faut élaborer une troisième voie : celle de la collaboration.
Pour Catherine Larrère, le principal obstacle pour agir reste les inégalités sociales. Le réchauffement climatique est vécu différemment par les personnes selon leur condition sociale : par exemple, les populations les plus pauvres sont les plus impactées par la crise écologique à l’échelle du globe. Néanmoins, pour Pierre Rosanvallon, l’Histoire nous montre que, dans les sociétés européennes, les grandes épreuves ont été le début de grandes solidarités. Aujourd’hui, c’est au dérèglement climatique que nous devons collectivement faire face : apparaît alors une opportunité de développer un nouveau type de solidarité internationale et de rapports sociaux entre les êtres humains.
Face à l’Etat-Nation, le mouvement des Communs comme voie de sortie possible ?
La nature et l’écologie apparaissent indissociables du politique : comment parler de protection de l’environnement sans aborder celles de l’économie et de la croissance, et des choix individuels que nous faisons au quotidien ? Si la crise écologique est si communément admise et que le danger paraît absolument imminent, pourquoi fait-on aussi peu ?
Pour Rosanvallon, ce dont nous avons besoin est de changements radicaux du politique. Dans la conception de souveraineté des sociétés démocratiques, la terre appartient aux gens du présent. Il y aurait un rapport entre la souveraineté et le temps. Redéfinir notre rapport au temps est décisif, tout particulièrement dans le cadre de questions se posant à l’échelle mondiale.
Cette question de la temporalité de la décision est particulièrement délicate dans le champ politique, où le système démocratique encourage les représentants à se projeter sur des horizons réduits au rythme des élections. La démocratie représentative serait donc ce qui serait mal adapté dans nos sociétés ?
Né de la révolution française, ce mode de gouvernance a été voulu comme une rupture radicale avec le temps long de la royauté, dans l’optique de créer une société nouvelle, basée sur la souveraineté de l’Etat-Nation. Cette notion de souveraineté implique par répercussion un rejet de l’universel et de l’action au niveau mondial.
Et si à l’origine de tout cela était la propriété privée, telle qu’elle est conçu dans les démocraties occidentales ? La solution serait-elle de déconstruire le droit de propriété et mettre en valeur le mouvement des communs ?
Une première définition des communs serait « les biens qui sont d’usage commun ». Il s’agirait d’une ressource matérielle ou immatérielle, partagée et gérée en commun par une communauté : jardins partagés, AMAP, logiciels libres… Selon Elinor Ostrom, prix nobel d’économie 2009, cet aspect collectif serait à l’origine des communs. Il s’agirait d’une propriété d’usage visant à reconstruire les liens sociaux. L’objectif est alors de repenser notre conception de la propriété, en envisageant d’autres principes de gouvernance, et donc une autre vision de la politique et de la place de chacun dans la cité.
Conclusion : et la philosophie appliquée dans tout ça ?
Quel rôle peuvent jouer les chercheurs en sciences humaines ? Ont-ils seulement une marge d’action ? L’engagement à travers le doctorat et les travaux de recherche est possible, et constitue un moyen privilégié de questionner, d’apporter un recul critique, mais aussi re-construire des discours, des visions et au final d’impacter les actions. Cela passe en tout premier lieu par le choix même de son sujet de recherche : nous avons besoin de penser les bouleversements de nos sociétés et la philosophie contemporaine a un grand rôle à jouer. La philosophie constitue un outil privilégié pour appréhender des choix sur le long terme, en offrant des perspectives globales de ces problématiques, qui revêtent une complexité inédite jusqu’alors dans l’histoire de l’humanité : nous n’avons jamais eu autant besoin de sciences humaines ancrées sur le terrain.
Pour en savoir plus :
Le site du festival Allez Savoir