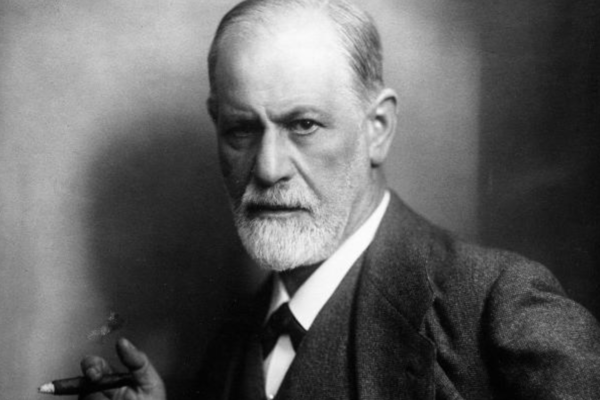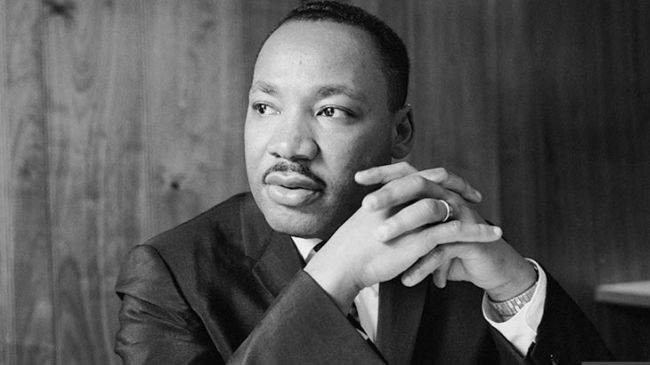Quoi ?
Par cette formule, qui se trouve dans ses Pensées (n°4, éd. Brunschvicg), Pascal distingue une morale authentique (« la vraie morale ») d’une morale factice (« la morale »).
Afin de mieux la comprendre, il convient d’avoir à l’esprit la phrase en son entier : « La vraie éloquence se moque de l’éloquence, la vraie morale se moque de la morale ».
La clé de compréhension réside dans l’analogie entre l’éloquence et la morale : de même que celui qui, véritablement, manie avec brio l’art de la parole se fiche, au fond de lui-même, de sa prestance et ne cherche pas à être loué pour son art – son intérêt étant ailleurs –, de même celui qui, véritablement, prête attention à la morale se fiche, au fond de lui-même, de son apparence morale ou non aux yeux de l’opinion publique.
Ici, l’idée de Pascal est que le comportement moral relève de la vérité intérieure, c’est-à-dire de la foi et donc du cœur et n’a rien à faire du jeu social et des apparences et de son regard inquisiteur sur les individus.
Pourquoi ?
Pascal est de ces philosophes dont on ne peut comprendre la pensée sans prendre en compte leur posture religieuse.
La philosophie de Pascal est empreinte de son jansénisme – une branche du catholicisme qui insiste sur la faiblesse et la misère de l’homme.
« Misère de l’homme » ou « Misère de l’homme sans Dieu », c’est le titre d’une partie des Pensées, écrites par Pascal.
Accorder de l’importance à l’apparaître et aux louanges du grand public, c’est se détourner de la vérité intérieure, et même intime, du cœur et, donc, s’éloigner de Dieu.
L’homme est misérable, et ce n’est qu’en se tournant vers Dieu qu’il peut aspirer, par le repentir, à une sortie de cet état consécutif du péché originel.
Or « la vraie morale » ne saurait être au nombre des choses de cet état de misère ; elle ne saurait donc être atteinte dans et par « la morale », c’est-à-dire dans et par un comportement démonstratif et vantard.
Qui ?
Les donneurs de leçons, qui, d’une part, jugent abusivement le comportement d’autrui en termes de bien et de mal, et qui, d’autre part, intiment aux autres, là encore sur un ton abusivement prescriptif ou injonctif, comment se comporter relativement à des principes prétendument moraux.
Les donneurs de leçons sont dans l’apparaître plus que dans l’être : eux-mêmes ne s’astreignent pas aux préceptes qu’ils voudraient pourtant voir suivis par autrui à leur demande.
Comment ?
Quoique ce ne soit pas chose aisée au sein d’une société qui vante l’image de soi et l’apparaître relativement à des normes souvent arbitraires, c’est en se détournant des regards extérieurs et des effets de nos actions et comportements au profit de principes intérieurs que l’on peut si ce n’est atteindre du moins tendre vers la vraie morale, aux dépens de la morale factice des donneurs de leçons.
Il convient de se méfier des grands discours moralisateurs, qui usurpent l’identité des discussions de la vraie morale ; lesquelles discussions sont non moralisatrices mais morales, ou éthiques. Contrairement à celui de la morale, le discours de la vraie morale n’est pas inquisiteur.
Ce qui donne…
La vraie morale ne discourt pas : elle discute, sincèrement et authentiquement – sans esbrouffe aucune.