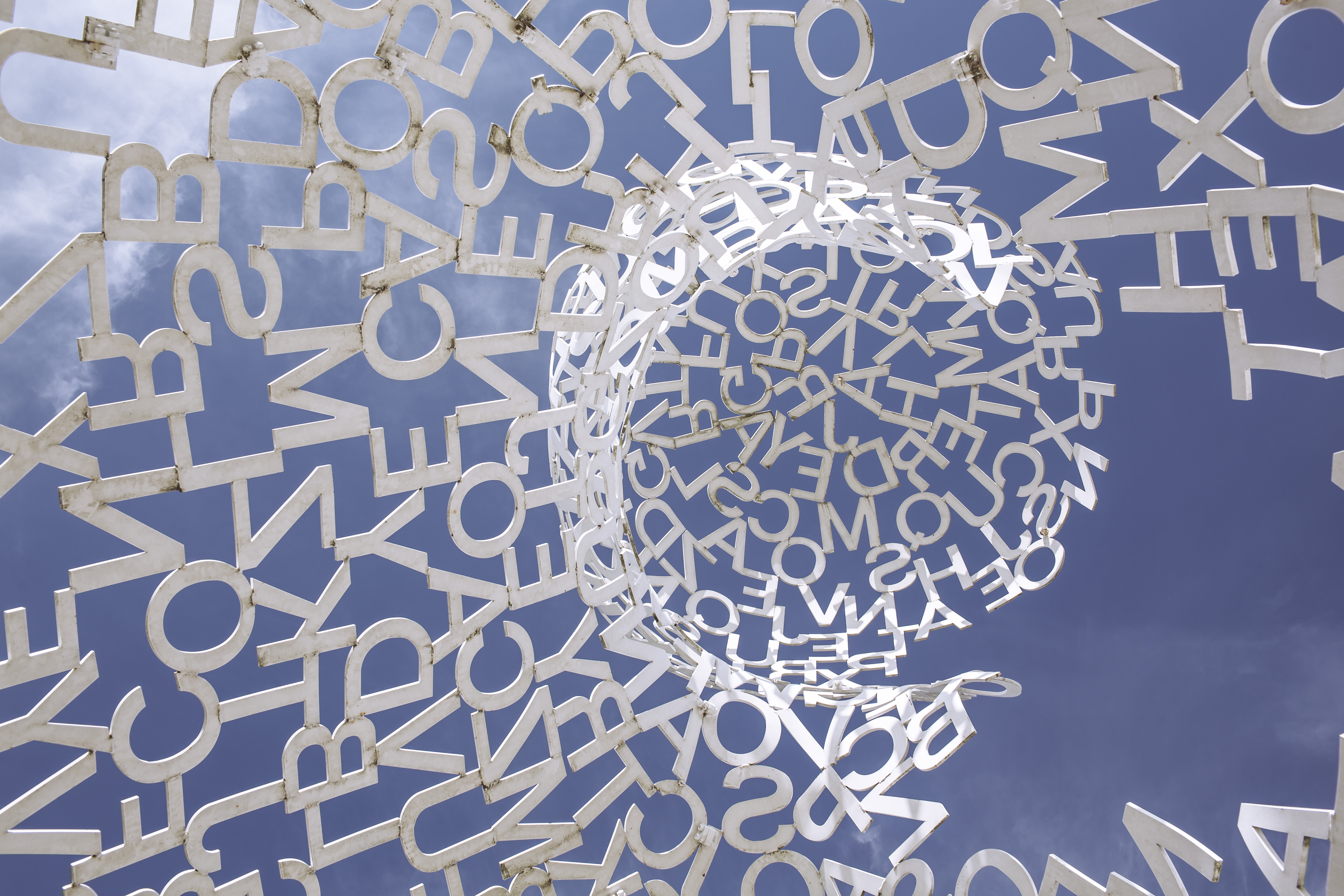Pourquoi avons-nous besoin des philosophes aujourd’hui ? Le recours à la philosophie peut-il aider les entreprises à innover, à mieux appréhender leurs valeurs, leurs missions et à les mettre en action ? Comment, en tant que philosophe, se lancer dans une activité de conseil ?
Pourquoi avons-nous besoin des philosophes aujourd’hui ? Le recours à la philosophie peut-il aider les entreprises à innover, à mieux appréhender leurs valeurs, leurs missions et à les mettre en action ? Comment, en tant que philosophe, se lancer dans une activité de conseil ?
Pour répondre à ces interrogations, nous avons rencontré Eric Lemaire, philosophe et consultant en entreprise. Après un doctorat en philosophie et un passage dans l’Education Nationale comme enseignant, il a créé en 2016 Philo-Logos, un cabinet de conseil basé à Strasbourg, accompagnant les entreprises dans leur recherche de sens dans leur action collective. Il nous livre dans cet entretien sa vision du rôle que la philosophie peut jouer pour aider les entreprises, notamment à faire face à la nécessité permanente qu’elles ont d’innover pour survivre.
De l’enseignement au consulting : quand la philosophie débouche sur l’entrepreneuriat
La Pause Philo : Pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre parcours et ce qui vous a amené à vous lancer comme philosophe en entreprise ?
Eric Lemaire : J’ai fait une thèse en épistémologie sur Wittgenstein, que j’ai réalisée avec l’envie d’aller dans l’enseignement. Après l’avoir soutenue en 2009, j’ai eu un poste d’ATER à l’Université de Bourgogne, où j’étais détaché en tant que philosophe dans un IUFM dédié à la formation des professeurs des écoles. Cette année là, j’ai pu faire de l’éthique appliquée avec les stagiaires, notamment, ce qui n’était pas à l’origine mon domaine de compétence. A partir de textes officiels de l’Education Nationale expliquant le métier de professeur, je m’amusais à faire réfléchir les étudiants à des situations concrètes créant des conflits de valeurs. Nous réfléchissions aux façons d’en sortir par le haut, c’est-à-dire sans abandonner toute ambition éthique. Nous avons également travaillé un peu en éthique théorique, sur le relativisme culturel, l’objectivisme, ou le subjectivisme, en m’appuyant principalement sur les travaux de Harry Gensler, un philosophe américain qui a écrit plusieurs manuels d’éthique dans un langage très accessible, avec des questionnaires et des exemples concrets.
À la fin de mon année à l’Université de Bourgogne, j’ai eu besoin de prendre du recul car je ne savais plus trop si je voulais continuer la recherche, je ne me sentais pas à ma place à l’Université… Je suis alors parti vivre à Bruxelles durant un an, ce qui m’a amené à rencontré quelques philosophes de formation ayant fait autre chose que de l’enseignement. Je m’y suis formé en neurosciences. J’ai également découvert des philosophes américains comme Lou Marinoff. J’ai alors réalisé que l’on pouvait utiliser la philosophie pour accompagner des particuliers ou des organisations.
Une fois revenu en France, ma dernière expérience dans l’Education Nationale n’a pas été particulièrement épanouissante. Les rapports de jurys, et mes collègues se plaignaient souvent de l’incapacité des élèves à problématiser et à argumenter. Mon expérience personnelle au contact de maîtres à l’Université me disait que, pour progresser dans ces domaines, il fallait écrire, obtenir un retour critique, et ré-écrire, apprendre à dialoguer avec les autres. Or ce processus d’amélioration était absent du fonctionnement ordinaire de l’enseignement.
J’ai alors imaginé un mode de fonctionnement de classe et d’évaluation permettant d’intégrer l’amélioration continue et l’exercice d’écriture philosophique dans le quotidien des élèves. Pédagogiquement cela me semblait prometteur, et le fut. Pour chaque notion, je réunissais un corpus de textes, les élèves formaient de petits groupes et devaient rédiger des exposés, qu’ils venaient présenter à toute la classe lors de la dernière session.
Ce mode de fonctionnement, outre le fait qu’il obligeait à coopérer, incitait à s’engager (j’exigeais juste que les conditions de travail soient bonnes au niveau sonore, les élèves étaient libres de ne rien faire, mais ils devaient alors assumer le risque d’obtenir de mauvais résultats), entraînait à l’expression orale, avait l’avantage supplémentaire de permettre une différenciation pédagogique plus pointue. Je pouvais passer quelques minutes avec des élèves qui ne comprenaient pas la relation entre le concept de liberté et la justification des hiérarchies dans une démocratie par exemple. Dans un schéma frontal, cela était impossible. Enfin, à l’issue des “soutenances”, j’assurais une synthèse qu’ils pouvaient noter.
J’ai pratiqué ce schéma quelques semaines. La classe était beaucoup plus intéressante et exigeante pour moi, car je m’exposais à une foule de questions non prévues. J’ai été inspecté alors que je pratiquais ce mode de fonctionnement. L’inspectrice a trouvé le système plutôt intéressant. Toutefois, ce n’était pas du goût d’un couple de parents (professeurs des écoles !) qui considéraient que je ne faisais pas cours et qui ont cherché à me mettre la pression ! J’étais contractuel, donc il n’était pas si compliqué de faire pression de façon à limiter ma liberté pédagogique. Comme c’était un emploi de transition pour moi, au lieu de me soumettre en espérant de voir mon contrat reconduit l’année suivante, je suis parti.
J’ai ensuite lancé une première activité en indépendant qui fut un échec. C’est après avoir un temps travaillé dans un organisme privé de formation que j’ai décidé de me relancer à mon compte. Je suis à temps plein sur Philo-Logos depuis 2016. En relançant cette activité, je ne voulais pas faire comme si je n’avais aucun bagage, et j’ai décidé cette fois-ci de pleinement m’appuyer sur les 10 ans de philosophie que j’avais derrière moi.
LPP : Quelles sont les activités que mène actuellement votre entreprise Philo-Logos ?
E. L. : Nous accompagnons les entreprises afin de les aider à travailler sur le sens qu’elles souhaitent donner à leur action collective (Vision, Mission, Valeur), et ce dans le but de mettre la question du sens de l’action collective au coeur du fonctionnement des organisations. Ainsi, nous intervenons au-delà de la conception de ce que j’appelle une « philosophie d’entreprise », en accompagnant la mise en oeuvre de cette philosophie. Nous essayons de faire en sorte que le discours sur la philosophie de l’entreprise ne se réduise pas à des éléments de langage servant à faire de la communication. C’est ce qui a tendance à se produire lorsqu’on intervient uniquement sur la conception et la rédaction de la philosophie de l’entreprise. Nous proposons également des formations au dialogue, dans le but de développer les capacités argumentatives des acteurs de l’organisation.
Quel rôle pour les philosophes en entreprise ?
LPP : On observe un développement important de la philosophie au sein des organisations ces dernières années. Selon vous, pourquoi a-t-on besoin de philosophes en entreprise aujourd’hui ?
E. L. : Le monde a énormément changé depuis la fin des trente glorieuses. Pour les entreprises comme pour les citoyens, mener sa barque est devenu plus compliqué. Le monde paraît chaotique. Or Wittgenstein a écrit quelque part que philosopher c’est descendre dans le chaos et s’y sentir chez soi. Il y a quelque chose de profondément juste dans ce propos. Le philosophe ne refuse pas la complexité, il ne se laisse pas déstabiliser par elle, il s’attache à y mettre de l’ordre en utilisant sa raison (clarifier les concepts, analyser les questions, imaginer les options théoriques, les arguments et objections, etc), patiemment, sans s’attendre à obtenir comme résultat une théorie unique qui le soulagerait définitivement de tout effort de recherche futur, et sans succomber à l’idée que toutes les idées se valent, c’est-à-dire sans renoncer à toute exigence intellectuelle (ce qui est une forte de tentative de notre époque).
Ce type de démarche intellectuelle, qui me semble très largement propre à la philosophie, peut être foncièrement utile dans les organisations. Et d’autant que les organisations sont perpétuellement confrontées à des discours simplificateurs, mais néanmoins très séduisants, qui promettent une solution radicale aux problèmes d’engagement, d’attractivité, de performance.
Je pense ici à ce qui est devenue une marée idéologique : le coaching et l’entreprise libérée. Des propositions assénées comme des évidences, dans un registre quasi messianique, sur le bonheur au travail, la confiance, le bien être, la liberté, l’autonomie, la responsabilité, l’authenticité, l’adaptation, l’égo, la transparence, le changement, le pouvoir, l’égalité, la coopération, l’optimisme le plus souvent très confus et incohérents, sont produits en masse. Ces discours sont très attractifs car ils jouent sur des aspirations profondes, mais ils sont tellement confus qu’ils peuvent faire plus de mal de que de bien. Il faudrait plus qu’une interview pour en faire une critique précise, exhaustive et laissant place au principe de charité. Le philosophe, à la façon d’un Socrate, peut dissoudre ces faux savoirs, par le questionnement et l’argumentation. Ce faisant, il peut être d’un secours utile aux managers sous pression qui sont exposés à ces discours et peuvent facilement y voir la solution aux problèmes humains qu’ils rencontrent.
Le philosophe peut jouer un second rôle important, qui est lié au premier, en aidant à élaborer une vision commune claire et relativement partagée du sens de l’action de l’entreprise. Il y a, me semble-t-il, une demande de participation plus grande à la vie des organisations, une attente de démocratisation des entreprises. Il y a également une tendance à considérer l’entreprise non plus seulement comme une machine à faire du profit mais comme une institution capable de contribuer positivement à la société, ce que ne garantit plus à nos yeux la réalisation de profits. Dès lors, l’entreprise peut être conduite à se poser quelques questions : (Vision) Dans quelle monde évolue-je, que puis-je en connaître ? (Mission) Quelle mission veux-je m’assigner dans ce monde ? (Valeurs) De quelles valeurs ai-je besoin pour accomplir ma mission ?
Toutes ces questions sont philosophiques, et pourtant, presque partout, elles sont laissées entièrement à des non philosophes. Je ne dis pas que les philosophes devraient les résoudre à la place des gens chargés de les transformer en action : je soutiens simplement que les philosophes peuvent guider les personnes concernés dans la réponse à ces questions. Aujourd’hui, les solutions apportées sont dans 99% des cas confuses et totalement infécondes si ce n’est pour faire de la communication, ce qui n’a probablement pas que des effets positifs sur les personnes qui reçoivent ces éléments de langage.
Les entreprises face au défi de l’innovation
LPP : L’innovation est l’une des préoccupations principales des entreprises. Comment, en tant que philosophe, peut-on y répondre ?
E. L. : En partant du point de vue des entreprises, on se rend compte que le défi de l’innovation tous azimuts est l’une des problématiques les plus importantes à laquelle elles doivent faire face. Aujourd’hui plus aucune entreprise ne peut se permettre de mener son activité sans se poser de questions : les marchés sont plus instables, la concurrence est beaucoup plus rude qu’il y a 40 ans car il y a beaucoup plus de pays capables de nous concurrencer. Et ce n’est probablement qu’un début, puisqu’un phénomène de convergence au niveau mondial est en marche, comme l’a bien montré Piketty dans son Capital au XXIème siècle (Chapitre 1).
La technologie évolue constamment et de plus en plus vite : le nombre d’ingénieurs, de techniciens, de chercheurs a explosé depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Les capacités de calcul augmentent de façon exponentielle, les logiciels, les appareils évoluent sans cesse et se retrouvent aussi bien dans les objets du quotidien que dans les processus de l’entreprises (production, communication, administration, logistique). L’arrivée de l’intelligence artificielle, et les progrès de la robotique vont encore remettre en question la relation Homme-machine.
Nous avons également connu une révolution sociologique bien documentée par les travaux de R. Ingelhart (Cultural Evolution, 2018) : nous sommes plus individualistes, plus soucieux d’autonomie, d’expression de soi, et cela se traduit dans les comportements de consommation (personnalisation de masse) et au travail. N’oublions pas également les nouveaux modèles économiques que le développement d’internet a fait émerger et qui font craindre à beaucoup d’être ubérisés.
Bref, pour faire face à ces environnements plus complexes, la capacité d’innovation est devenue fondamentale pour la plupart des entreprises, et l’on peut supposer qu’elle doit avoir les traits suivants : permanente, générale (touchant tous les aspects de l’entreprise), et démocratique (plus de cerveaux, plus d’idées). Réussir à innover suppose de la créativité, de la persévérance, de la curiosité, de l’intelligence rationnelle, une capacité d’apprentissage, de coopération, d’expérimentation.
Toutes ces choses, contrairement aux discours dominants, sont très compliquées à faire naître. Et ces choses ne sont pas encore rationalisables. Autrement dit, on ne peut prescrire les règles précises à suivre pour quasi automatiser (contraindre) ces processus de création, de coopération et d’expérimentation. Je dis “encore” car les progrès en psychologie de la créativité (Cf, Lubbart), de l’apprentissage (cf, Dehaene), en IA (Cf, Mc Afee), en technique de stimulation cérébrales (Cf, Van Quyen), ou encore les outils d’intelligence collective, peuvent être vus comme des tentatives, ou des moyens de rationalisation de ces capacités. Ainsi, on ne peut développer la capacité d’innovation sans recourir à la bonne volonté des personnes impliquées.
Si l’on m’accorde ce qui précède, la grande question du management devient : comment générer cette bonne volonté, indispensable à la mise à disposition des facultés les plus élevées des collaborateurs ? Il y a plusieurs leviers possibles, avec l’aura du secteur d’activité (travailler pour Google ou Apple est en soi une gratification, un honneur, pour certaines personnes), la gratification hiérarchique ou les opportunités de carrières, les incitations salariales, la pression, l’ambiance, les pratiques managériales, l’intérêt du travail, le projet ou sens de l’action collective.
L’aura est réservée à une minorité d’entreprises. La gratification hiérarchique sera d’autant moins possible que les entreprises ont tendance à réduire la hauteur des pyramides (Crozier, Drucker, et Rifkin le notaient déjà dans les années 80 et 90). Les incitations salariales sont moins disponibles dans une économie sans croissance ou presque.
Cela étant dit, il me semble que le problème de l’innovation tous azimuts suppose que la création de valeur doit faire appel à plus de personnes, ce qui soulève évidemment la question de la répartition équitable ou juste de la valeur créée. Cette question est de façon étrange généralement absente des discours dominants mentionnés plus haut. La pression, en engendrant du stress, ne nous rend généralement pas plus intelligents. L’ambiance compte assurément, mais une bonne ambiance n’est pas du tout un gage d’engagement et de performance ! Chacun peut mobiliser dans son expérience personnelle des illustrations de cette thèse.
Avoir de l’intérêt envers son travail est sans doute prometteur, tout comme le sens de l’action commune. Il me semble que les philosophes sont particulièrement bien placés pour aider à élaborer le sens que l’entreprise veut donner à son action.
Toutefois, il faut se garder de croire que le sens de l’action pourrait résoudre tous les problèmes d’engagement, les autres paramètres ont une grande importance.
La question du sens pose de nombreux problèmes épineux, qui ne me semblent pas résolus de façon définitive : dans une société pluraliste, jusqu’où pouvons-nous aller dans la délibération collective autour d’une philosophie d’entreprise, sans empiéter illégitimement sur ce qui relève de la sphère privée ? Comment faire en sorte que la philosophie d’entreprise soit vivante, qu’elle ne se transforme pas en dogme ? En fonction de quelles critères épistémiques la corriger ? Comment tenir compte des intérêts individuels, des logiques d’acteurs, dans l’élaboration d’une vision commune ?