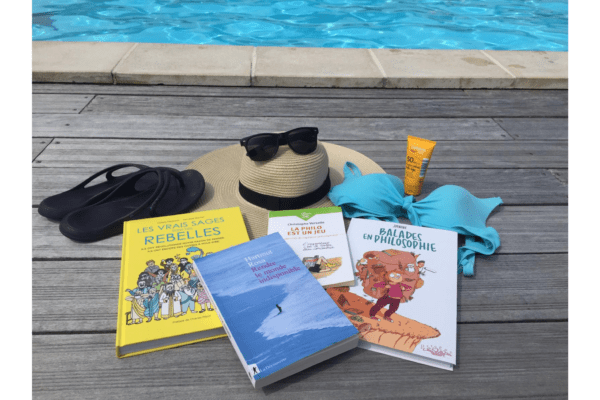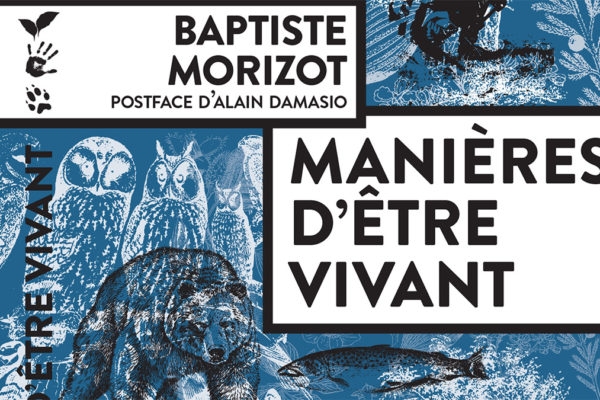Comment combiner un bel été et de bonnes lectures ? En des temps troublés, il est nécessaire d’avoir auprès de sa serviette de plage des ouvrages qui permettent la détente, l’évasion intellectuelle tout en faisant réfléchir sur la complexité du monde. Se confronter à des idées, à des grains de sable permet d’augmenter le capital de protection contre les brûlures de l’histoire des temps passés, présents et futurs. Étaler la culture sur un maximum de surface permet de balayer les idées reçues, les incompréhensions et de découvrir des zones que l’on sait être là mais sur lesquelles notre regard ne s’attarde pas au quotidien.
Si vous avez l’occasion de parcourir les petits coins lectures de La Pause Philo, vous constaterez aisément qu’ils sont pour moi une façon de créer des moments porteurs de Sens, des « RDV » comme il nous arrive à tous de les écrire. Michel Debout, dans son ouvrage L’Art du rendez-vous (Ed. de L’Aube) vous fera découvrir comment, pourquoi et pour quelles raisons le rendez-vous est avant tout une rencontre avec les autres et avec soi-même. A travers différentes thématiques qui vont du « rendez-vous sentimental » à celui consacré à la démocratie, l’auteur nous décrypte avec finesse à la fois les conditions de ces moments de vie et l’importance de ceux-ci lorsqu’ils sont manqués ou absents. Après cette lecture, vous ne prendrez plus jamais votre agenda comme avant !

Il est également possible d’anticiper des rendez-vous avec le futur, sans pour autant souhaiter qu’ils adviennent. Dans un thriller qui a pour but d’éveiller les consciences sur les paradoxes de notre société, Alexandre Arditti nous plonge dans les méandres de ce que serait une possible enquête sur L’assassinat de Mark Zuckerberg (Ed. La Route de la Soie) s’il avait lieu. Une mystérieuse organisation appelée « Table Rase » permet aux lecteurs de se rappeler la méthode de Descartes en matière de construction de la connaissance mais aussi de s’interroger sur le statut de la « vraisemblance », cette probabilité qui ne donne pas de valeur certaine à la vérité. Une enquête dans le Paris d’aujourd’hui qui laisse supposer celui de demain fait de progrès technologiques qui laisseraient peut-être peu de place à ce qui fait « humanité » en société.

Comment ne pas parler d’un livre qui a fait sensation et qui porte en lui la suite logique du sujet que nous venons d’évoquer ? En matière de technologie, les champs de batailles sont nombreux : déshumanisation, fractures numériques, fake news, univers Méta, manipulations intellectuelles et commerciales, influences politiques, ingérences etc. Dans son ouvrage Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats (Ed. Seuil), Asma Mhalla brosse le portrait d’un Léviathan que Thomas Hobbes n’aurait jamais pu imaginer ! L’hydre de Lerne composé de la BigTech et du BigState nous fait réfléchir à un nouveau contrat social qui rend la démocratie plus vulnérable et qui nous oblige à repenser nos actions de citoyens-nes. Repenser la politique est un défi, il semble impératif de le relever afin que les peuples s’unissent au lieu de se diviser.

Ainsi, les théories s’affinent, s’opposent, disparaissent, réapparaissent, innovent et réagissent entre elles pour former un foisonnement qui s’enchevêtre formant une histoire dans l’Histoire. Pour mieux comprendre l’influence des penseurs qui ont marqués le XIXème et le XXème siècle, et ce bien au-delà de leur époque, l’ouvrage de Christophe Charle sera d’une grande aide. L’Europe des intellectuels, figures et configurations (CNRS-Editions) explique comment la circulation des œuvres des penseurs permet aux idées de voyager et de toucher le plus grand nombre, mais également comment elles ont construit l’Europe contre les nationalismes. En se confrontant, en dialoguant entre eux, les penseurs montrent à quel point la « dispute », au sens noble du terme, permet d’abolir les frontières entre les peuples pour mieux construire la pensée elle-même au risque d’affronter l’adversité.

Dans un XXIème siècle bousculé lui aussi par un réexamen de la place de chacun dans nos sociétés, il est désormais possible de regarder à la loupe les a priori, les préjugés, les stéréotypes qui permettent à l’esprit de s’en tenir à des représentations erronées soumises à l’influence de notre culture, de notre éducation etc. Pensez contre soi est la première marche d’un escalier en colimaçon dont on ne voit pas toujours la hauteur. Pour emprunter les premières marches, Odile Fillod et Elisabeth Feytit engagent une conversation dans Cerveau et stéréotypes de sexe, comment faire dire à la biologie ce qu’elle ne dit pas (Méta de Choc Collection, Ed. La route de la Soie). Force est de constater que c’est en confrontant les arguments que la pensée avance à grand pas et que les croyances en matière de connaissance de la nature humaine en prennent un coup. Entre les informations vraisemblables, la tromperie manifeste et les simples opinions véhiculées avec le temps, les auteures permettent de tordre le coup aux idées reçues et montrent à quel point le sujet des stéréotypes nous contraint à réfléchir sur nous-mêmes et notre propre construction intellectuelle.

Dans le même esprit de déconstruction des stéréotypes, Clémence Perronet, Claire Marc, Olga Paris-Romaskevich publient Matheuses, les filles, avenir des mathématiques (CNRS-Editions). Entre les inégalités, les a priori sur les capacités, les plans de carrières « tout tracés » et les orientations insidieuses, les filles cumulent les raisons d’une absence remarquée dans les filières scientifiques, les classes spécialisées en mathématiques et autres IUT. Pour des raisons historiques, culturelles et cultuelles, il existe encore un frein au XXIème siècle à l’émergence d’une révolution sociétale qui permettrait aux filles de s’épanouir dans leur domaine de compétence et dans leur passion. Au travers d’une étude sociologique rigoureuse, les auteures démontrent à la fois les raisons de ces a priori mais apportent des solutions pour remédier à ces problématiques. En proposant une approche des mathématiques en faisant des mathématiques, cet ouvrage fait œuvre de pédagogie et d’originalité.

Dans l’optique de cette chronique de lectures, la trame est l’ouverture d’esprit, la découverte, la rencontre de l’autre si proche, si loin. Un projet se dessine peu à peu : une réhumanisation des rapports entre les cultures afin que les divisions s’estompent et découvrir enfin que les différences ne sont en aucune manière une affaire de hiérarchie. Dans Anthropologues ! (CNRS-Editions), Emmanuelle Seguin, dessinatrice, maquettiste et infographiste signe ici un ouvrage ludique et représentatif du travail insoupçonné que demande l’anthropologie, qu’elle soit ethnologique ou sociologique. En collaboration avec Frédérique Fogel, Anne Monjaret et Armelle Leclerc, l’auteure montre comment de multiples chercheurs-ses parcourent le monde tels des enquêteurs-trices des univers qui nous entourent. Entre la volonté de comprendre les origines d’une mythologie, d’une musique, de comportements sociétaux et la mise en lumière des données récoltées, il y a tout un chemin à parcourir, jalonné de doutes et de difficultés. Une belle mise en perspective de ce qui constitue l’humanité.

Ce tableau de lectures ne serait pas complet si je ne parlais pas de ce qui constitue l’Everest de toute réflexion sur le monde tel qu’il nous apparait, à savoir la complexité. Plus la connaissance avance, plus les éléments se font jour, plus notre esprit découvre la profondeur abyssale de ce qui reste à comprendre. C’est dans cet univers que Laurent Bibard nous immerge au travers de son ouvrage Vivre dans un monde complexe, Alice au pays des incertitudes (Ed. de L’Aube). Qu’est-ce que nous contrôlons exactement ? Pour quelles raisons voulons-nous contrôler ce qui nous échappe ? Le principe d’incertitude est-il inévitable ? Telle une particule quantique, cette incertitude et notre volonté de la supprimer sont-elles vaines ? Au lieu de nous battre contre ce qui nous fait peur, pouvons-nous l’apprivoiser et en faire un atout ? Ce sont quelques questions auxquelles tente de répondre l’auteur en faisant appel à Alice, personnage central de l’œuvre de Lewis Carroll. Sans doute que la solution se trouve dans un juste équilibre entre ce que nous souhaitons et ce qui est possible, ce que nous ne maitrisons pas et que nous devons abandonner.

La complexité résidera sans doute dans la façon dont vous aborderez toutes ces lectures afin que les grains de sables restent un plaisir !
Une chronique par Sophie Sendra Toutes ses publications